« Avant, l’avenir se pensait au travers de la jeunesse ; aujourd’hui, l’avenir est pensé par une génération qui n’en vivra qu’une fraction » souligne Maxime SBAIHI
« Avant, l’avenir se pensait au travers de la jeunesse ; aujourd’hui, l’avenir est pensé par une génération qui n’en vivra qu’une fraction » souligne Maxime SBAIHI
Entretien intégrée à la partie « Crise politique » de l'étude « Comprendre la polycrise »
Économiste et directeur du Club Landoy, spécialiste de l’équité intergénérationnelle, Maxime Sbaihi alerte sur un basculement démographique sans précédent : une société où les décisions collectives sont pensées par ceux qui n’en vivront pas les principales conséquences. Le vieillissement structurel des sociétés occidentales fragilise les piliers de la solidarité, la soutenabilité des finances publiques et l’efficacité des États dans un monde fracturé. Cette crise, à la fois sociale, budgétaire et politique, mine les fondements démocratiques et réduit la capacité de projection stratégique de la France. Pour éviter une forme systémique de délitement, Sbaihi appelle à refonder un pacte intergénérationnel basé sur l’équité, la représentation et le temps long. Face à l’urgence, la France ne peut plus différer les réformes qui permettront à chaque génération de se reconnaître dans un projet commun d’avenir.

Vous affirmez dans vos travaux que la crise démographique est largement sous-estimée. Comment la décririez-vous simplement, pour en faire saisir l’ampleur au grand public ?
C’est une crise silencieuse, souvent ignorée, mais pourtant majeure. À l’instar du climat il y a quinze ou vingt ans, elle est perçue comme abstraite et lointaine, alors qu’elle nous touche déjà. Il y a quelque chose de vertigineux dans le fait qu’un pays entier puisse changer de structure sans que cela ne mobilise davantage l’opinion publique. Pour faire prendre conscience de ce basculement, j’utilise souvent une image simple : la pyramide des âges. Tout le monde en a vu une à l’école, elle est restée dans notre imaginaire collectif.
Historiquement, elle avait une base large, avec de nombreux jeunes, et un sommet étroit, avec peu de personnes âgées. Mais aujourd’hui, cette pyramide s’inverse. Elle maigrit par le bas, à cause de la dénatalité, et elle s’élargit par le haut, du fait du vieillissement. C’est la double peine. Et c’est totalement inédit dans l’histoire humaine. Ce n’est pas une simple tendance passagère, c’est une transformation démographique profonde. C’est pour cela que j’évoque l’image des « balançoires vides » dans mes travaux. Depuis 2010, 5000 écoles ont fermé en France, tandis que 300 EHPAD ont ouvert.
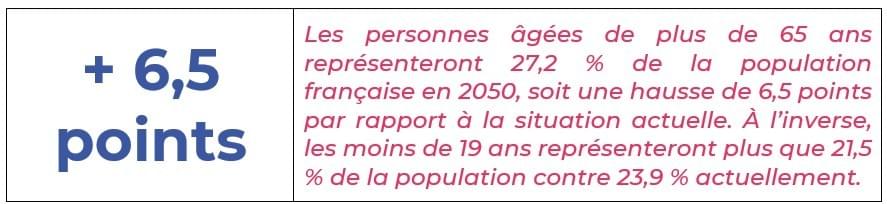
En termes démographiques, la natalité a chuté de 25 % en France sur la même période. Ce n’est pas marginal, c’est massif. En 2024, il y a eu seulement 17 000 naissances de plus que de décès. Ce chiffre peut sembler anodin, mais dans un pays de près de 68 millions d’habitants, cela signifie que nous sommes à deux doigts d’un basculement historique : pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le « solde naturel » de la population française va devenir négatif. Selon les projections de l’Insee, ce solde inversé deviendra la norme d’ici 2027-2030. Cela veut dire que, sans immigration, notre population commencerait à décroître. Des pays comme l’Allemagne ou le Japon sont déjà entrés dans cette phase.
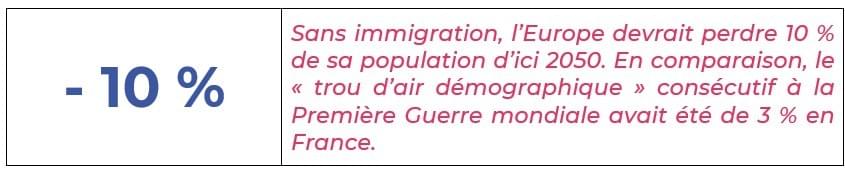
Pourquoi ce phénomène est-il particulièrement préoccupant pour la France ?
Parce que notre modèle social est construit sur une démographie dynamique. C’est une spécificité française : à la Libération, on a fait le choix du système par répartition. Cela signifie que les pensions des retraités sont financées en temps réel par les cotisations des actifs. Ce modèle repose sur trois postulats démographiques implicites : (1) une pyramide des âges pyramidale ; (2) une jeunesse nombreuse ; et (3) un renouvellement constant des générations.
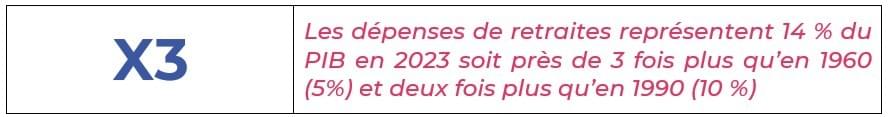
Aujourd’hui, ces trois piliers sont en train de s’effondrer. La pyramide n’est plus une pyramide, la jeunesse est devenue minoritaire, et le taux de fécondité est à 1,62 enfant par femme, loin du seuil de renouvellement de 2,1. En d’autres termes, notre modèle social, qui fête ses 80 ans cette année, repose sur des bases démographiques qui n’existent plus.
Et le paradoxe, c’est que la France est souvent vue comme relativement bien lotie par rapport à d’autres pays européens. C’est vrai, mais c’est précisément parce que nous avons misé sur la démographie que nous sommes d’autant plus vulnérables à ces variations. Moins de naissances, c’est moins d’actifs demain, donc moins de cotisations, et donc in fine un système de protection sociale sous tension. Comme notre politique familiale reste l’une des plus coûteuses d’Europe, la dénatalité interroge d’autant plus l’efficacité et la soutenabilité de l’ensemble du système.
On pourrait penser qu’il s’agit d’un simple problème de financement. Pourquoi dites-vous que c’est aussi une crise démocratique et politique ?
Parce que la démographie structure les équilibres démocratiques. Dans une démocratie représentative, le pouvoir est censé refléter la majorité. Or, aujourd’hui, cette majorité est vieillissante. C’est un basculement historique : pour la première fois, les plus de 50 ans représentent plus de la moitié du corps électoral. À l’inverse, les moins de 30 ans, même s’ils allaient voter massivement, ne pèseraient que 17 % de l’électorat. On a donc une représentation politique qui devient mécaniquement biaisée en faveur des générations les plus âgées.
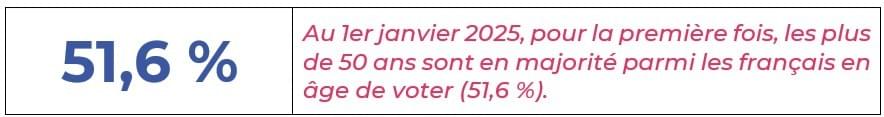
Ce n’est pas nécessairement un problème en soi. Il ne s’agit pas de dire que les seniors votent mal. Mais cela change la manière dont on parle du futur. Avant, l’avenir se pensait au travers de la jeunesse : on parlait d’avenir en s’adressant à elle. Aujourd’hui, l’avenir est pensé par une génération qui n’en vivra qu’une fraction. Cela pèse sur les décisions collectives. Pour l’instant, ce qui est électoralement rentable, c’est d’augmenter les pensions et de promettre davantage pour la dépendance, pas de faire des réformes qui paieront dans vingt ans.
Cette rupture générationnelle a-t-elle aussi une dimension sociale ?
Oui, de façon très nette. La pauvreté, en France, est aujourd’hui essentiellement une pauvreté jeune. On a 9 % de retraités pauvres, et c’est une réalité qu’il ne faut pas nier, mais on oublie que près de la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Ce sont des étudiants, des jeunes actifs précaires, des familles monoparentales. Ce sont eux qui portent la facture démographique, sans avoir choisi ce modèle.
Et il y a un malentendu majeur sur le fonctionnement de notre système. Beaucoup de Français croient qu’ils cotisent pour leur propre retraite, comme dans un système de capitalisation. En réalité, ils financent les retraites actuelles. On est dans un système de répartition, mais dans les têtes, c’est la capitalisation. Ce contresens alimente le déni collectif. Les gens ne comprennent pas que, sans une base active suffisamment large, le système s’écroule. Il y a un besoin urgent de pédagogie économique et sociale. Beaucoup de jeunes ont le sentiment de financer un système dont ils ne bénéficieront pas, sans même que cela soit reconnu. Ce décalage entre perception et réalité alimente un ressentiment profond.
Et puis, il y a une forme de blocage culturel. En France, on a du mal à parler des déséquilibres générationnels sans être accusé de faire la guerre des âges. C’est presque un tabou. Le simple fait de poser la question des solidarités intergénérationnelles est perçu comme une provocation. Résultat : on préfère fermer les yeux, et on ne remet pas en cause un modèle qui s’est figé dans un imaginaire d’après-guerre, avec beaucoup de jeunes, peu de personnes âgées, et une promesse implicite de progrès générationnel. Ce monde-là n’existe plus. Il faut accepter de le dire.
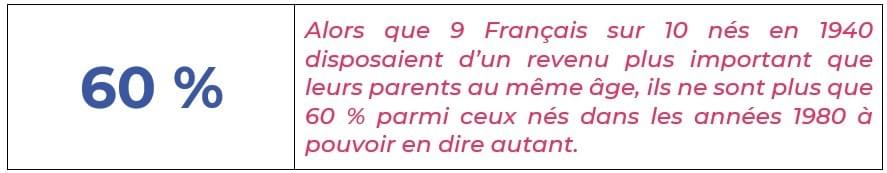
Cette crise démographique pourrait-elle affecter d’autres champs, comme l’économie, la transition écologique ou la sécurité ?
Évidemment. La démographie est une variable déterminante dans presque tous les grands défis collectifs. Sur le plan économique, le vieillissement accéléré de la population signifie moins de travailleurs, moins de contribuables, moins d’innovateurs. On aura moins de bras et de cerveaux pour faire tourner l’économie, pour réindustrialiser, pour relancer la croissance.
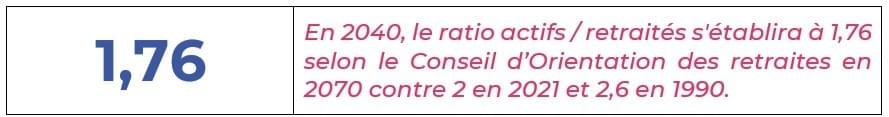
Et cette pénurie de ressources humaines arrive au pire moment. On manque déjà d’enseignants, de soignants, d’ingénieurs, de soldats. Certaines régions voient leur population active baisser, ce qui rend le maintien des services publics difficile.
Sur le plan budgétaire, la démographie agit comme un tsunami lent. La santé, les retraites, la dépendance : ce sont des dépenses exponentielles. Et contrairement à d’autres postes budgétaires, ce ne sont pas des dépenses discrétionnaires. On ne peut pas ne pas les payer. Or, plus ces dépenses augmentent, moins on aura de marge pour investir dans la transition écologique, la défense ou la recherche. À terme, c’est notre souveraineté qui est en jeu.
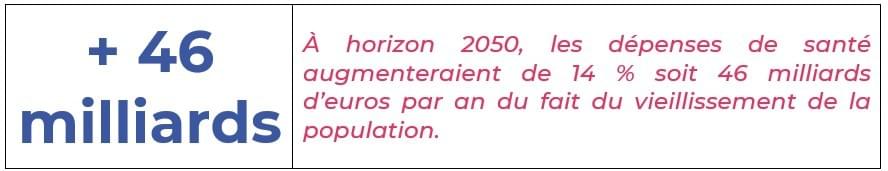
Que peut-on faire face à un tel défi ? Est-ce qu’il existe des solutions concrètes ?
Il existe des solutions, mais elles exigent une véritable révolution dans notre manière de penser l’action publique. La démographie est une mécanique lente, mais inexorable. Elle ne s’inverse pas par décret. Elle demande du temps long, de la prévoyance, de la constance. Or, notre système politique, budgétaire et médiatique est à l’opposé de cette temporalité. Il est organisé autour de cycles courts, d’effets d’annonce, de réflexes électoralistes. C’est ce grand écart qu’il faut résorber.
Certains pays s’y sont déjà attelés. Le Pays de Galles, par exemple, a adopté une loi sur le bien-être des générations futures. Cette loi oblige les pouvoirs publics à vérifier que chaque décision est compatible avec les intérêts de long terme de la société. Elle s’appuie sur une commissaire indépendante qui peut alerter et recommander. L’Australie, de son côté, a commencé à explorer l’idée d’un budget intergénérationnel pour mesurer l’impact à long terme des politiques publiques. En Allemagne, la Cour constitutionnelle a censuré une loi climatique au motif qu’elle faisait reposer trop d’efforts sur les générations futures. C’est une autre manière de poser la question démocratique : qui décide, pour qui, et sur quelle durée ?
Et en France, par où commencer ?
Il faut une batterie de leviers. D’abord, institutionnels : intégrer une logique intergénérationnelle dans la Constitution ou dans les règles budgétaires. Ensuite, politiques : revoir notre modèle de protection sociale pour le rendre plus soutenable. Cela peut passer par une réforme du quotient familial, par une refonte des allocations, par un effort massif sur l’accès au logement pour les jeunes. Mais aussi par une revalorisation du travail, qui ne paie plus assez pour justifier les efforts qu’on demande aux nouvelles générations.
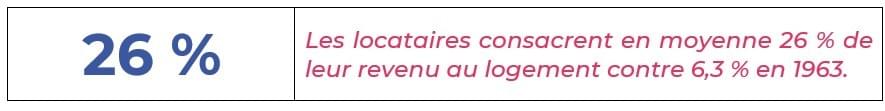
En parallèle, il y a les idées plus disruptives. Par exemple, abaisser la majorité électorale à 16 ans. Ou même, attribuer un droit de vote aux enfants, exercé par leurs parents jusqu’à leur majorité. L’idée peut sembler iconoclaste, mais elle a été sérieusement discutée dans plusieurs pays. Elle permettrait de rééquilibrer le corps électoral, et de remettre les enfants, donc l’avenir, au centre du jeu politique. On pourrait aussi créer une instance indépendante, un commissariat aux générations futures, chargée d’évaluer l’impact à long terme des politiques publiques, de façon transparente.
N’est-ce pas trop radical pour le système français ?
Ce qui me semble radical, c’est de continuer comme si de rien n’était. Ce serait une forme de violence par inaction. Si on ne bouge pas, la réalité s’en chargera. Soit par les marchés financiers, qui imposeront leurs conditions, comme ce fut le cas en Grèce ou en Italie au début des années 2010. Soit par la rue, avec des mouvements sociaux profonds. Soit par des décisions brutales : souvenez-vous, en Italie, l’âge de départ à la retraite a été repoussé de cinq ans en une seule nuit.
Moi, je préfère des réformes lucides, progressives, démocratiques, à des ajustements dans la panique. Nous avons encore un peu de temps, mais il est compté. Sur la dénatalité, par exemple, on peut encore enrayer la chute si on agit vite et bien. Mais il faut changer d’échelle. Il ne s’agit pas de relancer une politique nataliste au rabais. Il s’agit de permettre à chacun de faire librement le nombre d’enfants qu’il souhaite. Aujourd’hui, les jeunes en France veulent plus d’enfants qu’ils n’en ont. Le problème n’est pas culturel, il est matériel : logement trop cher, emploi instable, manque de services publics. C’est là que l’action publique doit frapper fort.
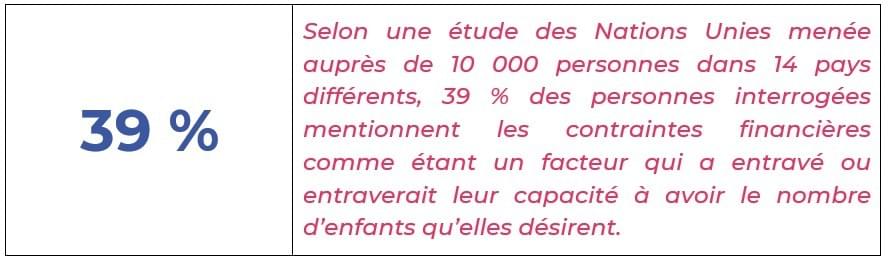
Ce rôle revient-il uniquement à l’Etat ?
Non, les entreprises ont aussi un rôle central à jouer, mais elles sont encore largement en retard sur ce sujet. Dans beaucoup de grandes organisations, les dirigeants n’ont pas encore pris la mesure du choc démographique. Pourtant, ils en perçoivent déjà les effets : difficultés de recrutement, départs massifs en retraite, montée en flèche du nombre d’aidants salariés, absentéisme accru.
La démographie devient une contrainte RH. Certaines entreprises réalisent trop tard qu’elles ont laissé partir trop tôt leurs seniors, qu’elles peinent à remplacer les départs, et qu’elles n’attirent plus assez de jeunes. D’autres découvrent les besoins croissants d’adaptation pour les salariés aidants. En France, 5 millions de salariées et salariés sont aidants à l’heure actuelle, et un actif sur quatre le sera d’ici 2030. Les aidants génèrent plus d’arrêts maladie, de fatigue, de présentéisme. Dans la plupart des cas, ils n’informent pas leur employeur de leur statut d’aidant. Il est temps d’intégrer ces enjeux dans la stratégie : formation tout au long de la vie, organisation du temps de travail, parcours professionnels multi-âges, adaptation des bureaux… Il s’agit d’une condition de survie organisationnelle dans un monde qui vieillit.
Et pourtant, j’observe encore une forme d’inertie dans le monde économique. Même dans des secteurs directement concernés comme l’assurance, le logement ou la santé, la démographie reste un angle mort. J’ai souvent le sentiment que les dirigeants n’ont pas encore connecté leur vision d’entreprise à cette réalité sociale. On continue à raisonner comme s’il y avait toujours autant de jeunes, comme si l’héritage arrivait toujours au bon moment, comme si la dynamique intergénérationnelle allait de soi. Il faut faire sauter ces verrous culturels pour adapter nos organisations à ce nouveau monde démographique.
À long terme, quel horizon souhaitez-vous voir émerger de cette prise de conscience ?
Je rêve d’une société où l’on se pose systématiquement la question : que laissons-nous aux générations suivantes ? C’est ce que j’appelle l’équité intergénérationnelle. L’idée est simple : chaque génération doit léguer à la suivante des conditions de vie au moins équivalentes, sur le plan économique, social, écologique. Ce n’est même plus une promesse de progrès, c’est un engagement minimal de non-régression.

Or aujourd’hui, cet engagement est rompu. La génération qui arrive hérite d’une triple dette : une dette publique, une dette climatique et une dette démographique. Elle doit financer des systèmes conçus dans un autre monde, avec moins de perspectives, moins de mobilité sociale, et un accès de plus en plus tardif à l’héritage. L’ascenseur social est en panne, et les jeunes n’y croient plus. Résultat : ils cherchent à sortir du système. Ils deviennent des passagers clandestins, choisissent des parcours alternatifs, créent leur propre emploi, misent sur la capitalisation individuelle, se tournent vers le travail indépendant. Ce sont des stratégies de survie face à un pacte social défaillant.
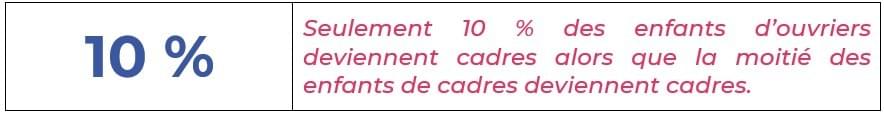
Est-ce que vous voyez, malgré tout, des forces de rappel positives ?
Oui, d’abord la jeunesse elle-même. Elle bouge, elle invente d’autres manières de travailler, de s’engager, de se solidariser. Elle n’a pas déserté le politique, elle le vit autrement. Le problème, c’est qu’on ne lui laisse pas vraiment de place politique. Mais si c’était le cas, elle pourrait être un levier énorme de transformation.
Ensuite, il y a une prise de conscience qui commence à émerger. Chez certains responsables politiques, chez certains intellectuels, mais aussi chez les aînés eux-mêmes. J’ai souvent des échanges avec des retraités qui s’inquiètent de ne pas avoir de petits-enfants, ou de voir leurs enfants en difficulté. Ils comprennent, par ce biais, que la dénatalité n’est pas une abstraction. Et ils acceptent d’en tirer les conséquences. C’est ce type de pont intergénérationnel qu’il faut reconstruire.
Comment éviter que cette prise de conscience ne soit instrumentalisée ou dévoyée ?
C’est une vraie question. La démographie est un sujet sensible, parce qu’il touche à la vie privée, à la famille, à la mort, à la transmission. C’est un champ miné, qui peut très vite déraper. On l’a vu avec certains discours conservateurs ou autoritaires. Il faut donc poser une ligne rouge très claire : jamais d’atteinte à la liberté individuelle. Jamais de pression sur les choix reproductifs. Jamais de retour sur les droits des femmes.
Ce que je défends, ce n’est pas une politique nataliste autoritaire, c’est une politique de capacité : donner aux jeunes les moyens d’avoir la vie qu’ils souhaitent. Cela suppose un changement de paradigme dans nos politiques publiques. C’est admettre que, comme il existe des rapports sociaux liés à la classe, il existe aussi des rapports de pouvoir entre les âges. Les intérêts économiques, sociaux et politiques des différentes générations ne coïncident pas toujours. Cela ne signifie pas qu’ils doivent être mis en conflit, mais qu’ils doivent être représentés et arbitrés équitablement. Aujourd’hui, la jeunesse n’est représentée par personne. À gauche, pourtant historiquement attachée aux luttes sociales, la question des inégalités entre générations reste largement impensée. L’analyse reste structurée par le prisme des classes, sans intégrer la variable d’âge comme un facteur autonome de déséquilibre. Même les syndicats, eux-mêmes vieillissants, peinent à représenter les actifs les plus jeunes. Ils tiennent d’ailleurs parfois un discours plus proche des retraités que des travailleurs. Résultat : la jeunesse n’a plus de porte-voix institutionnel, ni dans les partis, ni dans les corps intermédiaires.
Pour terminer, comme je le disais, la vraie radicalité serait de ne rien faire. Refuser de regarder la démographie en face, c’est condamner notre modèle social, notre cohésion nationale, notre avenir collectif. La démographie n’est pas une fatalité, mais elle est une réalité. Elle ne décide pas de tout, mais elle conditionne tout. À nous de la remettre au cœur du débat public, avec lucidité et ambition. Le temps presse, mais il n’est pas trop tard.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise.
