« La crise du multilatéralisme est un phénomène central de la polycrise, qui en est tout à la fois le miroir et le moteur » affirme Alain LE ROY
« La crise du multilatéralisme est un phénomène central de la polycrise, qui en est tout à la fois le miroir et le moteur » affirme Alain LE ROY
Entretien integrée à la partie « Crise géopolitique » de l'étude « Comprendre la polycrise »
Alain Le Roy, ambassadeur de France, ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU et ancien Secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure, commente la rupture créée par la crise actuelle du système multilatéral, pierre angulaire de l’ordre international depuis 1945. Cet affaiblissement, produit de la montée des logiques de puissance, alimente la brutalisation du monde. Il fragilise la régulation des interdépendances et complique fortement la gestion des biens publics mondiaux, qu’ils soient relatifs au climat, à la santé, à la paix ou à la sécurité mondiale. Si l’on veut éviter l’enlisement dans un désordre fragmenté, il convient de travailler à la refondation d’un multilatéralisme plus inclusif, porté notamment par l’Union européenne. La crise du multilatéralisme agit comme un facteur d’aggravation de la polycrise et accroît la nécessité de contribuer à repenser l’ordre mondial.

Quelle place occupe l’effondrement du système multilatéral dans la crise géopolitique que nous connaissons ? Quel rôle joue ce phénomène dans la polycrise ?
L’affaiblissement des institutions et des normes internationales constitue aujourd’hui un phénomène central de la polycrise. Le multilatéralisme, fondement de la gouvernance mondiale depuis 1945, est fragilisé à un moment où il est pourtant plus nécessaire que jamais pour faire face à des défis communs comme le dérèglement climatique, les pandémies ou les conflits armés.
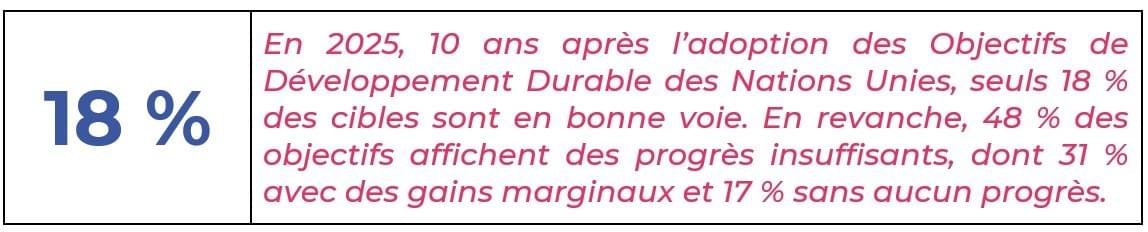
En effet, les outils multilatéraux sont évidemment les mieux adaptés pour travailler sur la question des « biens publics mondiaux » que sont le climat, la santé, la faim ou la gestion de crises internationales dans le monde.
Ce processus d’érosion est à la fois principalement le produit d’attaques frontales, telles celles portées par la Russie de Poutine notamment depuis 2014 ou par l’Administration américaine de Trump, mais aussi d’un désengagement progressif d’autres puissances pourtant historiquement porteuses de ces structures.
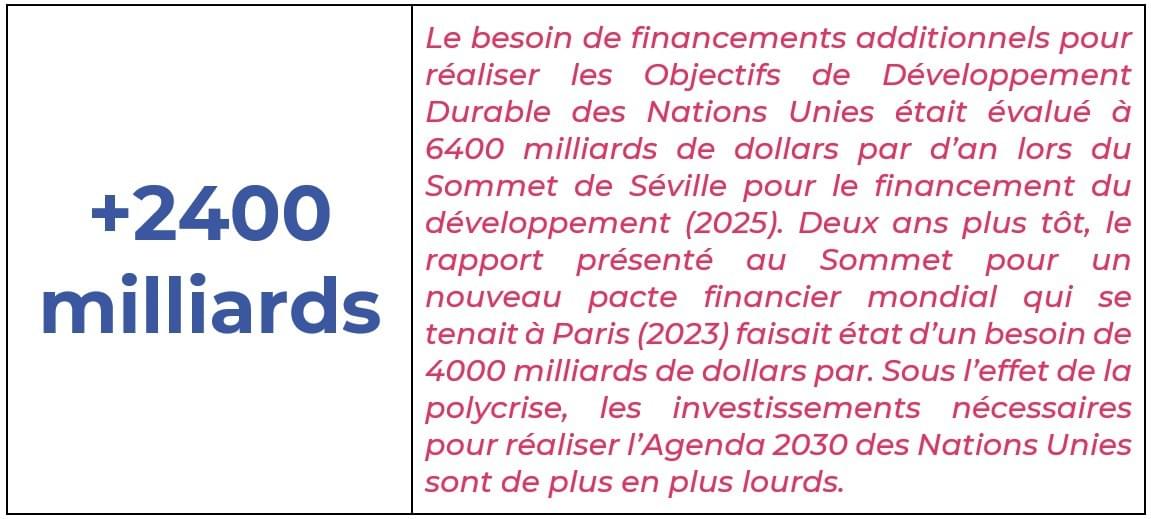
Dans cette crise du multilatéralisme, quelle place occupent les ruptures récentes de la politique étrangère de la première puissance mondiale ?
Il est parfois avancé que les États-Unis seraient structurellement peu intéressés par le multilatéralisme. Cette affirmation est fausse et ne résiste pas à l’examen des faits. Les Etats-Unis n’ont cessé d’osciller selon les périodes entre isolationnisme, avec par exemple la doctrine Monroe, et interventionnisme, avec par exemple Roosevelt, comme entre multilatéralisme, avec entre autres Wilson et Obama, et unilatéralisme avec Trump.
Ainsi, sous la présidence de Barack Obama, les États-Unis ont manifesté un soutien explicite à l’architecture multilatérale. Lorsque le président Obama a accueilli Ban Ki-moon à la Maison Blanche, il a affirmé sans ambiguïté qu’il était en faveur du multilatéralisme et qu’il croyait pour cela en l’importance de l’ONU. Le vice-président Biden partageait cette posture, et tous deux ont véritablement soutenu l’action de l’ONU en de très nombreuses occasions. La vision de Donald Trump marque donc un moment de rupture avec l’engagement politique américain de la décennie précédente en faveur du système onusien et des institutions internationales.
Simultanément, la Chine milite pour une forme alternative de multilatéralisme, marquée toutefois en premier par la défense de ses propres intérêts et des institutions qu’elle a créées.
Dans ce contexte mouvant, il est essentiel de maintenir et de renforcer les instruments existants, aussi imparfaits soient-ils : l’Union Européenne, le FMI, la Banque mondiale, l’OMS, l’OMC et bien entendu l’ONU dans toutes ses composantes. Il faut aussi renforcer la place des pays du Sud dans ces institutions, en particulier au Conseil de sécurité. À cet égard, un seul point positif pour le moment, la création actée d’un troisième siège africain au sein du board du FMI pour y renforcer leur place.
Alors qu’il célèbre son 80e anniversaire en 2025, l’ordre international hérité de 1945 est ébranlé. Les puissances moyennes qui y sont attachées, comme la France, peuvent-elles encore quelque chose face aux assauts des puissances russes, chinoises et américaines sur le système des Nations Unies ?
Au sein de l’Union Européenne, la France a un rôle particulier à jouer dans cette phase critique, compte tenu notamment de son siège permanent au Conseil de sécurité. Elle doit continuer à soutenir activement l’ONU, y compris sur des sujets aussi sensibles que l’auto-limitation du droit de veto et l’élargissement du Conseil de sécurité. Il existe encore un large champ d’action sur lequel des États comme la France peuvent faire preuve d’initiative diplomatique, en combinant volontarisme réformateur et fidélité aux principes fondamentaux du multilatéralisme.
L’ONU, bien qu’exposée à de nombreuses critiques et blocages, reste une instance unique en son genre, irremplaçable. Elle demeure le seul cadre à vocation universelle, capable entre autres d’organiser des sommets rassemblant l’ensemble des États du monde, comme c’est le cas lors de chaque séquence à haut niveau de l’Assemblée générale qui rassemble à New York toujours plus de 100 chefs d’Etat et de gouvernement et aussi comme ce fut encore le cas en juin 2025 à Nice, avec de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, près de 2000 scientifiques de haut niveau et des milliers de représentants de la société civile.
À l’occasion de son 80ème anniversaire, l’ONU s’engage dans une réforme autour d’un « Pacte pour le futur » adopté par l’Assemblée générale de l’ONU et d’un projet UN80 porté par le Secrétaire général.
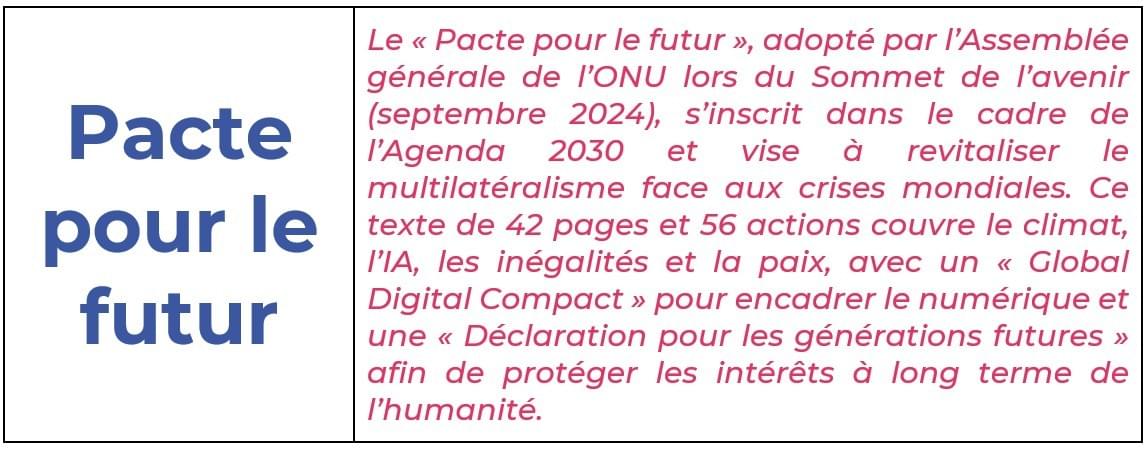
Pour comprendre l’importance historique de la crise du multilatéralisme, à quels signaux devons-nous prêter attention ?
Plusieurs signes, souvent peu visibles dans le débat public, témoignent d’un basculement en cours.
D’abord, la réduction significative de l’aide publique au développement (APD) au plan mondial constitue un symptôme très préoccupant. Ce recul intervient alors que l’aide au développement joue un rôle majeur dans la stabilisation de sociétés fragiles et dans la réduction des inégalités, dont on sait qu’elles alimentent les conflits. Le démantèlement d’instruments d’influence comme l’USAID aux États-Unis illustre bien sûr cette tendance. Alors que les Etats-Unis se replient, c’est à ce moment que l’effort de solidarité de l’Europe aurait eu le plus d’impact. Nous assistons pourtant à un recul généralisé, y compris en France (- 30 % de l’APD).
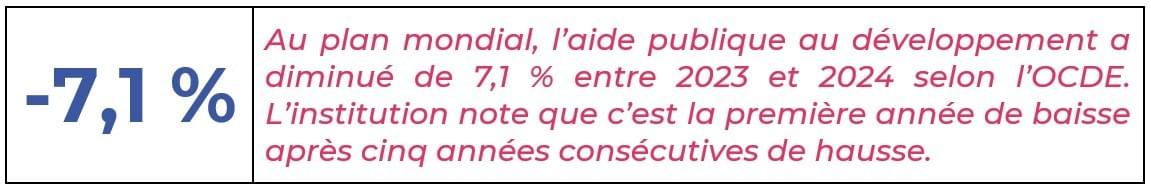
Un autre signal est la mise en péril explicite du droit international. L’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, à laquelle s’ajoute l’ambiguïté, voire le silence, de certains grands leaders qui refusent de condamner clairement cette agression. Ce silence, notamment du côté de Trump, accentue la légitimation implicite de la force comme moyen de règlement des différends.
Ces tendances lourdes illustrent la remise en cause du projet imaginé et déployé à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
Comment cette remise en cause du système multilatéral, des fondamentaux de la coopération internationale et de ses principes juridiques fondateurs peut-elle évoluer à horizon 5 ans ?
Plusieurs horizons se dessinent.
Un scénario régressif s’illustrant par la montée en puissance de leaders autoritaires, par la banalisation de l’usage de la force et par la paralysie des institutions internationales pourrait conduire à un désordre mondial durable, structuré par des logiques de blocs antagonistes. L’époque actuelle est en effet marquée par un gouvernement Trump qui met tout en œuvre pour revenir à un système unilatéral, tout comme la Russie de Poutine. Certes la Chine prône encore un système multilatéral mais suivant ses propres règles.
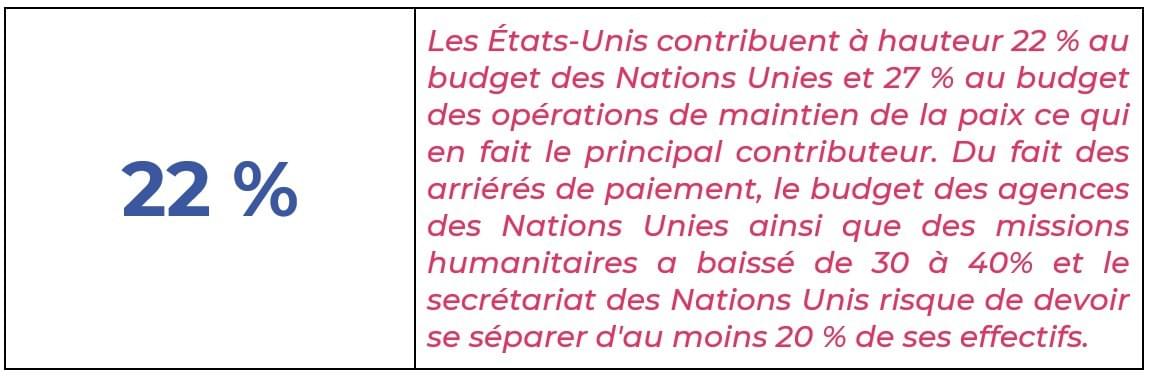
À l’inverse, un scénario de résilience -certes moins probable- peut être espéré et pourrait voir émerger des coalitions d’États, portées notamment par l’Union européenne, décidant de relancer un multilatéralisme rénové, articulé autour de valeurs communes.
En quoi la crise du multilatéralisme constitue-t-elle un élément central de la crise géopolitique, et donc de la polycrise ?
L’ébranlement des institutions internationales est une composante fondamentale de la polycrise actuelle.
La paralysie récente du Conseil de sécurité, notamment par l’usage répété du droit de veto (à titre d’exemple, 17 vétos russes dans le seul cas syrien), empêche la prévention ou la résolution des crises.
Pourtant, entre 1989, date de la fin de la guerre froide et 2011, date de l’intervention en Libye très critiquée par la Russie, la quasi-totalité des crises ont été traitées au sein du Conseil de sécurité, avec seulement deux exceptions importantes, l’opération de l’OTAN contre la Serbie en 1999 et l’invasion américaine en Irak en 2003.
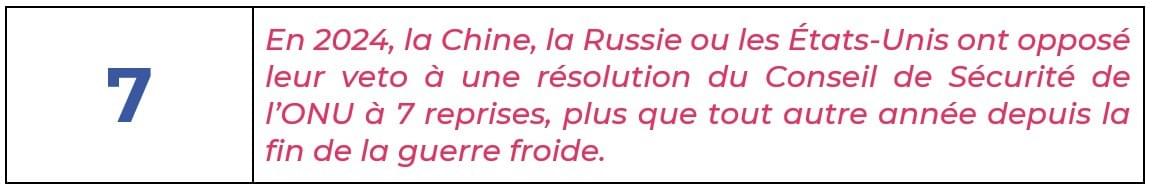
Il est courant d’entendre que la Cour pénale internationale (CPI) n’est pas efficace et qu’elle ne condamne que des dirigeants de pays du Sud ; cette assertion s’est révélée fausse, puisque son institution sœur, le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, a condamné plusieurs dirigeants issus de cette région et que la CPI elle-même a mis en examen des dirigeants issus d’Europe et du Moyen-Orient. La CPI gagne du terrain mais elle est tout de même fragilisée dans un contexte où les trois « grands », États-Unis, Chine et Russie, refusent toujours d’en être membres. Ce refus révèle une contestation plus large des fondements du droit international.
Quels points d’inflexion historique pourraient infléchir cette tendance à la brutalisation du monde par l’effondrement de la coopération internationale ?
L’instauration d’un ordre juridique international fondé sur la coexistence et la souveraineté des Etats prend ses racines au XVIIe siècle, notamment avec des penseurs comme Hugo Grotius dès 1630. Le Traité de Westphalie en 1648 est un premier exemple de solutions fondées sur des principes de droit international. Puis de nombreux progrès dans ce sens ont été réalisés, avec notamment en 1919 la création de la Société des Nations et bien sûr en 1945 celle de l’Organisation des Nations Unies.
Face aux attaques actuelles contre le droit international, certaines évolutions positives restent possibles. Un changement politique aux États-Unis pourrait relancer une dynamique de coopération fondée sur les normes et les institutions internationales. Parallèlement, l’Union européenne a une responsabilité particulière : celle de faire valoir le droit international, en assumant clairement que défendre l’Ukraine ou Gaza revient à défendre les principes de la Charte des Nations unies.
La France, dans ce contexte, a un rôle singulier à jouer. En complément de son action pour renforcer le rôle de l’Union européenne, elle doit entretenir et développer ses relations bilatérales avec les membres dits du Sud global, notamment les membres des BRICS, malgré les différences très marquées qui divisent ce groupe.
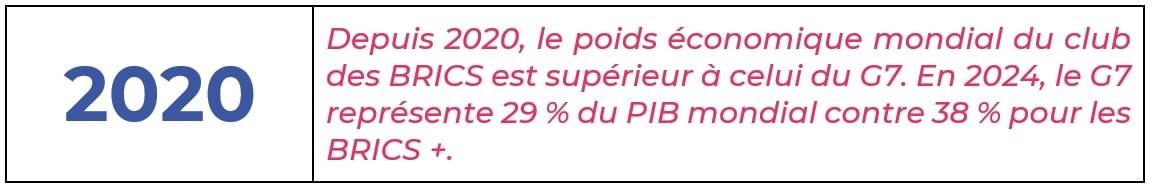
Dans ce paysage très mouvant, la réforme de la gouvernance globale ne pourra se faire sans impliquer les pays du Sud, souvent sous-représentés dans les structures existantes. Il faut donc renforcer le travail diplomatique avec ces États.
Cette crise du système multilatéral, qui s’inscrit dans un contexte géopolitique lourd, laisse-t-elle de la place à d’autres acteurs que les puissances elles-mêmes ?
La crise du multilatéralisme traditionnel ouvre toutefois un espace pour repenser la gouvernance mondiale selon une logique plus ouverte, plus inclusive, et surtout multi-acteurs. Il devient en effet évident que les États ne sont plus les seules entités à exercer une grande influence sur les affaires du monde.
Par exemple parmi les grandes entreprises transnationales certaines disposent aujourd’hui de produits intérieurs bruts supérieurs à ceux de nombreux États. Leur influence sur les chaînes de valeur, sur les normes techniques, mais aussi sur les dynamiques sociales et environnementales en font également des acteurs systémiques.
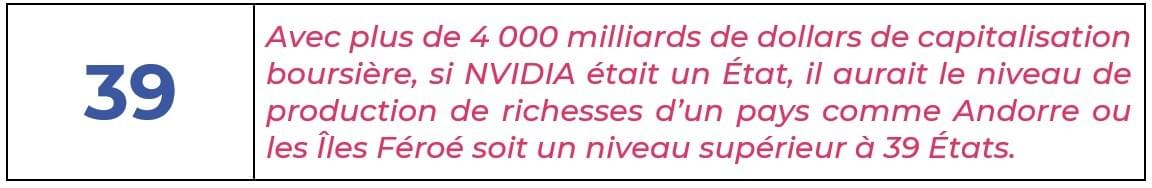
En parallèle, la société civile, organisée sous toutes ses formes, ONG internationales, syndicats, associations, mouvements transnationaux, joue un rôle croissant dans la formulation des normes, l’évaluation de leur mise en œuvre, et l’alerte publique. Ces organisations, plus agiles que les institutions interétatiques, contribuent à faire émerger des standards sociaux, éthiques ou environnementaux là où les États peinent à s’accorder.
Les collectivités locales et les grandes métropoles représentent également un échelon déterminant. Elles sont confrontées aux effets directs des crises (climatiques, sanitaires, migratoires) et sont aussi capables d’expérimenter localement des formes nouvelles de gouvernance, de coopération transfrontalière ou de diplomatie territoriale.
Ce tournant vers une gouvernance multi-acteurs n’est pas totalement nouveau. Il s’est amorcé, de manière exemplaire, lors de la création en 2002 du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette structure a innové en instituant un conseil d’administration où siègent non seulement les États donateurs et récipiendaires, mais aussi des représentants des ONG, de la société civile et des entreprises. Ce modèle hybride a démontré qu’une gouvernance partagée pouvait produire des résultats efficaces et durables.
Ainsi, le moment que nous traversons ne doit pas seulement être vu comme une crise des institutions existantes, mais aussi comme l’opportunité d’élargir et de refonder le cercle des légitimités, en intégrant à la gouvernance mondiale une pluralité d’acteurs capables d’agir, de coopérer, et de rendre des comptes dans l’intérêt général.
Comment cette crise du multilatéralisme entre-t-elle en résonance avec les autres pans de la polycrise ?
L’ébranlement des institutions et des normes internationales est intimement lié aux trois autres grandes dimensions de la polycrise : la crise écologique, la crise socio-économique, et la crise politique et morale. Il agit à la fois comme facteur aggravant et comme symptôme de ces désordres systémiques.
Ainsi, pour répondre à ce point, il est nécessaire de revenir au « paradoxe » de départ qui illustre que sur les grands sujets, il y a un besoin d’organisations fortes mais qui à l’heure actuelle sont faibles. Plusieurs grandes organisations peuvent illustrer ce lien avec les différents grands enjeux.
Sur le plan écologique, les négociations internationales autour du climat, à travers les COP, montrent avec force ce paradoxe. Jamais l’urgence environnementale n’a été aussi largement reconnue ; jamais, pourtant, les instruments de coordination n’ont paru aussi faibles, fragmentés, ou dépendants des volontés nationales. Le cadre multilatéral existe, mais il reste largement impuissant à imposer des règles contraignantes ou à garantir leur application, faute d’instances fortes, dotées de légitimité et de moyens coercitifs.
Sur le plan socio-économique, la situation est similaire. L’OMC, le FMI et la Banque mondiale ont été pensés comme des piliers d’un ordre économique régulé, mais leur capacité à garantir un commerce équitable, une stabilité financière ou une réduction des inégalités globales est aujourd’hui mise en cause. Ces institutions, souvent perçues comme dominées par les pays du Nord, ne parviennent pas à incarner un véritable équilibre global. Le ressentiment à leur égard, notamment dans les pays du Sud, alimente la contestation des normes existantes et renforce les appels à un système plus juste, ou à des alternatives hors système.
Enfin, sur le plan politique et moral, la crise des normes internationales reflète une perte de confiance dans les principes de droit, d’universalisme et de coopération. L’affaiblissement du droit international humanitaire, la paralysie du Conseil de sécurité, ou encore l’impunité croissante de certains régimes violent directement les fondements éthiques sur lesquels reposait, au moins en partie, l’ordre multilatéral d’après-guerre.
Ce paradoxe est d’autant plus frappant que les défis actuels exigent précisément des institutions fortes, alors même que celles-ci s’effondrent ou se replient. Nous vivons une situation où le besoin de régulation mondiale est maximal, mais où la capacité effective de coordination est minimale.
Dans ce contexte, l’Europe, et en particulier l’Union européenne, continue de porter une vision du monde fondée sur le droit, la coopération et les biens publics globaux. Cette posture est mise à l’épreuve par la montée des régimes autoritaires, mais aussi par les limitations internes des démocraties elles-mêmes. Toutefois, malgré les attaques contre leurs fondements, les démocraties, notamment en Europe et aux États-Unis, restent fonctionnelles. Elles conservent des institutions capables de s’adapter, de débattre, de rendre des comptes, autant d’atouts décisifs pour affronter la polycrise.
Là où les institutions internationales faiblissent, il revient donc aussi aux systèmes nationaux et régionaux, notamment européens, de prendre le relais, en assumant une part plus directe de la gestion des biens communs : climat, justice sociale, paix, cohésion politique. En ce sens, la crise des normes internationales n’est pas isolée : elle est le miroir et l’amplificateur des autres crises systémiques en cours.
En quoi cette crise du multilatéralisme contribue-t-elle à une véritable bascule de l’Histoire ?
L’enjeu de l’ébranlement des institutions internationales s’inscrit pleinement dans un changement d’époque, une rupture stratégique dont les premiers signes remontent au moins à 2014. Cette année-là marque une inflexion majeure avec l’annexion de la Crimée par la Russie, une violation flagrante du droit international, restée largement impunie sur la scène multilatérale. L’incapacité du Conseil de sécurité de l’ONU à condamner fermement cet acte, en raison du veto russe, a révélé la profondeur du dysfonctionnement des institutions censées garantir la stabilité du système international.
Ce tournant historique a été renforcé et amplifié par l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Dès son premier mandat, Trump a manifesté un mépris assumé pour les organisations multilatérales, se retirant de plusieurs accords internationaux majeurs (Accord de Paris sur le climat, OMS, UNESCO, etc.) et remettant en cause l’utilité même des alliances traditionnelles. Ce désengagement n’a pas seulement affaibli les structures existantes : il a donné un signal clair que la première puissance mondiale n’entendait plus jouer selon les règles collectives.
Nous sommes ainsi confrontés à un moment charnière où la contestation active du multilatéralisme par certains acteurs majeurs risque de faire basculer l’ensemble du système dans un nouvel ordre international, moins stable, plus fragmenté, et potentiellement plus violent.
En France et en Europe, nos institutions sont-elles adaptées pour traverser cette crise géopolitique ?
Face à l’ébranlement des normes internationales, les institutions françaises et européennes apparaissent, à bien des égards, comme relativement bien armées. La Constitution française, d’abord, a prouvé sa souplesse et sa capacité d’adaptation à des contextes géopolitiques changeants. Elle a permis à l’exécutif, notamment dans le domaine des affaires étrangères, de prendre des initiatives fortes. Cette plasticité institutionnelle constitue un atout pour faire face aux crises multiformes qui caractérisent la période actuelle.
De la même manière, les institutions européennes, bien qu’imparfaites et parfois perçues comme lentes ou technocratiques, jouent un rôle croissant sur la scène internationale. Elles évoluent progressivement, en s’améliorant d’année en année, dans leur capacité de réaction. Des progrès notables ont été réalisés en matière de coordination diplomatique, de politique climatique commune, ou encore de solidarité financière, comme en témoignent les plans de relance post-Covid ou les sanctions coordonnées à l’égard de régimes autoritaires. L’Union européenne dispose donc d’une base institutionnelle solide pour contribuer à la refondation du multilatéralisme.
Toutefois ce potentiel est principalement sous-exploité : il ne suffit pas de disposer d’institutions fonctionnelles, encore faut-il les investir d’un rôle stratégique clair dans la définition de l’ordre international à venir. Sur les grandes questions de gouvernance mondiale, climat, paix, migrations, finance, numérique etc., l’Europe peut et doit devenir une puissance de proposition, capable de porter des réformes ambitieuses tout en maintenant un attachement résolu aux normes partagées.
Selon vous, les dirigeants publics français et européens sont-ils armés correctement pour affronter la brutalisation du monde ?
Ce qui fait défaut, ce n’est pas tant la culture ou la capacité, mais bien la volonté politique. Le déficit ne tient pas à l’incapacité de nos responsables à penser l’échelle mondiale, mais à leur difficulté à inscrire cette réflexion dans leurs priorités concrètes.
Trop souvent, les dirigeants, à Bruxelles comme dans les capitales nationales, privilégient la gestion des enjeux à court terme : dette, inflation, sécurité intérieure, gestion de crises immédiates. La question de la gouvernance mondiale, pourtant déterminante pour la stabilité future, reste marginale dans les programmes, reléguée derrière des urgences nationales ou électorales à court terme.
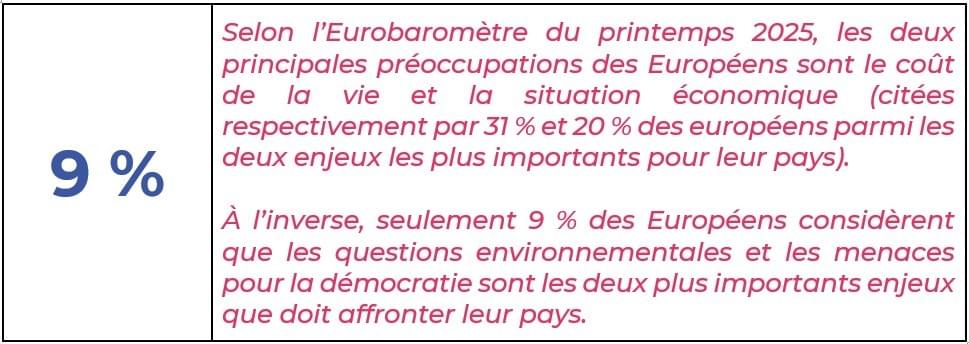
Au sein de l’Union européenne, cette tension est particulièrement visible. Chaque État membre tend à défendre en premier ses propres intérêts stratégiques, économiques ou politiques, ce qui freine l’émergence d’une position commune et cohérente sur la scène internationale. Le collectif européen souffre ainsi parfois d’un défaut de solidarité et d’un cruel manque vision à long terme, pourtant indispensables pour peser dans les débats sur l’avenir des institutions globales. Le rapport Draghi est heureusement là pour réveiller les consciences.
Les termes du débat public permettent-ils de mieux aborder ces questions d’ici aux prochaines échéances démocratiques en France et à la fin de l’Agenda 2030 des Nations Unies ?
À l’heure actuelle, les termes du débat public, en France comme à l’échelle européenne, ne sont guère à la hauteur des enjeux liés à l’effondrement partiel du multilatéralisme et à la nécessaire refondation des normes internationales. Le sujet de la gouvernance mondiale, pourtant central pour comprendre et anticiper les dynamiques de la polycrise, reste largement marginal dans les campagnes électorales, les programmes politiques, ou les grands débats médiatiques.
Un exemple frappant est celui des récentes élections européennes. À aucun moment, ou presque, la question de la place future de l’Union dans le système international n’a été traitée de façon approfondie par les candidats. L’Europe a été trop peu présentée comme une puissance diplomatique, normative ou institutionnelle capable de peser sur la scène mondiale. Il y a là une faiblesse structurelle du débat politique européen : l’incapacité à inscrire les questions internationales et de long terme dans une narration mobilisatrice et prospective.
Face à ce vide, les think tanks, les milieux académiques et les acteurs de la société civile devraient jouer un rôle moteur. Ils ont la responsabilité d’exiger des partis politiques qu’ils se positionnent de manière plus explicite sur les grands enjeux de gouvernance globale. Il ne s’agit pas simplement d’ajouter une rubrique « international » dans un programme électoral, mais de formuler des propositions concrètes, crédibles et ambitieuses pour réformer les institutions multilatérales, renforcer le rôle de l’Europe dans leur pilotage, et défendre des principes de droit, de justice et de coopération à l’échelle globale.
Quelles innovations institutionnelles ou politiques faudrait-il envisager pour répondre à cet enjeu à moyen terme ?
À moyen terme, il ne paraît pas nécessaire d’engager une réforme constitutionnelle pour que la France puisse répondre efficacement à la crise actuelle du multilatéralisme. La Constitution française a déjà démontré à plusieurs reprises sa capacité d’adaptation et sa souplesse face aux évolutions de la scène internationale. Aucun changement fondamental de son architecture ne semble requis pour renforcer l’action de la France en faveur de la gouvernance mondiale.
En revanche, du côté de l’Union européenne, plusieurs améliorations concrètes pourraient être envisagées de façon réaliste, sans attendre un nouveau traité, dont l’élaboration et la ratification prendraient sans doute une décennie. Il existe une marge de manœuvre institutionnelle qui permettrait d’agir dans le cadre existant.
Une première piste consisterait à réduire le nombre de commissaires européens, aujourd’hui trop élevé, ce que permet le traité de Nice. Une Commission plus restreinte, mieux structurée, permettrait de renforcer sa cohérence politique, son efficacité et sa visibilité. Ce type de réforme, à la fois technique et symbolique, pourrait redonner du poids à la Commission en tant qu’exécutif européen crédible dans les négociations internationales.
La question du statut du président de la Commission européenne revient également régulièrement dans les débats, notamment pour savoir s’il devrait ou non fusionner avec celui du président du Conseil européen. Cette interrogation mérite d’être posée, mais elle ne constitue pas un levier décisif à court terme. L’enjeu le plus important réside moins dans les figures institutionnelles que dans la capacité collective des États membres à donner un poids politique accru à l’Union sur la scène mondiale.
Si les États membres acceptaient d’apporter une légitimité plus forte, un mandat plus clair et des compétences plus affirmées à l’Union Européenne dans les affaires internationales, alors celle-ci pourrait jouer un rôle moteur dans la refondation des normes globales. Cette approche pragmatique, consistant à renforcer l’Europe par des ajustements ciblés plutôt que par des ruptures juridiques, semble la plus réaliste.
Si vous deviez formuler un pari stratégique ou une intuition forte sur l’évolution de cet enjeu, lequel serait-ce ?
Face à la montée des risques globaux, et notamment à la probabilité de nouvelles pandémies, deux scénarios se dessinent. Le premier est celui d’une prise de conscience à froid, qui interviendrait avant que le seuil de rupture ne soit atteint. Ce scénario suppose un sursaut stratégique, une volonté de coordination anticipée, et une reconnaissance lucide des interdépendances mondiales. Le second, plus probable à court terme, est celui d’une réaction à chaud, lorsque les crises atteindront un niveau tel qu’elles rendront inévitable la mise en place de mécanismes de coopération renforcée. Mais cette réaction sur le tard risque d’être plus coûteuse, plus chaotique, et moins inclusive.
Dans les deux cas, la conclusion reste la même : la politique commune deviendra indispensable. Le monde multipolaire dans lequel nous entrons ne pourra pas s’organiser durablement sans un minimum de règles, de structures et de décisions collectives. La seule incertitude réside dans le moment et la manière dont cette coordination émergera, par la raison ou par la nécessité.
La crise du multilatéralisme laisse-t-elle de la place pour une refondation du système international dans les années à venir ?
L’élaboration d’institutions et normes internationales s’inscrit dans une longue histoire, celle des tentatives humaines d’ordonner les relations entre puissances, de prévenir les conflits, et de produire des cadres communs à l’échelle du monde.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’ONU a incarné l’espoir d’un ordre nouveau fondé sur le droit, la coopération et la paix. Elle a accompagné la sortie du colonialisme, la décolonisation, la coexistence Est-Ouest, puis la mondialisation. Mais aujourd’hui, cet ordre vacille.
Il convient donc, sans oublier l’apport potentiel des autres grands acteurs que sont par exemple les organisations de la société civile et les grandes entreprises, de réformer et parfois de refonder les instruments et institutions de coopération internationale au minimum autour de coalitions de pays volontaires à travers des alliances pour le multilatéralisme selon les différents types de sujets et pour les questions à vocation universelle de réformer le fonctionnement de l’ONU, institution irremplaçable puisque seule institution existante à vocation universelle, afin de la rendre plus efficace, plus inclusive, plus représentative, notamment en réformant l’usage du droit de véto et en élargissant le Conseil de sécurité.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».
