« La crise de l’eau symbolise la polycrise car elle relie toutes ses dimensions écologiques, géopolitiques et socio économiques. La réponse ? Une hydrologie stratégique » alerte Emma HAZIZA
« La crise de l’eau symbolise la polycrise car elle relie toutes ses dimensions écologiques, géopolitiques et socio économiques. La réponse ? Une hydrologie stratégique » alerte Emma HAZIZA
Entretien intégrée à la partie « Crise écologique » de l'étude « Comprendre la polycrise »
Emma Haziza, hydrologue et présidente du Mayane Resilience Center, met en garde : la crise de l’eau n’est plus un enjeu sectoriel – elle est devenue la matrice de la polycrise. Ressource vitale, commune, stratégique, l’eau conditionne l’extraction des métaux critiques, l’équilibre des systèmes agricoles, la stabilité sanitaire et le fonctionnement des chaînes industrielles. Son absence déplace des frontières, déstabilise des régimes, fracture les sociétés. L’Europe reste aveugle à cette bascule, faute d’avoir placé l’hydrologie au cœur de sa stratégie de développement économique. Les points de rupture s’accumulent – sécheresses éclair, conflits d’usage, inefficacité des réponses technocratiques. Sortir de cette impasse suppose une réelle bifurcation stratégique : repenser l’aménagement, la transition et la puissance publique à partir du cycle de l’eau.

Quelles sont, selon vous, les ressources les plus critiques dans la décennie à venir ?
La ressource en eau est le socle fondamental de toutes les autres ressources. Elle est nécessaire pour extraire du pétrole, du lithium, pour l’activité minière, agricole, industrielle. Il n’existe pas d’activité humaine « sèche » : toute ressource passe par un usage de l’eau, qu’elle soit superficielle ou souterraine. Ce qui rend l’eau centrale pour comprendre les tensions autour des autres ressources.
Un exemple frappant est celui de la Chine en 2021 : une sécheresse historique sur la rivière des Perles a forcé la mise à l’arrêt de la production hydroélectrique faute d’eau dans les barrages, engendrant une fermeture des usines deux jours par semaine et affectant la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour compenser, la Chine, coincée entre cette restriction d’alimentation électrique, la flambée des prix du charbon, et faute d’alimentation en gaz par les pipelines russes s’est retrouvée dans l’obligation d’importer du gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar. Cela a sans aucun doute précipité le rapprochement stratégique Chine-Russie dans une période sous tensions avec le conflit ukrainien et le refus de l’Europe de se fournir en gaz russe.
Un autre exemple frappant : le fleuve Silala, entre la Bolivie et le Chili. Initialement détourné au début du 19ᵉ siècle depuis la Bolivie vers le Chili pour, notamment aujourd’hui, l’extraction du lithium dans le désert d’Atacama, cette ressource est tout à coup devenue stratégique pour la Bolivie après plusieurs années de sécheresses sévères dans une région humide qui n’avait historiquement jamais eu à faire face au manque d’eau.
Le différend a dû être réglé devant la Cour internationale de La Haye.
Ces exemples montrent à quel point des pays humides jusque-là peuvent très rapidement basculer dans des situations de tensions inédites, rejouant les rapports d’alliances stratégiques avec leurs voisins.
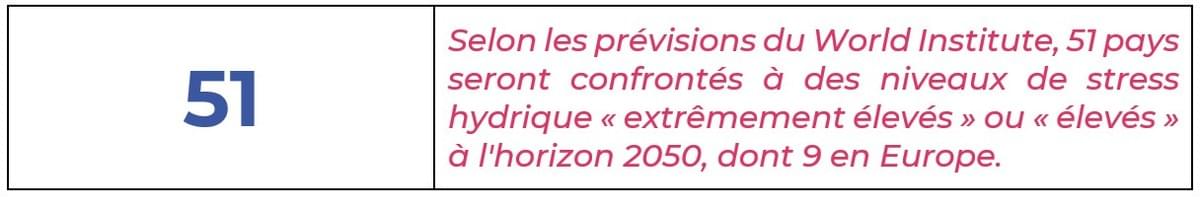
Avez-vous observé une montée des tensions géopolitiques ou territoriales autour de ces ressources ?
Oui, mais de manière diffuse. Exemple : en 2022, l’Inde a cessé d’exporter son blé à cause d’une canicule à 52°C. Cette décision, combinée à la crise du blé ukrainien, a affecté l’approvisionnement de nombreux pays (Maroc, Tunisie, Algérie), très dépendants de ces importations d’ « eau virtuelle » (i.e. l’eau contenue indirectement dans les produits agricoles).
Ces tensions sont réelles, mais chaque pays gère encore à son échelle. Il y a une absence flagrante d’anticipation globale. Contrairement à 1988, où la Chine avait acheté massivement du blé à l’international pour contrer un risque de famine de sa population après une année de sécheresse historique, aujourd’hui très peu d’États anticipent ce type de choc.
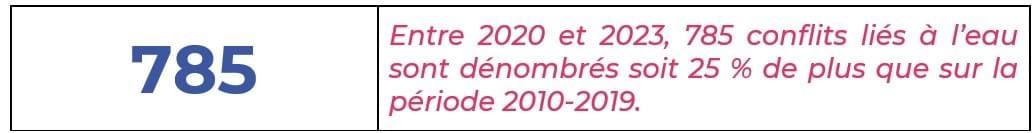
La mission satellitaire GRACE-FO de la NASA et de l’Agence spatiale allemande a montré que 75 % des nappes phréatiques mondiales sont surexploitées. Certaines nappes fossiles ne se rechargeront jamais. D’autres nappes superficielles, comme celles du Middle West américain, ont tellement surexploité leur ressource que 2 700 ans de pluie seraient nécessaires pour permettre une recharge.
Un signal clair a été mis en avant par une recherche récente en géophysique, qui en soi est extrêmement frappant et doit nous interroger sur nos façons d’extraire les ressources de la planète sans compter : en vingt ans, l’axe de rotation de la Terre s’est déplacé de 80 cm vers l’est, et l’une des principales raisons en est l’extraction massive des nappes souterraines.
Sur cette crise de l’eau, qui est à la confluence entre crise écologique et crise géopolitique, quels signaux faibles pourraient indiquer un basculement vers des conflits ouverts ?
L’ensemble des chaînes de production alimentaire et textile (ex : fast fashion et coton) repose sur des détournements massifs d’eau dans des zones arides. L’exemple de l’Ouzbékistan, avec le détournement de l’eau des fleuves de la mer d’Aral par Staline pour cultiver le coton, est emblématique : aujourd’hui, ce territoire est en crise hydrique majeure. On continue pourtant à en dépendre pour notre consommation textile mondiale.
Depuis 2017, les sécheresses s’aggravent, mais les excès ponctuels d’eau (rivières atmosphériques, El Niño) masquent la profondeur du phénomène. On observe désormais des « sécheresses éclair », avec des bascules de situation en quelques jours. En France, par exemple, le printemps pluvieux de 2018 suivi de 3 semaines de canicule a suffi à provoquer une sécheresse pire que l’année précédente, qui avait été considérée comme historique. Ces changements ne sont pas anticipés par les pouvoirs publics ni les entreprises. C’est ce manque de préparation qui pourrait déclencher les tensions avec des effets domino non maitrisés.
Comment qualifieriez-vous la position actuelle de la France et de l’Europe dans la géopolitique des ressources critiques ?
La France avance puis recule. L’exemple des « bassines » est symptomatique : on prélève de l’eau de nappes protégées pour la stocker dans des retenues à l’air libre, favorisant la prolifération de bactéries, la perte de biodiversité, des risques sanitaires (salmonelles, algues toxiques) et des conflits d’usage. Ce système est inefficace, et pourtant financé publiquement, parfois en contradiction avec les décisions préfectorales. D’autres solutions avérées efficaces et moins couteuses ont fait leur preuve mais bien souvent les combats deviennent idéologiques et politiques là où il ne devrait y avoir que du pragmatisme. Ces postures engendrent des freins à la généralisation de ces solutions.
Faut-il accélérer la diversification des sources, les partenariats stratégiques, ou la relocalisation des chaînes d’approvisionnement ?
Oui, mais cela suppose de repenser la planification à partir de l’eau. Il me semble nécessaire d’intégrer l’hydrologie satellitaire dans la stratégie nationale. Les pays qui maîtriseront cette technologie domineront demain la diplomatie de la résilience. Le pilotage par la donnée, croisée avec les systèmes d’alerte hydrologique (GRACE-FO, SWOT), est fondamental.
La crise de l’eau articule parfaitement crise écologique et crise économique. Dans ce contexte, comment gérer la tension entre besoins industriels massifs pour la transition et dépendances géopolitiques ?
Les systèmes d’anticipation actuels sont obsolètes. On continue à investir dans des sites industriels sans prendre en compte la ressource en eau disponible. On a vu des entreprises françaises s’implanter en Inde récemment par le rachat d’usines dans des zones comme le Gujarat déjà totalement asséchées. L’eau y est livrée par camion-citerne 15 à 20 fois par jour. Certains agriculteurs préfèrent vendre leur eau que leurs récoltes. Sans stratégie de restauration des nappes et gestion écosystémique de la ressource, on ira dans le mur tant pour ces pays qui voient des migrations forcées de paysans vers les bidonvilles que pour nous qui misons sur des stratégies courtermistes.
Cette crise de l’eau est à l’interface entre crise écologique et crise politique : quelles formes de compétition ou de conflit voyez-vous émerger sur les territoires ?
La crise dite « des bassines » est très symptomatique. Son émergence s’inscrit dans un contexte historique particulier.
En 1976, la France subit une sécheresse historique. L’État impose en conséquence un impôt « sécheresse », mal reçu par les Français. Les textes réglementaires qui vont suivre vont renforcer la préservation de la ressource par l’interdiction de l’irrigation en période de crise, sauf dans les cas de stockages déconnectés de la ressource comme les lacs et retenues collinaires.
À partir de 2017, la sécheresse devient structurelle et une grande partie du territoire métropolitain se retrouve en situation de crise. Les agriculteurs se retrouvent à court de solution face à l’interdiction élargie de l’irrigation dont certaines cultures dépendent.
De là émerge l’idée d’une solution alternative pour prélever l’eau souterraine durant la période hivernale, avant tout risque d’interdiction, pour la stocker et l’utiliser durant la phase estivale.
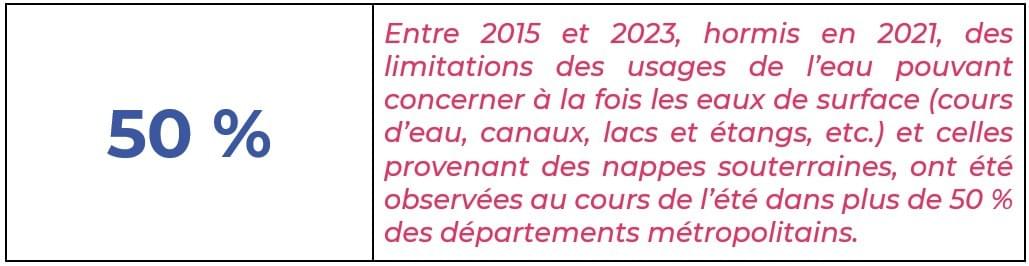
Mais cette logique détourne l’eau avant qu’elle ne recharge les rivières et soit utilisée par tout le milieu naturel, notamment les sols, durant la phase printanière. Résultat : des assecs plus rapides, des signes d’atteintes à la biodiversité locale, et une solution, les retenues de substitution dites « bassines » engendrant de nouveaux risques liés à un stockage à ciel ouvert d’eau croupissante : déploiement du moustique tigre, risque de contamination par des cyanobactéries et des salmonelles, ainsi qu’un développement algal rendant inexploitable les stations de pompage en quelques années, faute d’intervention humaine.
Elles privatisent également l’accès à l’eau, de par les choix de localisation et privilégiant les grandes exploitations avec un fort potentiel économique. On se retrouve donc face à un enjeu d’inégalité de partage de la ressource, un sujet de conflit que l’on connait bien mais plutôt dans des pays arides.
Pour faire face à cette double crise écologique et politique, quels outils ou dispositifs pourraient améliorer l’arbitrage démocratique de ces conflits d’usage de l’eau ?
Des solutions locales fonctionnent dès lors qu’on intègre que la résilience agricole passe par le fait de retrouver la verticalité du cycle de l’eau, c’est-à-dire d’augmenter les capacités d’infiltration des sols. Cela passe par des moyens qui ralentissent la pente et optimisent le temps de passage de l’eau ruisselée sur un terrain.
Ces systèmes répondent autant aux enjeux que présentent les villes imperméabilisées, bitumées, de plus en plus confrontées à des situations caniculaires, qu’à ceux des parcelles agricoles, bien trop souvent compactées par des années d’usage d’intrants et par l’emploi d’engins toujours plus massifs. La question du microbiote des sols et de l’aération naturelle par les écosystèmes est aussi absolument essentielle et doit être optimisée. Des exemples prégnants de ces pratiques en France, qui ont fait leurs preuves en matière de résultats obtenus malgré les sécheresses récurrentes récentes, ont permis de mettre en évidence à quel point c’est la voie à suivre.
Ces techniques sont encore bien loin d’être généralisées alors que l’on est actuellement dans une tendance grandissante à la gestion de ces situations de crise. L’État finance encore des retenues de substitution trop souvent inefficaces, parfois contre l’avis des préfets. Il faut une stratégie cohérente, globale, qui parte du sol, de la topographie, des enjeux stratégiques et économiques territoriaux et qui investit dans les bonnes pratiques.
Pour faire face à la crise de l’eau, le concept de « sobriété en ressources » vous semble-t-il mobilisable à grande échelle ?
« Sobriété » est devenu un mot-valise trop utilisé et que rebute le grand public, il est associé en France à une période de crise nécessitant de grands efforts individuels. Il me semble que ce qui est nécessaire, c’est le passage à l’ère des solutions tangibles, concrètes et adaptées à chaque enjeu et chaque territoire.
Par exemple :
● La réutilisation des eaux usées semble être une voie miracle mais nous n’avons jamais été un pays aride et si nous n’avons pas d’avances sur des pays comme Israël et l’Espagne, c’est tout simplement dû au fait qu'eux sont au pied du mur en matière d'aridité depuis plus de 20 ans. Et c'est à coup d'efforts acharnés de R&D qu’ils ont réussi à ouvrir de nouvelles voies d’innovations. En France, il reste encore beaucoup de frein à la généralisation, des solutions trop couteuses, maladaptées et sur certains territoires en crise, de vraies réponses apportées par la réuse. Ce qui est sûr c’est qu’il faut éviter les généralisations de solutions magiques fondées uniquement sur la technologie sans une remise en cause profonde de nos systèmes de sociétés, depuis nos modèles énergétiques aux systèmes industriels.
● La désalinisation fait partie de cette myriade de solutions brandies comme magiques. Il ne faut pas oublier les coûts cachés de l’emploi de telles solutions sur le coût énergétique, l’usage de produits chimiques avec des impacts directs sur la biodiversité des cordons littoraux.
● Enfin, l’ensemencement des nuages (Maroc, Dubaï) mesemble être la solution magique la plus dangereuse. L’usage de l’iodure d’argent pour accroître la production des pluies reste problématique : une molécule neurotoxique pour les systèmes aquatiques rémanentes dans les sols avec des effets avérés sur la santé humaine … cela nécessité une prise de recul et une réflexion de fond sur la mise en danger des populations.
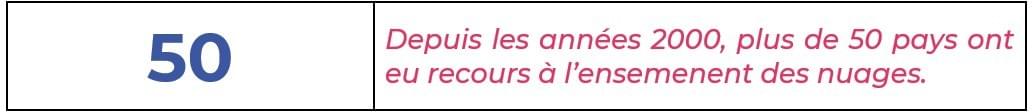
Toutes ces « solutions magiques » ont donc des limites, et pas anecdotiques. Il faut donc une réflexion stratégique systémique et non pas des slogans et des phrases toutes faites pour apaiser les populations et leur faire croire que l’on saura gérer toutes les crises. Ce dont on a le plus besoin est sans aucun doute du courage et de la lucidité sur ce qui nous attend.
Autour de cette crise de l’eau, comment s’agence les grands pans de la polycrise ?
Autour de cette crise de l’eau s’articulent les grands pans de la polycrise.
Tout est lié : le climat, la santé mentale, l’agriculture, le social.La vapeur d’eau est le premier gaz à effet de serre : elle rend la Terre habitable, mais joue un rôle très particulier en amplifiant l’impact du CO₂. L’évaporation massive, due à l’irrigation, à l’artificialisation des sols, au béton et au bitume, combinée à la disparition des zones tampons naturelles comme les zones humides et les sols fertiles, accroît encore la perte d’humidité atmosphérique et les déséquilibres du cycle de l’eau. Dans un contexte d’augmentation continue des températures, le défi est colossal. En 2022, l’Europe a connu 64 000 décès liés aux vagues de chaleur, dont 5 000 en France, et encore 46 000 en 2023. Et pourtant, bien que nous ayons aujourd’hui le plan Eau ou encore les plans d’adaptations climatique, il n’existe toujours aucune stratégie nationale de prévention globale de gestion de ces crises futures.
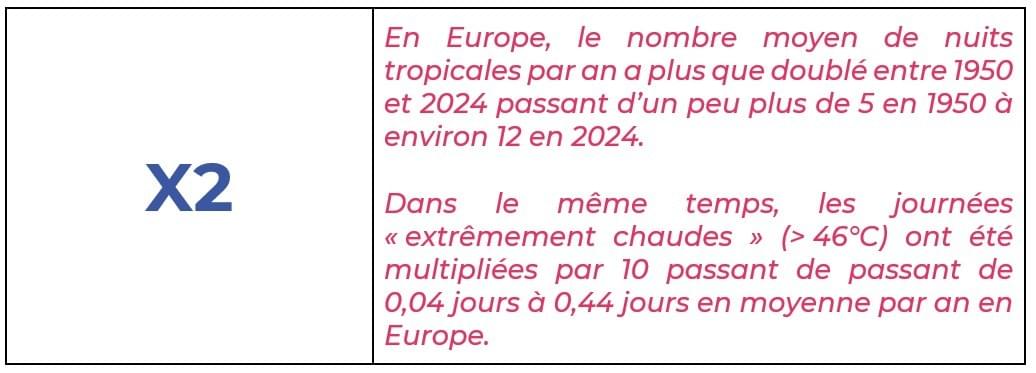
Les îlots de chaleur aggravent tout : santé mentale, suicides (Santé publique France montre une corrélation directe entre température et taux de suicide). Les 25 milliards d'euros de coûts dus aux excès de chaleur (2015–2020) auraient pu servir à aménager les villes, ventiler les bâtiments, anticiper. Mais on n’a pas cette vision. L’adaptation n’est pas pensée de manière systémique.
Les coûts estimés entre 22 et 37 milliards d’euros de pertes liées aux vagues de chaleur successives entre 2015 et 2020 auraient pu servir de réveil pour basculer dans la préparation et la prévention. Financer aujourd’hui l’aménagement des villes, la ventilation des bâtiments, la végétalisation des espaces urbains, la transformation en villes-éponges coutera toujours moins cher que quelques années successives de crises.
Mais cette vision d’ensemble manque cruellement : l’adaptation n’est toujours pas pensée de manière systémique.

Quels risques systémiques vous paraissent encore mal pris en compte dans la planification actuelle ?
De nombreuses ressources vont manquer, mais l’eau reste la plus critique.
L’eau atmosphérique ne représente qu’une infime part du cycle de l’eau : environ 1 % de l’atmosphère, mais elle contrôle une grande partie du cycle hydrique superficiel et rapide.Restaurer les sols et transformer les revêtements de nos territoires permet de ralentir les écoulements et de réactiver ce cycle naturel.
L’autre grand enjeu que nous aurons à traiter concerne les nappes profondes, qui s’épuisent à mesure que nos consommations dépassent les capacités naturelles de recharge par les pluies. Si l’on récapitule : les sécheresses éclairs se multiplient, le réchauffement s’accélère, l’évapotranspiration augmente, et le lien entre nappes, sols et humidité reste largement ignoré, alors même que la fertilité des sols en dépend directement.
Nous vivons encore dans une illusion d’abondance, renforcée par deux années particulièrement pluvieuses, mais les signaux faibles s’accumulent et pointent vers un déséquilibre profond de nos cycles hydrologiques.
Peut-on concevoir un modèle de transition fondé sur la coopération plutôt que la compétition pour les ressources ?
Oui, à condition de sortir des silos.
Je plaide pour une hydrologie stratégique, pilotée par satellite (GRACE, SWOT) et articulée aux stratégies économiques, sociales et de santé, tout en s’appuyant sur des solutions locales : villes éponges, infiltration, végétalisation, restauration des cycles naturels. Pour la déployer, il faut une vision partagée, une gouvernance éclairée et du courage politique.
Il faut oser concevoir un véritable plan, qui relie enfin les disciplines : hydrologie, urbanisme, climat, psychiatrie, agriculture, autrement dit, tout ce qui relie le vivant.
Dans ce contexte, quel rôle voyez-vous pour l’Etat face à la crise de l’eau, qui est une véritable crise systémique ?
L’État doit fixer un cap lisible et structurant, sortir des contradictions internes (ex. financement des bassines par l’État contre arrêtés préfectoraux interdisant leur usage). Il doit appuyer les initiatives locales efficaces, éviter la technocratie déconnectée, favoriser une gouvernance horizontale appuyée sur la réalité du terrain. L’absence d’un « État protecteur » dans la gestion de l’eau alimente un sentiment de trahison chez les citoyens.
Il faut également décloisonner les agences, ministères, services techniques (BRGM, AFD, Cerema) qui fonctionnent encore trop en silos. Beaucoup produisent de la donnée mais ne la mettent pas en application. Il faut des plateformes inter-opérationnelles pour traduire les rapports en actions. Le modèle à viser, c’est une hydrologie stratégique, capable d’anticiper les risques via les données spatiales, de porter une politique concrète d’investissement et d’aménagement.
Enfin, il faut associer les entreprises, les collectivités et les citoyens à la « hydrologique stratégique » par des logiques de co-construction locale : diagnostics de vulnérabilité, programmes territoriaux de résilience, implication directe des assureurs et des banques dans la réduction des risques (ex : adaptation = réduction du risque client). Cela suppose une pédagogie active, de la transparence, et un récit commun. Il faut décloisonner science, technique, politique, et remettre l’humain au cœur de la décision publique.
Quelle recommandation prioritaire formuleriez-vous pour anticiper ou désamorcer les tensions liées aux ressources dans les années à venir ?
Faire de l’eau le référentiel central de toutes les politiques publiques, énergie, urbanisme, santé, agriculture, commerce. L’eau offre une lecture systémique de nos interdépendances et de nos vulnérabilités. Elle révèle les tensions invisibles, les fragilités d’approvisionnement, les fractures sociales, sanitaires et économiques.
Au fond, il faut croiser les disciplines, financer la régénération des écosystèmes, anticiper les bascules hydriques par satellite, bâtir une gouvernance distribuée, protectrice et lisible, valoriser les solutions locales reproductibles à grande échelle, et former les décideurs à une véritable culture de l’interdépendance.
Sans cela, les tensions autour des ressources s’intensifieront brutalement d’ici cinq ans, avec des choix douloureux à faire : entre les économies, l’accueil de nouveaux habitants ou de touristes, et la préservation de la ressource pour les populations locales.
Plus nous nous préparerons à ces scénarios, plus nous pourrons affronter l’avenir avec lucidité, assurance et la volonté de protéger le vivant.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».
