« L’Europe fait face à une transformation structurelle de son flanc Sud dont elle ne comprend pas les forces motrices » signale Pierre RAZOUX
« L’Europe fait face à une transformation structurelle de son flanc Sud dont elle ne comprend pas les forces motrices » signale Pierre RAZOUX
Entretien integrée à la partie « Crise géopolitique » de l'étude « Comprendre la polycrise »
Historien et spécialiste des conflits contemporains, Pierre Razoux, directeur académique de la FMES, alerte sur une transformation irréversible du flanc Sud de l’Europe que les dirigeants européens persistent à mal interpréter. Nationalisme assumé, instrumentalisation du religieux, légitimation du rapport de force et affirmation identitaire : ces quatre dynamiques redessinent l’ordre régional, dans une logique post-occidentale qui va jusqu’à la confrontation. Ce basculement stratégique produit un arc de crises — démographique, écologique, sécuritaire — qui place l’Europe face à ses vulnérabilités fondamentales. Incapable de rétablir un rapport de puissance, l’UE risque d’être marginalisée dans une zone pourtant vitale pour sa sécurité et sa stabilité. Dans un contexte de brutalisation du système international, Pierre RAZOUX plaide pour une diplomatie européenne fondée non plus sur le magistère moral, mais sur une grammaire du pouvoir assumée, articulée autour d’États volontaires, d’intérêts communs identifiés, et d’une capacité crédible à dissuader.

Depuis plus de trente ans, vous observez les dynamiques àl'œuvre sur le flanc Sud. En quoi cette zone géographique contribue à structurer la crise géopolitique ?
Depuis plus de trois décennies, le flanc Sud –entendu comme l’ensemble Maghreb-Machrek-Sahel et Moyen-Orient élargi – concentre une part croissante des dynamiques de déstabilisation globale. Cet espace constitue, pour la France et l’Europe, à la fois une profondeur stratégique immédiate mais aussi un arc de vulnérabilités systémiques.

L’observation de cette zone sur le temps long permet de comprendre la transformation structurelle de cet environnement : montée des régimes autoritaires ou religieux, retour du rapport de force assumé, marginalisation des logiques multilatérales, militarisation diffuse, recomposition des alliances.
Or, ni la France, ni l’Europe n’ont véritablement compris la transformation à l’œuvre dans cet espace, ni les forces motrices qui recomposent le paysage stratégique, culturel et politique du Grand Sud, s’étendant du Maroc à l’Iran voire jusqu’à l’océan Indien. Là où les Européens perçoivent cette recomposition comme une menace ou un désordre à subir, les pays concernés, eux, la vivent comme une transformation active et assumée, où ils cherchent à repositionner leur souveraineté, leurs intérêts, et leur identité.
Ce sont ces tendances lourdes qui illustrent une transformation majeure en cours : celle d’un monde qui ne cherche plus à imiter un Occident mais qui cherche à en contourner ou à en défier les règles.
Afin de comprendre la crise géopolitique, quelle est votre grille de lecture permettant d’analyser et penser ce flanc Sud ?
Elle repose sur quatre grands moteurs qui animent cette recomposition majeure, se déroulant sous les yeux des européens, et qui guident les dirigeants et peuples du Sud :
1. Le nationalisme, voire l’hypernationalisme, est devenu l’idéologie dominante des acteurs du flanc Sud. Là où les Européens voient un tabou, associée aux guerres mondiales, les Etats du Sud y voient un socle de légitimité qui structure profondément leur vie politique, symbole de souveraineté et de résistance aux ingérences.
2. Le religieux, loin d’être relégué à la sphère privée comme en Europe où il est considéré comme un sujet encore une fois tabou à l’image du nationalisme, vient structurer les régimes, les normes sociales et les comportements politiques du Sud. Le phénomène de l’islam politique, bien que controversé, en est un exemple fort, moteur de mobilisation.
3. Le recours légitime au rapport de force, comme langage légitime d’expression des intérêts. La conflictualité est considérée comme un mode normal d’expression des intérêts. La guerre, la coercition, ou la pression armée ne sont pas vues comme des anomalies, mais comme des instruments politiques rationnels.
4. L’identité, loin d’être un vestige, est une force motrice dans les recompositions politiques et sociales du Sud.
En quoi ce constat plonge-t-il les Européens dans une forme de désarroi stratégique ?
Tétanisés face à ces logiques qui leur échappent, les européens n’arrivent pas à stabiliser une politique extérieure cohérente, alternant des discours de valeurs et de pragmatisme selon les partenaires, rendant illisible toute tentative de vision stratégique. À cela s’ajoute une rupture de fond que les européens ne perçoivent pas et qui n’est pas une simple crise passagère mais bien une transformation irréversible sans retour en arrière. En face, les États du Sud, même affaiblis, avancent avec une certaine cohérence, malgré leurs contradictions internes.
Le flanc Sud est aujourd’hui perçu depuis l’Europe comme un espace de risques et non d’opportunités : instabilité, flux migratoires, terrorisme (y compris terrorisme d’État, algérien, turc, iranien). Cette perception est renforcée par une pression démographique africaine massive de plus en plus corrélée à des dynamiques de radicalisation religieuse. L’Afrique devient un vivier potentiel pour des foyers djihadistes dans les vingt années à venir. S’ajoute à cela le fait que les pays du Sud, autrefois de transit, sont devenus des pays terminaux, provoquant des tensions de cohabitation pouvant être explosives en leur sein, déstabilisant les pouvoirs en place.
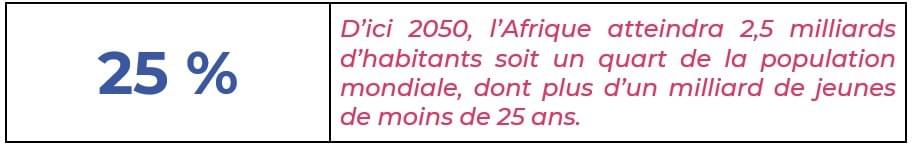
Face à une situation où l’Europe se retrouve avec un Sud en décomposition, un Est hostile et un Ouest marqué par les Etats-Unis qui tournent le dos aux alliés historiques, le désarroi stratégique s’impose en l’absence d’une politique claire. Dans cette configuration, les armées européennes se retrouvent elles aussi déclassées : la supériorité militaire occidentale n’est plus assurée sur le flanc Sud. Aujourd’hui, des groupes informels (Houthis, milices) possèdent des capacités de frappe en profondeur. Les chefs militaires constatent l’impossibilité de garantir la sécurité comme autrefois. La peur a changé de camp, et les adversaires ne craignent plus d’affronter l’Europe. De Gibraltar à Bab-el-Mandeb et Ormuz, le théâtre sud n’est plus sous contrôle et la perception des équilibres de puissances a changé.
Après avoir brossé ce diagnostic de la situation du flanc Sud et de l’incompréhension européenne de cette “irréversible” transformation à l'œuvre, pouvez-vous préciser comment l’Europe est-elle perçue par les acteurs du Sud ?
Les États du flanc Sud sont à la fois adversaires potentiels et, pour certains, des partenaires ambigus (Turquie, membre de l’OTAN). Le flanc Sud perçoit l’Europe comme un maillon faible, qui n’inspire ni crainte ni respect stratégique, un territoire que l’on peut aujourd’hui «tondre » sans grand risque de rétorsion.
L’Europe est ainsi :
● divisée, inefficace et juridiquement paralysée qui marque les limites de la puissance normative;
● incapable d’assumer une politique stratégique claire, oscillant entre valeurs et intérêts selon ses interlocuteurs ;
● inapte à parler un langage de pouvoir par l’autorité et la force.
A titre d’exemple, les États-Unis et Israël, par leurs démonstrations de force récentes, ont rétabli la peur de l’autre côté. Ainsi, personne ne viendra prendre le risque de les provoquer frontalement ces prochaines années, n’enlevant pas les difficultés géopolitiques par ailleurs. L’Europe, quant à elle, reste sans réaction crédible et est perçue en conséquence.
Face à ce changement de paradigme, quelles perspectives et solutions envisager pour consolider les liens entre l’Europe et son flanc Sud ?
A la vision libérale d’après-guerre froide cherchant à porter un monde construit autour d’un modèle unique et mondialisé vient lui succéder une vision prônant une divergence assumée. Ces divergences ne doivent pas signifier la rupture du dialogue.
Au contraire, le maintien de ce dialogue accru mais refondé est la première pierre de cette réédification des liens. C’est la fin du discours de supériorité morale. Seul un langage fondé sur les intérêts communs est audible. Il ne s’agit pas d’adhérer aux régimes locaux, mais de construire une diplomatie de réalignement pragmatique. Seul un langage d’intérêts, à la Trump ou à la Meloni, semble aujourd’hui audible pour les acteurs du Sud.
Toutefois, pour certains pays, le poids de l’histoire, notamment dans les relations franco-algériennes, rend tout dialogue difficile : tant que l’un désigne l’autre comme adversaire, la relation est vouée à l’échec. Cette instrumentalisation mémorielle, enferme les deux parties dans des postures idéologiques paralysantes qui doivent pouvoir être dépassées, cela est possible mais complexe.
Par ailleurs, dans un monde qui voit le retour de l’usage de la puissance militaire, notamment marqué par les Russes, les Israéliens et maintenant les Etats-Unis, l’Europe doit être en mesure de montrer sa puissance et savoir rétablir une crainte stratégique vis-à vis des menaces actuelles. Elle doit pouvoir être prête à réagir, frapper et assumer les coûts si nécessaire, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des pays européens actuellement.
Un dialogue reposant sur un réalignement d’intérêts et un rapport de force permettant d’inspirer la crainte est devenu indispensable dans ce nouveau monde.
Deux illustrations marquantes
1) Les monarchies du Golfe, surarmées, n’inspirent pourtant aucune crainte, ne donnant aucune preuve de leur volonté de se battre. Elles n’ont ni la capacité, ni l'entraînement et ni la volonté de se battre malgré des moyens surdimensionnés.
2) À l’inverse, des pays jouant leur survie, comme l’Ukraine ou Israël, tous deux des anti-modèles mais partageant ce même enjeu. Ceux sont deux pays à peu près démocratiques et tous deux poussés dans leur dernier retranchement pour assurer leur survie. Ils vont surréagir à l’événement car s’ils remportent le conflit, la crainte infligée au pays vaincus ainsi qu’à la communauté internationale fera qu’ils ne seront plus en danger pour plusieurs années. Les ukrainiens sont prêts à tout sacrifier et inspirent aujourd’hui le respect stratégique en étant prêts à sacrifier une génération pour assurer une paix sur plusieurs années.
Dans ce monde en recomposition, comment la relation entre l’Europe et son flanc Sud est-elle susceptible d’évoluer au cours de la prochaine décennie ?
À l’horizon des cinq à dix prochaines années, le scénario le plus probable est celui d’une restructuration profonde du rapport entre l’Union européenne et le flanc Sud, portée autant par les États membres les plus intégrés (comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, les pays nordiques) que par ses partenaires périphériques.
Cette évolution ne s'inscrira pas dans une logique d’approfondissement fédéral, mais plutôt dans une forme de désintégration souple, ou plus exactement dans une recomposition par différenciation : une Europe à géométrie variable, structurée autour de coalitions ad hoc, mobilisées projet par projet. En d’autres termes, l’UE pourrait se transformer en un espace de coordination minimale, laissant place à des blocs fonctionnels définis par des intérêts partagés, et non par une vision géopolitique commune.
Le domaine de la défense illustre déjà cette tendance. On observe un net repli vers des souverainetés sécuritaires nationales ou sous-régionales. Le système normatif européen (douanes, immigration, sécurité commune) inspire de moins en moins confiance. Tant qu’il n’était pas confronté au réel, il bénéficiait d’un crédit théorique. Mais les crises concrètes – migratoire, sécuritaire, géopolitique – ont mis en lumière son impuissance. Face à cette défaillance, les États ont repris l’initiative, renforçant leur appareil militaire, leur résilience cognitive, leur capacité à décider seuls.
Ce retour du politique est alimenté par un apprentissage par les faits. L’Ukraine, pourtant mal préparée, a montré qu’une volonté politique forte permettait de contenir un adversaire bien plus puissant. Israël, malgré son isolement régional, reste capable d’imposer un rapport de force. Ces deux exemples – malgré leur dissemblance – inspirent aujourd’hui plusieurs États européens, qui en tirent une leçon implicite : pour durer, il faut savoir se défendre seul, ou dans des alliances restreintes, surtout face aux menaces du flanc Sud et du front de l’Est. Dans ce contexte, on peut penser que la Russie n’osera pas s’attaquer frontalement à des États comme la Pologne, la Finlande ou la Suède, perçus comme mentalement et militairement préparés, et ayant rétabli un équilibre de la peur.
L’OTAN n’échappe pas à cette dynamique. Bien que sa structure perdure, elle peine à retrouver une fonction stratégique cohérente. Il en va de même pour les technostructures européennes : leur résilience administrative est forte, mais leur capacité d’action est de plus en plus vidée de substance politique et stratégique. Si les États membres réduisent leur participation financière ou orientent leurs contributions vers des formats plus souples – bilatéraux ou multilatéraux – le cœur du système pourrait se dissoudre sans éclat.
Pour autant, des coalitions à la carte pourraient émerger autour de domaines critiques : énergie, R&D, technologies industrielles stratégiques (gaz, pétrole, innovation). Ces domaines touchent à des intérêts vitaux, et pourraient constituer un noyau dur de coopération malgré l’absence de vision géopolitique commune, permettant de fédérer des Etats européens.
Cette carence stratégique collective s’explique aussi par un facteur générationnel : les élites actuelles ont été formées à une époque marquée par un optimisme post-guerre froide, dans un contexte de construction européenne, d’unification et de paix supposée durable. Elles ont reçu une éducation profondément pro-européenne, forgée pour conforter un modèle d’intégration sans conflit. Or ce paradigme est aujourd’hui caduc.
Dans les faits, la politique étrangère européenne reste prisonnière du plus petit dénominateur commun. Elle ne peut incarner une stratégie continentale cohérente car elle n’est ni unifiée ni hiérarchisée. L’Europe souffre d'un empilement de stratégies sectorielles sans cadre directeur, sans priorités assumées.
À l’avenir, seule une approche ciblée, flexible et assumée, structurée autour d’intérêts communs concrets – et non de principes généraux – permettra de reconstruire une forme de cohérence. Sur le flanc Sud en particulier, une telle orientation est possible : c’est là que l’Europe peut encore bâtir un socle commun d’action, à condition de changer de méthode, de ton et de cadre de pensée.
Quels sont les déterminants principaux de ces scénarios ? Où sont les points de bifurcation dans la relation entre l’Europe et son flanc Sud ? relations entre l’Europe et les pays du Sud ?
Quatre scénarios de rupture, difficilement prévisibles mais hautement structurants, pourraient bouleverser de manière brutale la trajectoire actuelle du flanc Sud et, au-delà, la posture stratégique de l’Europe. Ces points de bascule ont en commun de forcer une réaction, de rompre avec l’attentisme ambiant, et d’imposer un réalignement stratégique, militaire et diplomatique des États européens.
● 1er scénario : l’usage effectif de l’arme nucléaire par un acteur étatique
Ce point de bascule, longtemps perçu comme improbable, est désormais discuté sérieusement dans les cercles stratégiques. La Russie est clairement vu comme un acteur susceptible de recourir à l’arme nucléaire dans un cadre tactique ou de théâtre d’opérations limité. Une frappe, même ciblée, entraînerait une onde de choc politique et psychologique immédiate en Europe. La panique qui s'ensuivrait pourrait provoquer un resserrement stratégique sans précédent entre puissances européennes. Un rapprochement entre la France et le Royaume-Uni autour de leurs capacités de dissuasion, longtemps hypothétique, deviendrait plausible, à l’appui d’une révision doctrinale accélérée. Des discussions récentes à ce sujet montrent que ce scénario n’est plus tabou.
● 2ème scénario : un conflit militaire ouvert entre les États-Unis et la Chine
Ce type d’affrontement, par exemple autour de Taïwan ou en mer de Chine méridionale, bouleverserait l’ensemble des équilibres géopolitiques globaux. Il marquerait le retour d’une logique de blocs fermés : les puissances intermédiaires, y compris les États européens, seraient sommées de choisir leur camp. La possibilité de maintenir une autonomie stratégique européenne, ou un positionnement tiers, deviendrait impossible. Washington imposerait un alignement, Pékin en ferait de même.
● 3ème scénario : une attaque directe de la Russie contre un État membre de l’Union européenne
Aujourd’hui encore marginale dans le débat public, cette hypothèse est pourtant sérieusement examinée dans les cercles stratégiques. Une telle agression – contre un pays balte, contre la Pologne ou contre un État nordique – mettrait immédiatement à l’épreuve la crédibilité de la solidarité européenne et atlantique. Serions-nous réellement prêts à défendre militairement un État membre agressé ? L’incertitude de la réponse, en particulier dans les opinions publiques, fragiliserait davantage le socle de confiance qui sous-tend les alliances existantes. Un non-soutien ou une réponse hésitante pourrait provoquer un effondrement stratégique de la cohésion européenne, au moment même où elle serait le plus nécessaire.
● 4ème scénario : une crise de grande ampleur sur le flanc Sud.
Ce point de bascule est peut-être le plus directement lié au sujet là où les autres scénarios affectent les relations par ricochet. Il s’agirait d’une déstabilisation simultanée des principaux États de la rive sud de la Méditerranée – à l’exception du Maroc. Tunisie, Algérie, Libye, Égypte : chacun de ces pays est confronté à des fragilités internes graves. En cas de bascule, on pourrait assister à une véritable « syrianisation » du Sud méditerranéen : éclatement des appareils d’État, émergence de zones de non-droit, prolifération de milices et de groupes terroristes transnationaux, effondrement de l’ordre public. Le canal de Suez pourrait devenir un point critique, menacé de fermeture, entraînant une onde de choc mondiale. L’Europe serait confrontée à une zone chaotique aux portes de ses centres névralgiques, avec des conséquences immédiates sur ses routes commerciales, sa sécurité intérieure, sa stabilité politique.
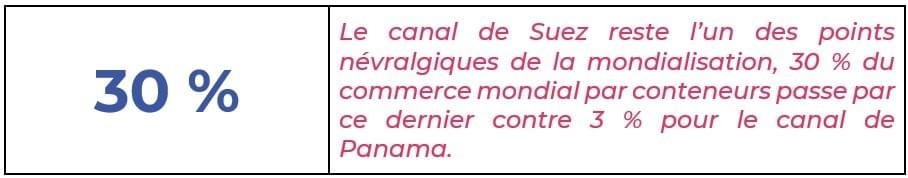
Dans chacun de ces cas, la prise de conscience stratégique ne pourrait plus être différée. L’Europe serait brutalement tirée hors de sa posture de sous-réaction. Ces ruptures ne sont pas de simples fictions prospectives : elles structurent déjà certains scénarios d’anticipation stratégiques et devraient être prises en compte dans toute prospective sérieuse sur les équilibres de puissance à moyen terme.
Pour permettre un dialogue et recalibrer le rapport de force, il est nécessaire d’identifier les acteurs clés de cette crise. Qui peut contribuer à mener à bien cette refondation des liens entre l’Europe et son flanc Sud ?
Dans le contexte du flanc Sud, la recomposition stratégique ne pourra aboutir sans une prise en compte lucide de la réalité des systèmes politiques locaux. Les acteurs décisifs ne sont pas nécessairement les institutions classiques, les administrations ou les think-tanks, mais avant tout les chefs d’État, dans des régimes où la personnalisation du pouvoir demeure centrale.
Pour conduire une politique forte, cohérente et lisible, les pays européens devront travailler directement avec ces figures de commandement autour d’intérêts communs. Cela suppose de reconnaître que, dans nombre d’États du flanc Sud, le chef incarne à lui seul la direction politique, et qu’il détient le levier décisionnel sur les questions majeures de sécurité, de coopération ou d’alignement stratégique. Ignorer cette réalité serait une erreur de méthode.
En d’autres termes, pour élaborer une politique étrangère forte, cohérente et lisible, les pays européens doivent donc accepter de travailler avec ces figures de commandement. Cela ne signifie pas légitimer leurs régimes, ni renoncer à toute exigence de conditionnalité ou de transparence. Mais cela suppose de reconnaître que les décisions stratégiques – en matière de sécurité, de coopération, d’armement, de diplomatie ou d’investissement – passent d’abord par eux. Ce n’est qu’en intégrant cette philosophie politique propre, fondée souvent sur l’autorité, la continuité et la souveraineté, que l’Europe pourra bâtir des partenariats efficaces avec ses voisins du Sud.
Refonder un rapport de force avec le Sud ne passera donc ni par une ingénierie institutionnelle, ni par un plaidoyer normatif. Cela demandera d’entrer dans la grammaire du pouvoir local, d’en comprendre les ressorts, d’en accepter les codes, sans pour autant les adopter.
Après avoir brossé un panorama de la situation, pouvez-vous nous expliciter en quoi les dynamiques du flanc Sud sont-elles amplifiées ou reconfigurées par d’autres crises systémiques ?
L’enjeu stratégique du flanc Sud ne peut être compris isolément. Il est profondément intriqué avec trois autres dynamiques systémiques majeures : la crise écologique, la crise démographique, et la crise économique. Ces dimensions ne relèvent pas du contexte ou de l’arrière-plan : elles sont des moteurs actifs de recomposition géopolitique, qui redessinent les équilibres de pouvoir, les vulnérabilités et les rapports de force.
La crise écologique est particulièrement aiguë dans la péninsule Arabique. Le réchauffement climatique, la désertification accélérée et la raréfaction des ressources rendent de vastes zones littéralement invivables à court terme. Ce diagnostic est parfaitement intégré par les puissances de la région, Iran, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, qui perçoivent l’enjeu dans toute sa gravité. Pourtant, très peu d’actions concrètes sont engagées. En effet, une forme de dissuasion environnementale par la menace balistique existe. L’Iran est en mesure de dissuader ses voisins surarmées : toute tentative de transition offensive, qu’elle soit militaire ou politique, pourrait se solder par la destruction immédiate des infrastructures vitales (usines de dessalement, centrales électriques, raffineries). En d’autres termes, le système est tenu par la vulnérabilité extrême des pays du Golfe, qui peuvent devenir invivables en quelques jours.
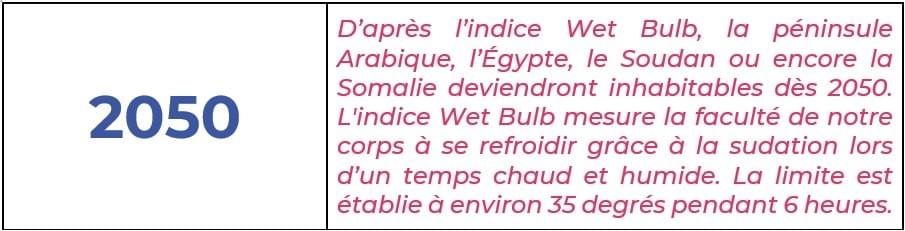
La crise démographique, elle, se conjugue à la crise écologique pour générer un stress géopolitique majeur. Le boom démographique africain, combiné à l’extension des zones inhabitables, produira une série de mouvements de population massifs dans les années à venir. Ces flux n’iront pas seulement vers l’Europe : ils traverseront aussi les États du flanc Sud, déjà fragilisés, accentuant les conflits internes, les tensions ethniques et la dislocation des structures étatiques. Une multiplication des conflits interafricains est anticipée. Dans ce contexte, la bande sahélo-méditerranéenne pourrait devenir, à horizon 5-10 ans, le théâtre d’un scénario de rupture : la constitution d’un proto-califat territorialisé au Sahel, échappant aux États existants, sur le modèle de Daech mais à une échelle plus large. Ce n’est pas une prophétie, mais une possibilité crédible au vu des rivalités internes, des vide-stratégiques, et de l’effondrement partiel de plusieurs régimes de la zone.

Vous mentionnez, à travers cette crise démographique, une déstabilisation de l’ensemble de la zone pouvant laisser présager une place pour une puissance de stabilisation, laquelle ?
Face à cette dynamique, peu d’acteurs semblent aujourd’hui en capacité d’agir. La Russie est mobilisée ailleurs et est structurellement affaiblie. La Chine est visible mais poursuit des intérêts strictement économiques, sans ambition de stabilisation régionale. Les États-Unis, quant à eux, n’ont plus d’intérêt stratégique direct dans la zone. Cela ouvre un espace d’action potentiel pour l’Europe, à condition qu’elle parvienne à formuler une politique extérieure autonome, lisible et crédible.
Toutefois, un seul acteur semble avoir aujourd’hui la volonté et les moyens de s’imposer durablement dans cette région : la Turquie. L’Égypte est dans une situation préoccupante, l’Algérie marginalisée, le Maroc concentré sur ses intérêts locaux. Mais la Turquie, avec sa stratégie régionale assumée, ses capacités militaires et sa projection politique, constitue le seul acteur du Sud global ayant une vraie ambition régionale et globale.
L’enjeu géopolitique du flanc Sud révèle une confusion des appartenances géographiques. La Russie et la Chine tentent de se présenter comme membres du Sud global, mais dans les faits, leur posture est perçue comme impériale, orientale, extérieure, et non comme issue du « Sud » par les sociétés africaines ou arabes. Cette ambiguïté laisse à l’Europe, si elle se saisit du moment, une fenêtre d’opportunité diplomatique, encore inexploitée.
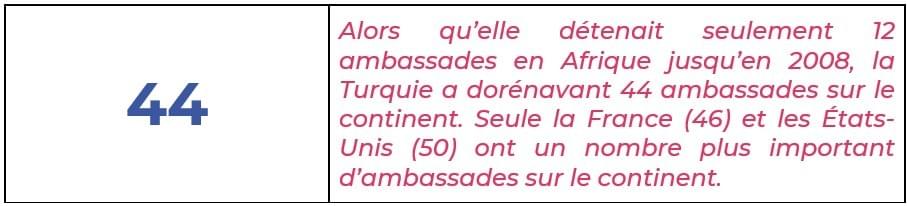
Quelles évolutions institutionnelles permettraient aux Européens de faire face aux défis du flanc Sud de manière stratégique et cohérente ?
La question centrale n’est pas tant celle des structures que celle de leur activation. Sur le strict plan institutionnel, les dispositifs existent déjà : la France comme l’Union européenne disposent d’outils diplomatiques, militaires, économiques et sécuritaires adaptés. Les institutions sont là, les cadres réglementaires sont en place, les capacités d’action – qu’elles soient bilatérales, multilatérales ou communautaires – sont disponibles.
Le véritable problème n’est donc pas technique, mais politique. Ce qui manque cruellement, c’est une vision stratégique partagée, ainsi que le courage politique nécessaire pour assumer des décisions parfois impopulaires, mais indispensables. L’inaction ne résulte pas d’un vide juridique ou d’une carence institutionnelle, mais d’une incapacité à sortir des réflexes normatifs et à se confronter au réel. Il s’agit d’un refus d’affronter les ruptures, davantage que d’une limite structurelle. En résumé : l’Europe et la France sont institutionnellement équipées, mais intellectuellement et stratégiquement désarmées face à l’ampleur de la recomposition en cours sur leur flanc Sud.
La culture politique des dirigeants européens est-elle adaptée aux réalités de cette profonde évolution du flanc Sud ?
La réponse est nette : non. Ni en France, ni au sein des institutions européennes, la culture politique dominante n’offre un terreau fertile pour appréhender et traiter efficacement les dynamiques du flanc Sud. Il existe un déficit profond de sensibilisation chez les élites politiques à ce qui structure les régimes, les mentalités et les logiques de pouvoir dans cette région.
Les dirigeants européens, et français en particulier, ne comprennent pas réellement leurs homologues du Sud, ni la manière dont ceux-ci pensent l’État, l’autorité, le rapport au religieux, à la souveraineté ou à la violence. L’interaction est souvent biaisée par une grille de lecture libérale, universaliste ou normative, qui ne permet pas de saisir les ressorts d’une gouvernance enracinée dans d’autres histoires, d’autres cultures politiques, et d’autres priorités.
Ce fossé culturel contribue à l’inefficacité, voire à la disqualification du discours européen dans le monde arabe, en Afrique ou au Moyen-Orient. Tant que cette méconnaissance structurelle persiste, les politiques menées au Sud resteront incohérentes, mal reçues et inadaptées aux enjeux réels.
Selon vous, le débat public français et européen est-il suffisamment bien structuré pour traiter sérieusement ces enjeux majeurs ?
Non, les termes du débat public ne sont pas posés de manière adéquate pour traiter cet enjeu stratégique. Le flanc Sud, dans toute sa complexité géopolitique, religieuse, démographique et sécuritaire, n’est pas compris, ni correctement représenté dans les discussions publiques en France ou dans le reste de l’Europe.
Le débat est souvent absent, superficiel ou biaisé, réduit à des caricatures (flux migratoires, terrorisme, islamisme) ou à des lectures moralisantes, sans analyse géostratégique sérieuse ni conscience des dynamiques profondes en jeu.
Si vous étiez demain en responsabilité, quelles seraient vos priorités concrètes pour refonder la stratégie européenne vis-à-vis du flanc Sud ?
La première conviction forte est que l’Europe doit réinitialiser en profondeur sa politique vis-à-vis du flanc Sud. Cette refondation ne peut plus s’appuyer sur un discours de valeurs universelles, moralisant, souvent inaudible pour les interlocuteurs du Sud. Elle doit reposer sur une stratégie claire, assumée, pragmatique, exclusivement fondée sur les intérêts concrets des États européens.
La première étape résidera sur l’identification des États européens réellement concernés par le flanc Sud, en analysant leurs intérêts propres. Ces intérêts peuvent être : économiques (investissements, dépendances énergétiques, routes commerciales), migratoires (stabilité des flux, pays de transit ou d’accueil), sécuritaires (risques de déstabilisation, menaces transnationales), ou géopolitiques (proximité maritime, projection d’influence). Cette cartographie réaliste permettrait de distinguer ceux qui veulent agir de ceux qui veulent temporiser. Sur cette base, il serait alors possible de constituer un groupe restreint d’États volontaires, véritablement mobilisés par les enjeux du flanc Sud. Ces États pourraient co-construire une stratégie commune, sans chercher l’adhésion universelle ni le consensus à 27. Ce serait un noyau dur stratégique, mu par des intérêts réellement partagés, non par une fiction d’unité.
La deuxième aspect portera sur le découplage de cette stratégie de celles des grandes puissances extérieures. L’Europe ne doit pas s’aligner mécaniquement sur les axes fixés par les États-Unis, la Chine ou la Russie. Elle doit formuler une doctrine indépendante, pensée pour ses propres vulnérabilités et pour sa propre cohérence. Cela suppose une autonomie de pensée, mais aussi de moyens – diplomatiques, industriels, militaires, informationnels. Cette démarche répond à une impasse observée depuis des décennies : l’illusion d’une centralité européenne autosuffisante. Depuis Giscard d’Estaing, une partie des élites politiques européennes pense davantage « en européen » qu’en national. Cette approche a pu avoir une légitimité à une époque d’expansion de l’intégration. Mais face à la recomposition brutale de l’environnement stratégique, il n’est plus possible de défendre les intérêts européens sans défendre les intérêts nationaux qui les composent réellement. Ce réalisme doit redevenir une boussole.
Il s’agirait donc de refonder une politique étrangère et de sécurité non idéologique, alignée sur les besoins spécifiques des États et mutualisée autour de leviers d’action concrets : investissements, défense, formation, contrôle des flux, partenariats énergétiques, sécurité alimentaire, maîtrise des routes maritimes.
Enfin, le quatrième moteur fondamental, souvent négligé dans les analyses technocratiques ou les approches diplomatiques classiques, est l’identité. Après le nationalisme, le religieux et le rapport à la force, l’identité devient un levier stratégique à part entière. Elle est un facteur de mobilisation, de projection, de résilience.
L’Europe ne pourra pas construire une stratégie durable sur son flanc Sud sans reconnaître que l’identité, loin d’être un obstacle, peut être un levier de mobilisation, de projection, de stabilisation, une réelle force en soi.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».
