« Le spatial est un secteur sobre dans ses méthodes, mais sans stratégie politique, cette sobriété ne produit rien » affirme Irénée RÉGNAULD
« Le spatial est un secteur sobre dans ses méthodes, mais sans stratégie politique, cette sobriété ne produit rien » affirme Irénée RÉGNAULD
Entretien intégrée à la partie « Crise économique » de l'étude « Comprendre la polycrise »
Irénée Régnauld, doctorant à l'EHESS/INSA travaillant sur les implications sociales et éthiques des technologies, interroge la notion de sobriété à travers le prisme du secteur spatial. Il défend une planification démocratique de la décroissance, pilotée par l’État. Si le spatial incarne une culture technique de l’optimisation, il bascule aujourd’hui dans une logique d’abondance avec le New Space. Face au désengagement américain, il appelle à une stratégie européenne autonome, alignée sur des finalités scientifiques, écologiques et géopolitiques. Il plaide enfin pour un récit du spatial fondé sur la connaissance et la sobriété, plutôt que sur la conquête.

Comment définir la sobriété dans la pensée écologique, et quelles en sont les implications concrètes pour l’action publique et les acteurs économiques ?
La sobriété, dans sa définition écologique et politique, consiste à se fixer des limites en s’appuyant sur des critères à la fois scientifiques et sociaux. Elle est à la fois volontaire et démocratique, et dans son expression la plus aboutie, elle rejoint une logique décroissante. L’objectif n’est pas simplement de faire moins, mais de garantir des conditions de vie habitables et justes, en organisant une baisse structurée de la consommation matérielle.
La question de la répartition est centrale : qui croît encore, qui décroît, et selon quels critères ? La sobriété interroge directement la justice sociale. Elle signifie aussi un basculement symbolique : sortir du paradigme de croissance infinie pour envisager d’autres indicateurs de richesse que le produit intérieur brut (PIB).
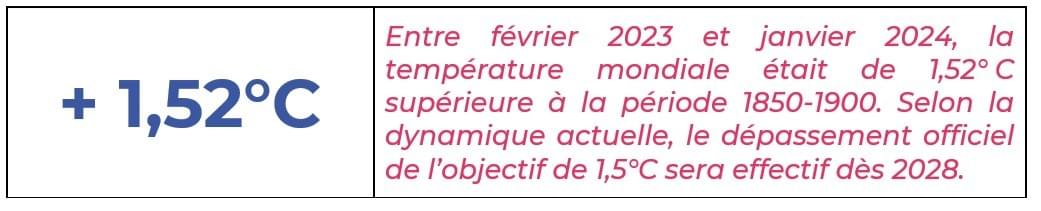
Dans un monde post-croissance, même la notion d’« entreprise » pourrait être amenée à évoluer. Ce n’est pas au marché de fixer la norme, mais bien à l’État de structurer une planification démocratique, fondée sur des arbitrages publics (gouvernement, Parlement, CESE). Il ne s’agit pas d’une planification technocratique, mais bien d’un exercice démocratique pour trancher collectivement ce qui relève du besoin ou non, à l’échelle individuelle comme à l’échelle des grands projets.
Pour les besoins massifs – infrastructures numériques, industrie spatiale, câbles transocéaniques – une planification issue du débat public s’impose. Le rôle du privé ne peut intervenir qu’en second ressort, une fois que les priorités ont été fixées collectivement. C’est la logique historique du secteur spatial depuis les années 1960 : une orientation pilotée par des objectifs publics. Cela justifie d’autant plus la possibilité d’un retour dans le giron public de certaines activités, comme on pourrait le faire dans le cas des télécommunications ou de l’énergie. Dans le spatial, cette reconfiguration serait d’autant plus aisée que les structures publiques (notamment le CNES) sont déjà en place.
Le spatial peut-il être considéré comme une industrie sobre, et selon quels critères ?
Le spatial est ambivalent : il conjugue un habitus de sobriété (chez les ingénieurs) et une culture de l’hubris. Par nécessité physique et économique, il incarne une forme d’efficience poussée à l’extrême. Chaque gramme compte, chaque fonction est optimisée. Cette culture de la précision se retrouve autant chez les grands industriels européens (Thales, Airbus) que dans les programmes plus frugaux comme le programme spatial indien. On y fabrique des objets de haute technologie où tout est testé et vérifié, une rigueur qui témoigne d’une capacité d’adaptation aux contraintes matérielles.
Mais ce n’est pas suffisant pour qualifier l’industrie spatiale de véritablement « sobre ». Les chaînes d’approvisionnement sont mondialisées, les matériaux viennent de multiples pays. Cette exigence d’optimisation n’est pas une finalité environnementale, mais un impératif technologique et économique.
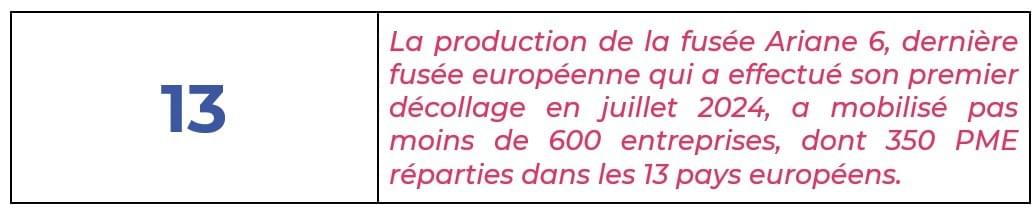
Le contraste est d’autant plus fort avec le secteur numérique, où la baisse des coûts a désincité à optimiser. L’espace reste un lieu où l’on apprend à être sobre. Toutefois, les effets multiplicateurs du spatial sur Terre vont plutôt dans le sens d’un approfondissement technologique que d’une limitation des usages. C’est un secteur qui habilite davantage qu’il ne contraint.
Le New Space marque-t-il une rupture avec l’approche traditionnelle du spatial, notamment en matière de sobriété ?
Le New Space introduit une rupture marquée avec l’approche historique du spatial. Il repose sur un usage différent de l’orbite : alors que le spatial traditionnel privilégie les orbites géostationnaires à fort rendement global, le New Space se concentre sur l’orbite basse. Cette logique suppose une multiplication des objets envoyés pour compenser la perte de couverture, et renverse donc l’économie de sobriété.
La dynamique du New Space, incarnée principalement par SpaceX, repose sur une stratégie d’occupation intensive. On passe d’un modèle raisonné à un modèle d’abondance et d’exploitation – comme en témoignent les projets de mining spatial.
Cette approche coexistera néanmoins avec une production de précision, portée par Airbus, Thales ou d’autres acteurs publics. Le New Space ne remplace pas l’ancien paradigme, il en constitue un prolongement concurrentiel.
Comment la crise géopolitique actuelle redéfinit-elle les priorités spatiales de l’Europe, sur les volets civil et militaire ?
L’un des changements les plus notables est la dégradation de la relation avec les États-Unis, notamment sous la seconde présidence Trump. Cela pousse l’Europe à reconfigurer sa stratégie pour réduire sa dépendance – matérielle, mais surtout géopolitique.
Sur le plan capacitaire, la France dispose d’un socle industriel solide, renforcé par l’arrivée de MaiaSpace. La chaîne de valeur est presque complète, mais certaines dépendances persistent, notamment en matière de surveillance d’objets en orbite (SSA/SST), où les États-Unis conservent leur avance.
La dépendance est aussi programmatique : l’Europe suit la dynamique américaine dans des programmes comme Artémis, sans toujours aligner ses priorités. Il aurait été préférable de ne pas s’y engager. Un geste diplomatique fort pourrait consister à en sortir, avant d’être mis sur la touche. Car les États-Unis sont déjà en train de se désengager partiellement.
À l’inverse, des projets comme IRIS² témoignent d’une volonté de souveraineté stratégique. Le développement de Starlink a mis en lumière le vide juridique en matière de couverture satellitaire. La France, par exemple, ne disposait que de l’ARCEP pour encadrer ces enjeux. Quelques pays seulement ont interdit Starlink. En France, l’enjeu est plus diplomatique que technique, les zones blanches concernent une faible part du territoire (~1% du territoire).
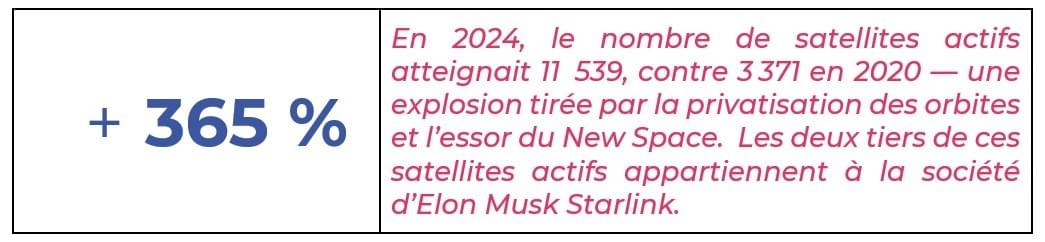
Les tensions géopolitiques poussent-elles le secteur spatial vers plus de sobriété ou vers une redéfinition de ses modes de production ?
Pas nécessairement. Multiplier les satellites en orbite est, par définition, une dynamique non sobre. Certes, des efforts sont faits pour réutiliser certains composants (ex. Prometheus, Maia), mais cette réutilisation accompagne une montée en charge, elle ne réduit pas la croissance.
Des progrès existent : des navires récupèrent les étages d’Ariane, les satellites sont conçus pour durer plus longtemps. Mais dans un monde à 40 000 satellites, la pérennité de ces pratiques devra être réévaluée.
Ce n’est pas tant l’impératif écologique qui pousse le secteur à évoluer, que la contrainte géopolitique. On reste dans une logique d’affrontement, davantage que de bifurcation écologique.
L’Europe intègre-t-elle les enjeux environnementaux dans sa politique spatiale, civile ou de défense ?
Encore marginalement. La future EU Space Law est en cours d’élaboration, mais elle reste timide sur des sujets fondamentaux : retombées de satellites, tourisme spatial, mining extra-atmosphérique.
Face à la dynamique d’abondance de la Chine ou des États-Unis, l’Europe semble contrainte de répliquer par des projets de même nature, sans proposer d’alternative. Pourtant, elle dispose d’un arsenal normatif (traité de 1967, COPUOS, résolutions à l’ONU) et de ressources scientifiques suffisantes pour élaborer une stratégie propre.
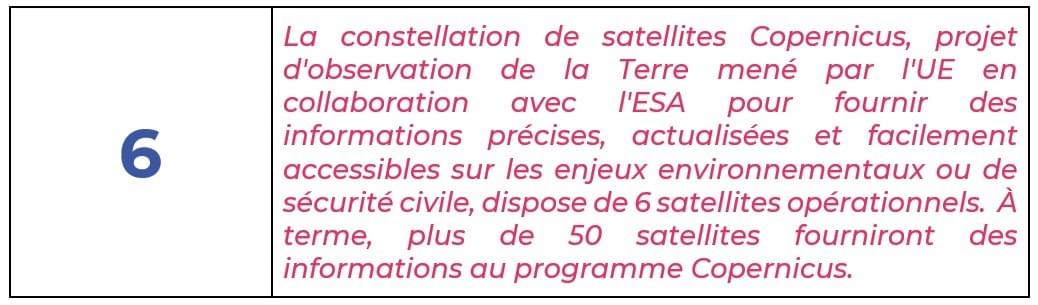
Un levier clair serait de lancer des programmes scientifiques ambitieux, comme la mesure du trafic spatial ou l’impact des retombées. Mais cela nécessite du courage politique. Le spatial est un secteur sobre dans ses méthodes, capable de résilience technique – mais cette culture n’est pas encore traduite politiquement.
Que révèle le paradigme de sobriété sur les limites que l’humanité s’impose – ou non – dans son rapport à la conquête spatiale ?
L’idée selon laquelle la conquête spatiale serait enracinée dans une sorte d’hybris fondatrice de l’humanité relève largement d’un récit construit. Cette ambition conquérante, censée faire l’unanimité, est en réalité soutenue par une communication permanente, mais elle ne reflète pas forcément les aspirations de la majorité. Nombre d’ingénieurs du spatial aujourd’hui ne partagent pas ce projet militarisé ou mégalomaniaque : ils veulent simplement contribuer à la société en tant que citoyens.
Le discours de conquête, porté par des figures comme Elon Musk, repose en grande partie sur du marketing. Cette instrumentalisation du récit spatial ne date pas d’hier : dans les années 70 et 80 déjà, la NASA misait sur cette rhétorique. Si, demain, les projets de colonisation martienne ou lunaire échouent, le mythe collectif pourrait s’effondrer, révélant la réalité d’un secteur principalement structuré autour d’une logique d’investissement public au service d’intérêts économiques privés.
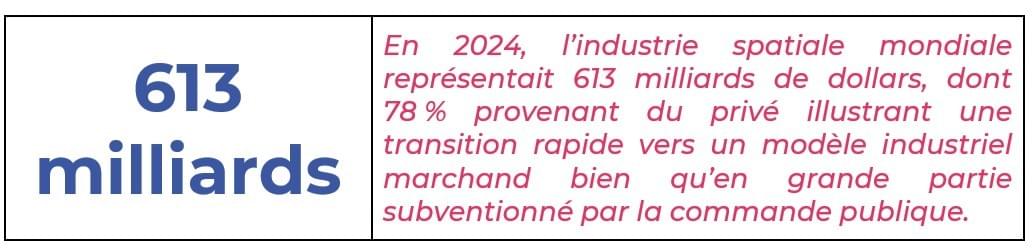
Quelles visions du spatial coexistent aujourd’hui selon les pays, et l’approche incarnée par Elon Musk est-elle devenue dominante ?
Les récits varient selon les puissances spatiales. La Chine inscrit sa conquête spatiale dans un discours nationaliste affirmé : elle célèbre ses astronautes via un jour férié dédié. L’Inde, à travers des interventions de Narendra Modi lors de l’alunissage de Chandrayaan, affiche une fierté géopolitique marquée. Sur le continent africain, les priorités sont tout autres : il s’agit d’abord de garantir un accès minimal à l’espace.
L’Europe, via l’Agence spatiale européenne (ESA), adopte un discours plus marginal, centré sur la connaissance. Mais ce récit, pourtant porteur, reste peu visible. C’est regrettable, car l’Europe pourrait développer des programmes d’exploration sobres, peu coûteux, et à faible empreinte carbone – une voie encore inexploitée.
Il existe aussi un angle peu mobilisé : celui d’une culture spatiale contemplative, valorisant l’espace comme bien commun visuel. L’obscurité du ciel, la beauté du cosmos sont des ressources en soi, menacées par la multiplication des objets en orbite. Ce champ culturel mériterait d’être investi pour construire une vision alternative du rapport à l’espace.
Enfin, malgré la diversité des récits, de nombreux ingénieurs en France et en Europe partagent une posture critique vis-à-vis des dérives actuelles. C’est une industrie déjà largement publique, ce qui en fait un secteur potentiellement plus facile à faire bifurquer. Beaucoup d’acteurs sont compétents, motivés, et alignés avec les enjeux écologiques.
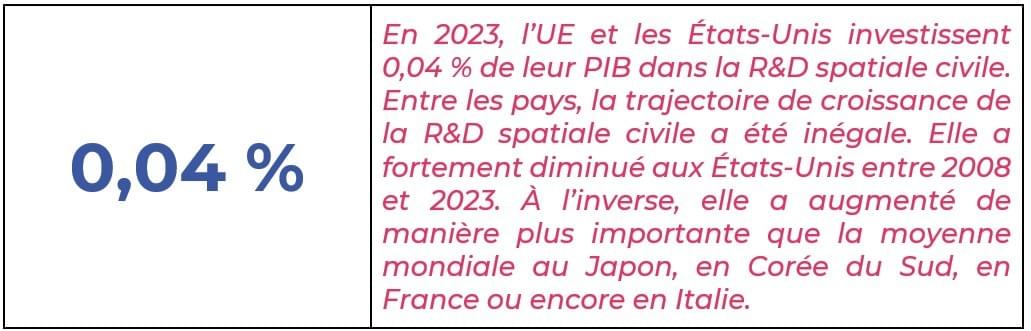
Comment sont définies les priorités dans le secteur spatial, et ce mode de décision est-il éthiquement justifiable ?
Aujourd’hui, les choix dans le secteur spatial sont largement technocratiques. Les financements sont décidés sans réelle hiérarchisation fondée sur les besoins collectifs. Le plan France 2030, par exemple, a alloué 1,5 milliard d’euros au spatial, mais selon une logique de saupoudrage sur un large portefeuille de start-ups, sans ligne directrice claire. À l’époque, l’accent avait été mis sur les micro-lanceurs, alors même qu’aucun marché significatif ne justifiait une telle priorité.
Cette approche traduit une absence de planification véritable : on finance l’amont sans définir le pourquoi. La méthode inverse serait plus rationnelle : déterminer d’abord les finalités – écologiques, scientifiques, militaires – puis construire les outils industriels et technologiques nécessaires. On part aujourd’hui de l’offre, non du besoin.
Dans ce contexte, le Centre national d’études spatiales (CNES) devrait jouer un rôle structurant. Il lui reviendrait d’établir une évaluation critique de ce qui a été financé, et d’assurer une cohérence stratégique.
Si l’on veut véritablement planifier une industrie spatiale au XXIe siècle, il faudra intégrer des critères écologiques, scientifiques et géopolitiques explicites, et sortir d’une logique de logique opportuniste ou de signal faible. Une part de démocratie participative pourrait également être introduite dans la définition de ces priorités.
Les récits qui justifient le développement spatial évoluent-ils, et sous l’effet de quelles dynamiques ?
Oui, les récits spatiaux sont en train de changer. Nous vivons une période de remise en question radicale du spatial, même si certaines critiques – comme celles d’Aurélien Barrau – manquent parfois de nuance et d’efficacité explicative. À gauche, les critiques sont désormais bien relayées, notamment via les enjeux d’inégalités (tourisme spatial, financiarisation de l’espace). À droite, en revanche, il n’existe pas de contre-récit construit : le discours de puissance y reste dominant, sans réel questionnement.
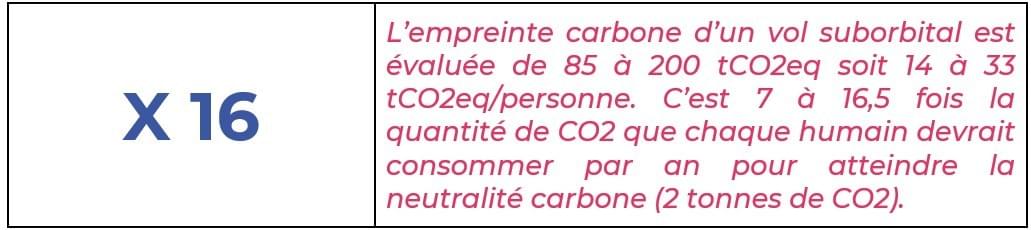
Le danger est de passer d’une critique justifiée à un rejet systématique, en négligeant les apports potentiels du spatial. Il faudrait au contraire articuler une vision cohérente conciliant écologie et puissance, pour construire un narratif européen à même de rivaliser avec les discours nationalistes actuels. Cela suppose un vrai effort de formulation politique, scientifique et stratégique.
Dans cette perspective, les astronautes sont une figure ambigüe. Toute la communauté spatiale sait que leur utilité scientifique est nulle. D'une certaine manière, ils nourrissent aussi un imaginaire de conquête duquel il convient de sortir. S'il fallait vraiment conserver cette activité du vol habité, il faudrait clarifier leur fonction, assumer leur rôle seulement symbolique, d'ambassadeurs "inspirants". Ce serait une bonne manière d'interroger la légitimité des financements qui leur sont dévolus et qui, en outre, nous attachent inutilement au programme lunaire étasunien.
Enfin, il est essentiel de rappeler que le spatial reste une industrie relativement contenue : un million de personnes y travaillent dans le monde. Cela ouvre un espace d’action. En assumant un leadership public fort, des politiques d’achats responsables, une stratégie d’investissement ciblée, il est tout à fait possible de lancer une décarbonation ambitieuse de la filière.


L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».
