« Face à la polycrise, l’économie de défense offre un paradoxe : elle est exposée à toutes ses dimensions mais s’est révélée jusqu’alors incapables d’amorcer les chantiers stratégiques nécessaires » signale Julien MALIZARD
« Face à la polycrise, l’économie de défense offre un paradoxe : elle est exposée à toutes ses dimensions mais s’est révélée jusqu’alors incapables d’amorcer les chantiers stratégiques nécessaires » signale Julien MALIZARD
Entretien intégrée à la partie « Crise économique » de l'étude « Comprendre la polycrise »
Julien Malizard, titulaire de la chaire économie dela défense à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), décrypte un paradoxe stratégique : exposée à toutes les dimensions de la polycrise – démographique, climatique, industrielle, géopolitique – l’économie de défense française peine à se transformer. Marquée par l’inertie institutionnelle et un déficit de culture stratégique, elle reste mal préparée aux ruptures de sécurité à venir. L’absence de pilotage intégré, la dépendance industrielle résiduelle, la dispersion des priorités européennes et l’érosion du capital humain fragilisent la réponse française et européenne face à la montée des menaces. Pourtant, des points de bascule existent : création d’un Conseil de sécurité nationale, recours aux euro-obligations pour financer la défense, achats communs au niveau européen, alliances infra-régionales. L’Europe ne peut plus se contenter de survivre à la polycrise : elle doit assumer sa refondation stratégique, industrielle et doctrinale.

Face à la polycrise, l’économie de la défense est-elle une force transformatrice ou un autre espace d’enlisement stratégique ?
Il y a un paradoxe avec le secteur de la défense. D’un côté, il a une exposition totalement transversale dans la mesure où les bouleversements dans le domaine militaire et géopolitique sont très liés à d’autres pans de la société (en particulier nos faiblesses démographiques et les vulnérabilités climatiques). Pour autant, ce secteur peine à considérer le changement et se caractérise par une certaine inertie et une approche conservatrice. Ainsi, la transformation en « économie de guerre », appelée de ses vœux par le président Emmanuel Macron n’a pas été suivi d’effets concrets.
À titre d’exemple, quatre documents de revue nationale stratégique ont été publiés en huit ans, sans qu’ils n’aient entraîné des évolutions opérationnelles. On peut cependant mentionner dans les éléments d’évolution l’augmentation de la part du PIB consacrée à la défense (+ 0,2 %). Un des facteurs limitant l’augmentation de nos capacités de défense, souvent éclipsé par la question des équipements, est le renouvellement des effectifs militaires. L’armée fait face à des problématiques significatives de recrutements (autour de 27 000 emplois par ans à pourvoir) et il est fréquent que les objectifs de recrutements ne soient pas atteints. Il y a également un enjeu fort pour l’armée à changer sa manière de parler aux jeunes, dont les aspirations sont parfois en décalage avec les besoins de recrutement (la variété des métiers de l’armée, tant administratifs que de terrain, étant parfois méconnue).
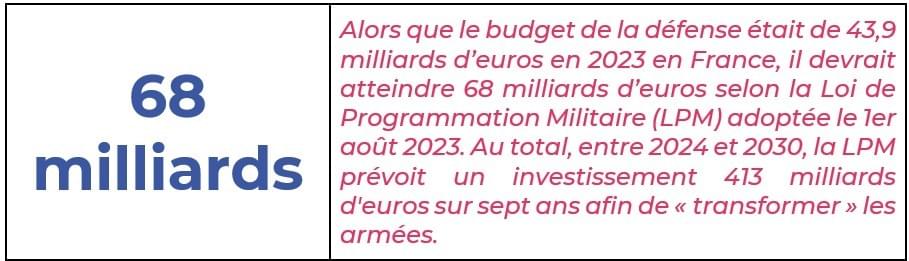
En bref, la réticence au changement, le manque de culture stratégique et le capital humain sont les facteurs qui pourraient créer une rupture dans notre capacité à nous défendre dans un monde plus imprévisible et instable.
Quelles sont les particularités du secteur de la défense à appréhender pour comprendre le rôle qu’il jouera dans la réponse à la polycrise ?
Le secteur de la défense se caractérise par de multiples singularités. D’une part, il s’agit d’un secteur par essence régalien, pour lequel l’Etat dispose d’un monopole de l’action. Contrairement à d’autres services publics, comme la santé ou l’éducation, pour lesquels il existe bien souvent une alternative de marché, il n’existe pas de concurrence dans le domaine militaire. L’analyse de l’efficacité de l’action publique dans le domaine de la défense se heurte ainsi à l’absence de contre-factuel (en la matière, seule la comparaison des systèmes internationaux permet d’identifier les forces et les faiblesses d’un système de défense). D’autre part, la défense est une des politiques publiques régies par des personnes davantage que par des processus décisionnels.
Face à la complexité de la polycrise, ses impacts aussi variés que graves, ses multiples effets rebonds, quelles évolutions imaginer s’agissant du pilotage stratégique de l’économie de la défense ?
De nombreux analystes et experts appellent aujourd’hui à faire évoluer le pilotage stratégique des questions de sécurité et de défense au sein de l’Etat. Avec une telle concentration des décisions, nos instances politiques et administratives sont inadaptées à une multiplication et une complexification des crises diplomatiques et sécuritaires. Les organes de prise de décisions sont parfois embolisés, empêchant la réflexion stratégique, et provoquant parfois des choix au mauvais niveau. Une telle évolution pourrait passer par la création d’un Conseil de sécurité nationale à l'instar de ce qui se fait aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, ou à Taiwan. Il est ainsi temps de doter la France d’une véritable culture stratégique, associant les différents métiers (diplomatie, militaire, économie) au traitement des grands enjeux stratégiques.
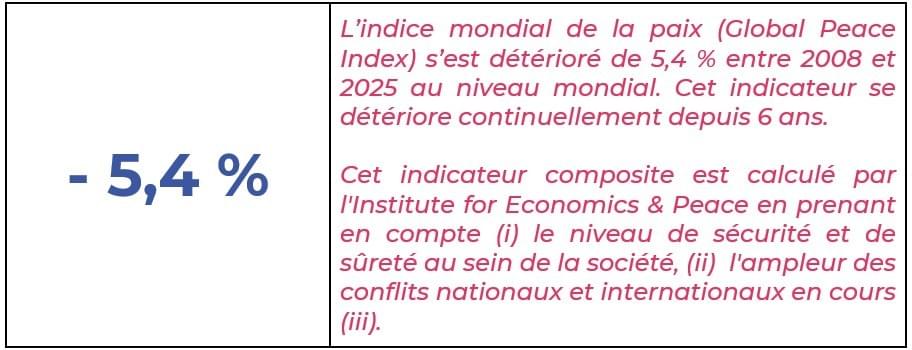
Le dimensionnement de notre économie de défense, quant à lui, est-il adapté à la polycrise ?
En termes de moyen, nous dépensons actuellement 2% de notre PIB dans la défense, ce qui est un point bas historique. Nous sommes accordés au sein de l’OTAN pour atteindre 3,5 % de dépenses de défense. Les moyens consacrés à la défense ne disent cependant pas tout de l’efficacité du système de défense. En France par exemple, avec 2 % du PIB consacré à cet enjeu, nous disposons d’une dissuasion nucléaire permanente, d’une posture permanente de sécurité aérienne, d’une présence permanente en mer (sous-marins) et d’une capacité à projeter notre force. Notre niveau de dépendance à l’extérieur est très faible (en dehors des drones, des catapultes de porte avion et de faiblesses en matières de renseignement). Notre dissuasion nucléaire est une dépense efficace, car elle représente environ 0,2 % du PIB (soit 6 milliards d’Euros par an), et nous permet d’être totalement indépendants, contrairement aux britanniques, qui restent dépendants des Etats-Unis pour leur dissuasion et qui n’ont pas de présence permanente en mer.
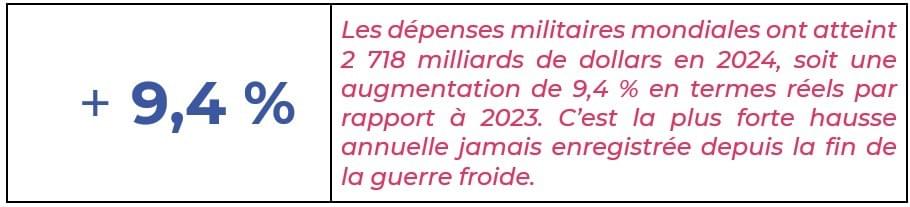
Aujourd’hui, notre principal défi porte sur le renouvellement de nos équipements et le développement des générations suivantes de nos systèmes de combat. Cela implique de faire des choix et d’entrer dans une logique coopérative au niveau européen, ce qui est une véritable nouveauté. En effet, même un budget de 3,5 % du budget consacré à la défense, il ne sera pas possible de financer le renouvellement de tous ces équipements sans faire de choix. Il nous faudra en tout état de cause au moins 20 ans pour être matures sur ce plan.
Quelles sont les conséquences de cette logique en matière industrielle ?
La logique de spécialisation productive et d’avantages comparatifs fait que pour les chars d’assaut par exemple, la propulsion est allemande, seules les tourelles et canon sont de fabrication française. Les industries françaises de défense perdent du terrain face aux italiens, aux allemands, aux turcs et aux coréens.
La France dans ce contexte est vue comme un allié fiable mais petit. Nous parvenons jusqu’à présent à tenir notre rang, mais devons assumer des ambitions mondiales tout en étant une puissance moyenne. Tandis que nous vivons sur des acquis qui nous permettent de tenir notre rang, les menaces se multiplient et s’additionnent, ce qui risque de redistribuer les cartes : durant les dernières années, l’armée française s’est progressivement adaptée pour mener des aventures expéditionnaires, mais doit désormais se préparer à une guerre de haute intensité, et à une multiplication des théâtres (guerre informationnelle, spatiale, terrestre et maritime). En parallèle, l’armée est mobilisée pour des missions de plus en plus diverses : gestion des catastrophes naturelles, maintien d’une présence sur certaines zones ultramarines.
Certains pays ont augmenté radicalement leur budget de défense, comme la Pologne qui est passée de 2 à 4 % de son PIB consacré à ce domaine. Toutefois cette augmentation spectaculaire se heurte à certains obstacles comme des goulets d’étranglement en matière d’offre industrielle européenne, de main d'œuvre qualifiée, ce qui implique une action coordonnée. Ainsi l’augmentation drastique des dépenses militaires est une condition nécessaire mais non-suffisante pour assurer notre préparation stratégique.
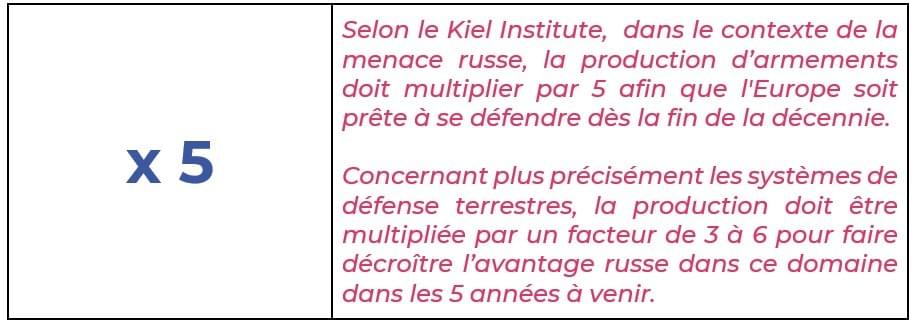
Dans quelle mesure la construction d’un système de défense européen est-il réalisable ?
L’Union européenne est une bonne taille de marché pour rivaliser avec les Etats-Unis et avec la Russie, qui augmente sa cadence de production dans le domaine militaire. La coopération européenne en matière de défense se heurte à des divergences de vues entre États-membres sur l’analyse des menaces et les priorités stratégiques de défense. Les États baltes ou d’Europe orientale ont ainsi une sensibilité à la menace russe bien différente de pays du sud de l’Europe tels l’Espagne ou l’Italie. De ce point de vue, les obstacles à la coordination européenne semblent, pour l’heure, indépassables. Le positionnement par rapport à l’Alliance transatlantique est également un élément de divergence majeure, Donald Trump utilisant bien souvent l’achat de matériel américain comme condition au soutien militaire américain dans l’Alliance.
Comment dépasser ces obstacles et poser des jalons pour une meilleure coopération au niveau européen ?
Des évolutions sont déjà visibles dans la manière dont les États-membres considèrent l’idée de réaliser des achats communs de matériel de défense au niveau de l’UE. L’Allemagne s’achemine vers un réarmement et dépasse ses dogmes budgétaires face au changement de contexte géopolitique, tandis que les Pays Bas demeurent bloquants. De ce point de vue, les propositions de Kaja Kallas, Vice-présidente de la Commission européenne et Haute Représentante pour la Politique étrangère et de sécurité commune, sur l’émission d’Eurobonds pour financer l’effort de défense sont à suivre de près. Le développement de coopérations dans le domaine industriel, avec une coordination accrue des stratégies productives des États et l’augmentation des achats de matériel d’origine européenne, constitue un optimum de second rang, vers lequel nous nous dirigeons progressivement. Les alliances infra-régionales apportent une forme de solution à l’enjeu de la coordination, en particulier pour les États dont la taille impose de mutualiser les matériels avec leurs voisins (Benelux, groupe de Visegrad par exemple).

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».
