« Je réfute l’idée d’un rejet de la transition : quand on regarde l’histoire des politiques environnementales, elle s’est faite par effets d’escaliers » affirme Chantal JOUANNO
« Je réfute l’idée d’un rejet de la transition : quand on regarde l’histoire des politiques environnementales, elle s’est faite par effets d’escaliers » affirme Chantal JOUANNO
Entretien intégrée à la partie « Crise écologique » de l'étude « Comprendre la polycrise »
Ancienne secrétaire d’État à l’Écologie et dirigeante expérimentée du secteur public comme du privé, Chantal Jouanno alerte sur un malentendu politique : ce n’est pas la transition écologique qui suscite le rejet, mais la façon dont elle est conduite. Dans un monde où le chaos s’installe comme norme – sur les marchés, dans les récits, dans la gouvernance – la perte de confiance envers l’expertise, les institutions et les instruments démocratiques fragilise la capacité collective à affronter l’Anthropocène. Ce backlash, structuré par la montée des populismes et la radicalisation des clivages identitaires, mine les conditions mêmes de l’action publique. À l’échelle européenne, la réponse ne peut être ni technocratique ni autoritaire : elle doit articuler science, démocratie locale, diplomatie écologique et justice sociale. Dans cette polycrise, l’écologie n’est plus un supplément d’âme – elle est l’épreuve de vérité du projet politique européen.

Quelles formes concrètes prend aujourd’hui le rejet ou la contestation de la transition écologique (manifestations, lois annulées, attaques médiatiques, désengagements politiques) ?
Il ne s'agit pas d'un rejet global de la transition écologique, mais plutôt d’un ralentissement ciblé sur certains sujets. Il convient de ne pas confondre la contestation portée par des groupes minoritaires et la perception majoritaire de la population. Un sondage récent, commandé par ENGIE, montre qu’un soutien fort à la transition subsiste dans l’opinion. Les remises en cause visibles aujourd’hui tiennent davantage à la complexité ou à la surcharge réglementaire de certains outils qu’à une opposition de fond.
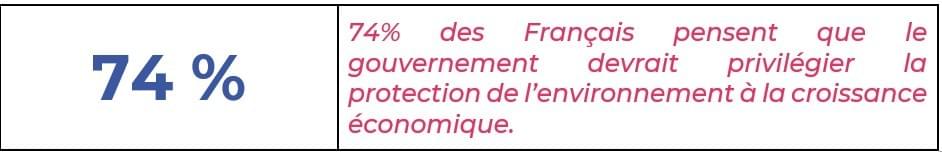
Ainsi, la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a été repoussée pour certains acteurs, tandis que la directive CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) risque d’être abandonnée. En revanche, la réglementation européenne sur la déforestation se maintient.
Sur les ZFE (zones à faibles émissions), les débats sont anciens, notamment autour de la justice sociale, sans qu’il s’agisse d’un phénomène nouveau. Le recul de la consommation de produits bio doit également être relativisé, ces produits n’ayant jamais constitué une majorité du marché.
Du côté des entreprises, la dynamique de transition demeure forte, notamment dans les investissements en énergies renouvelables qui atteignent des niveaux records.
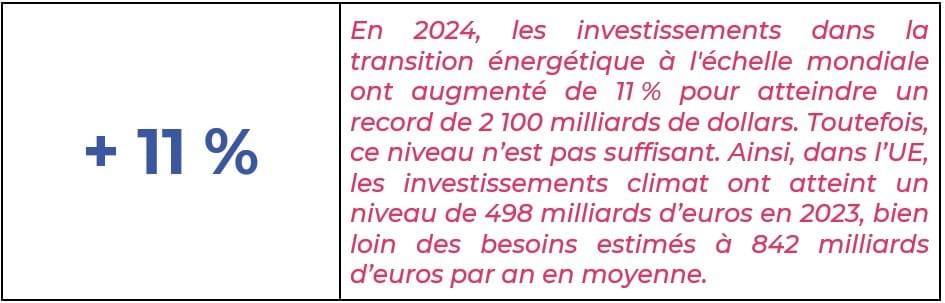
Historiquement, les politiques environnementales connaissent des phases d’accélération, de stagnation, puis de relance. Ces à-coups suivent un schéma bien connu, où la contestation sociale réémerge principalement sur les sujets de redistribution et d’effort perçu.
Quels acteurs ou courants structurent ce backlash – et avec quelles motivations (politiques, économiques, culturelles) ?
La contestation actuelle de la transition écologique provient principalement de courants idéologiques de droite et d’extrême droite. Ces forces mobilisent des registres différents : l’extrême droite peut défendre des sujets comme le bien-être animal ou la biodiversité, mais s’oppose fermement aux énergies renouvelables, en s’appuyant sur un discours axé sur la justice sociale.
La droite traditionnelle, quant à elle, met davantage en avant des arguments liés à la compétitivité économique. Toutefois, cette ligne évolue, car il devient de plus en plus clair que la transition conditionne désormais la compétitivité future. Ces acteurs plaident aussi pour la défense du patrimoine et des paysages, au nom d’un certain attachement à la stabilité.
Ces oppositions ne sont pas nouvelles. Elles s’inscrivent dans une forme de récurrence : lors du Grenelle de l’environnement, par exemple, un enthousiasme initial avait été suivi d’un repli conservateur. Aujourd’hui, nous observons une mécanique comparable.
Le sentiment d’urgence climatique accentue cependant l’effet de tension. Dans ce contexte, le risque de radicalisation augmente, alimenté par le chaos informationnel et l’essor du populisme. Donald Trump illustre cette dynamique : rejet de la science, gouvernance par le désordre, usage massif de la désinformation. Si un pouvoir venait à combiner ces trois dimensions – négation de la science, stratégie du chaos, manipulation numérique – le risque de dérive autoritaire serait majeur.
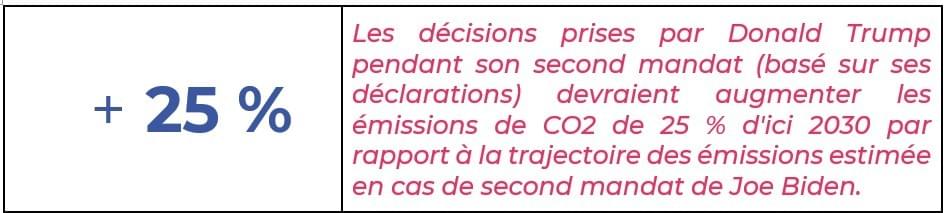
Quels sont les effets visibles sur l’action publique, la mobilisation citoyenne ou l’engagement économique ?
La fracture actuelle oppose une gouvernance descendante et technocratique, qui prescrit les solutions sans concertation réelle, à une attente de démocratie quotidienne, de dialogue, et d’information transparente.
Le vrai point de rupture réside dans l’accès à l’information. La Commission nationale du débat public (CNDP) a bien réussi à structurer des dispositifs de participation, mais a échoué à garantir une information indépendante, claire et accessible. Celle-ci a été abandonnée aux porteurs de projets ou à l’État, ce qui a fragilisé la légitimité des décisions.
On a cru que la science se suffirait à elle-même, qu’elle allait naturellement convaincre. Or, c’est précisément ce que les populismes contestent en premier. Ce déficit d’information indépendante est l’un des maillons faibles actuels de l’action publique.
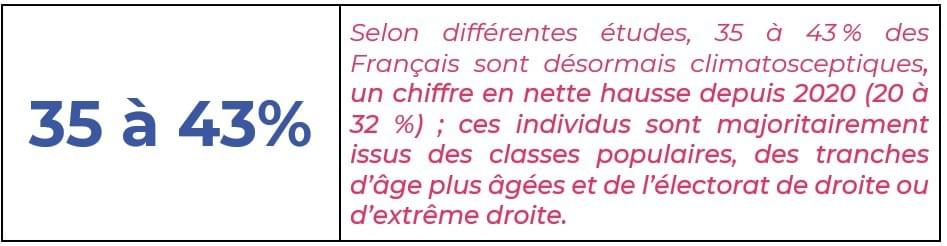
Ce backlash vous semble-t-il conjoncturel ou durable ?
Il est difficile de trancher entre un phénomène conjoncturel ou structurel. Comme le souligne Pierre Charbonnier, une démocratie qui n’est plus en capacité de produire de la croissance est vulnérable à la contestation. Pourtant, l’exemple polonais montre qu’un rejet de l’autoritarisme peut se produire même après une période de prospérité.
Ce qui est certain, c’est que la transition aura lieu. Elle est inéluctable, notamment sous la pression des enjeux d’adaptation liés à l’eau, l’alimentation ou l’énergie. Mais elle se fera dans la douleur, en alimentant les conflits sociaux et les fractures territoriales. La conflictualité, déjà à l’œuvre, va s’intensifier.

Nous devons donc accepter l’idée que cette tension est désormais une composante durable de l’action publique.
Peut-on imaginer un retournement positif, et à quelles conditions ?
Oui, mais à certaines conditions strictes. D’abord, renforcer la démocratie locale, seul espace capable de produire du dialogue véritable. Pas nécessairement du consensus – un mot trompeur – mais un espace de confrontation constructive.
Ensuite, redonner un rôle fort aux organisations internationales. Le multilatéralisme, bien que fragilisé, reste une boussole. Enfin, les partis politiques doivent redevenir des porteurs sincères de projet collectif.
Paradoxalement, des figures comme Donald Trump peuvent jouer un rôle de catalyseur. En poussant leur logique à l’absurde, ils pourraient contribuer à la démonstration de leur inefficacité.
Une transition volontaire suppose donc cinq piliers : la science, la démocratie locale, l’accès à l’information, le renforcement des institutions internationales et l’engagement politique structuré. Mais la fenêtre est étroite. Les réseaux sociaux rendent l’opinion difficilement lisible, et les résultats électoraux de plus en plus imprévisibles.
Le modèle économique actuel a été créé pour apporter la paix. Est-ce que poser un modèle économique différent pourrait amener de la violence ?
La question est légitime. Le rapport Meadows avait déjà démontré l’impasse d’une croissance illimitée. Pourtant, la sobriété – qui devrait être l’expression politique de cette prise de conscience – reste mal définie. Elle est trop souvent confondue avec l’efficience.
Oui, il faut inventer un nouveau modèle fondé sur la finitude des ressources. Mais il n’a pas encore été pleinement pensé à l’échelle macroéconomique. Comment croître sans consommer plus ? Comment créer de la valeur dans les limites planétaires ? À ce jour, aucun modèle économique pleinement opérationnel ne répond à ces questions.
À l’échelle micro, en revanche, les entreprises s’adaptent. Certaines passent d’un modèle basé sur la vente de volumes à un modèle fondé sur la garantie de continuité et de qualité. Dans le secteur de l’eau, par exemple, cette transformation est en cours.
Ce changement est en partie invisible, car difficile à assumer publiquement, surtout pour les entreprises cotées. Admettre que son modèle économique n’est peut-être pas soutenable est risqué sur les marchés financiers.
Pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Une étude menée avec le Forum économique mondial a montré qu'à l'horizon 2040, certaines industries – comme les télécoms, les déchets ou les utilities – pourraient perdre jusqu’à 20 points d’EBITDA en raison du changement climatique. Ces impacts massifs forcent à repenser les modèles.
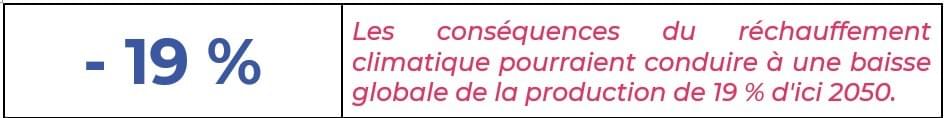
Quelles interactions voyez-vous entre ce backlash et les autres dimensions de la polycrise (crise sociale, défiance, repli identitaire) ?
Les tensions géopolitiques vont croître autour de l’accès aux ressources critiques. Cela entraînera des ruptures d’approvisionnement, des tensions logistiques, des déplacements de population à l’intérieur des États et entre régions du monde.
Face à ce phénomène, les logiques régionales reprennent le dessus. Les organisations internationales, affaiblies et trop bureaucratisées, laissent le champ libre à une régionalisation de l’action publique. Certains parlent déjà d’un risque de « balkanisation ».
Sur le plan économique, le cœur du débat réside dans la redéfinition du périmètre entre le privé, le marché, et ce qui relève du bien commun. Les infrastructures stratégiques, par exemple, devront être reconsidérées sous l’angle de la résilience collective.
Enfin, notre modèle reste fondé sur la quantité. Il faudra pourtant évoluer vers une logique de qualité – créer de la valeur sans accroître la consommation de ressources. Ce changement de paradigme est en germe, mais pas encore généralisé.
Quel impact sur les relations entre générations et sur la place des jeunesses ?
La tension intergénérationnelle devient palpable. Ce qui relevait hier d’une idée théorique est désormais visible dans le débat public, les médias, et les interactions sociales.
La jeunesse est confrontée à un chaos permanent. Elle évolue dans un monde instable, imprévisible, où l’on attend d’elle une agilité constante. Cela peut conduire au découragement, voire au renoncement.
Deux jeunesses coexistent aujourd’hui : une jeunesse mondialisée, mobile, cultivant des opportunités, et une jeunesse plus enclavée, socialement et territorialement, subissant de plein fouet l’instabilité. Ce clivage générationnel est un enjeu majeur de cohésion sociale.
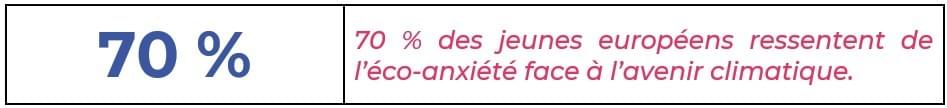
Comment l’État peut-il répondre à ce backlash sans le renforcer ?
Il faut revenir aux textes existants et les appliquer pleinement. La convention d’Aarhus, par exemple, impose l’accès à l’information et la participation du public aux décisions environnementales. Elle a une valeur juridique supérieure au droit français, mais reste sous-utilisée.
Il faut aussi généraliser les véritables études d’impact, à haute résolution territoriale et sociale. Les outils existent pour croiser les données, anticiper les effets et cibler les compensations.
Cela implique de confier aux collectivités les leviers d’ajustement, plutôt que d’imposer des mesures uniformes depuis Paris.
Plutôt que de multiplier les objectifs de long terme, il faut des feuilles de route claires, cohérentes, et surtout stables. La transition écologique a besoin de continuité. Une « diplomatie écologique » structurée serait pertinente, à l’image de la diplomatie étrangère.
Enfin, tout est déjà écrit. Les outils, les dispositifs, les normes existent. Il suffit de les mettre en œuvre avec rigueur.
Faut-il repenser les formats de participation citoyenne autour des politiques écologiques ?
Oui, mais avec discernement. Il faut éviter les effets de mode ou les méthodes uniformes. Chaque territoire, chaque contexte, appelle des modalités différentes.
Par exemple, sur certains projets urbains, les outils numériques sont inopérants : il faut aller sur le terrain, en porte-à-porte, avec des médiateurs.
Il faut aussi légitimer les formes spontanées de participation. Il n’y a pas d’un côté la participation « officielle » et de l’autre, des expressions illégitimes. Les deux doivent être reconnues et articulées.
Enfin, tout repose sur une information adaptée. Les publics précaires ne sont pas atteints par des brochures ou des plateformes en ligne. Il faut s’appuyer sur le tissu associatif, seul relais crédible dans de nombreux territoires.
Quelle mesure forte permettrait, selon vous, de préserver l’élan démocratique autour de la transition dans les 10 prochaines années ? Comment reconstruire un récit écologique qui fédère au lieu de cliver ?
Il ne s’agit pas de créer de nouvelles structures, mais d’appliquer les textes existants et de faire vivre la démocratie participative dans l’esprit autant que dans la lettre.
La priorité est à la cohérence, à la visibilité et à la stabilité de l’action publique. Il faut sortir des effets de balancier politiciens et penser sur le temps long.
Pas besoin de révolution institutionnelle. Ce qu’il faut, c’est de la méthode, de la constance, de la transparence, et un respect exigeant du cadre démocratique existant.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».
