« Alors que nous devons réduire la consommation pour réduire nos dépendances énergétiques, les citoyens sont encore dans une forme d’attentisme face à l’Etat qui a absorbé les chocs » alerte Diane SIMIU
Entretien intégrée à la partie « Crise écologique» de l'étude « Comprendre la polycrise »
Directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’eau au sein des ministères de la transition écologique, Diane Simiu alerte sur un risque stratégique majeur : celui d’un statu quo énergétique déguisé en transition. Alors que la dépendance fossile reste massive, que les infrastructures sont sous-dimensionnées, et que les citoyens attendent encore trop de l’État, l’indépendance énergétique européenne ne peut plus être différée. Dans un contexte de polycrise, l’énergie devient le révélateur d’un double désalignement : entre objectifs politiques et capacités techniques, entre urgence écologique et fragmentation démocratique. La bifurcation repose sur trois leviers : adopter une Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) crédible, renouveler les coalitions narratives, et territorialiser une action publique trop centralisée. Réorienter le système énergétique, c’est refonder un contrat politique : entre soutenabilité et souveraineté.

Quels éléments concrets illustrent aujourd’hui la dépendance énergétique de la France ?
La balance commerciale énergétique constitue l’indicateur le plus parlant : elle varie entre 70 milliards d’euros les bonnes années, et a atteint 140 milliards d’euros en 2022. La France importe 99 % de son énergie fossile, alors que cette dernière représente encore 58 % du mix énergétique. Dans les débats publics, l’attention est largement focalisée sur l’électricité, alors que la moitié de notre consommation d’énergie concerne la chaleur, elle-même issue aux deux tiers de sources fossiles. La loi de Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) vise un renversement de cette situation : passer de près de 60 % d’énergie fossile à moins de 40 % en 2030.
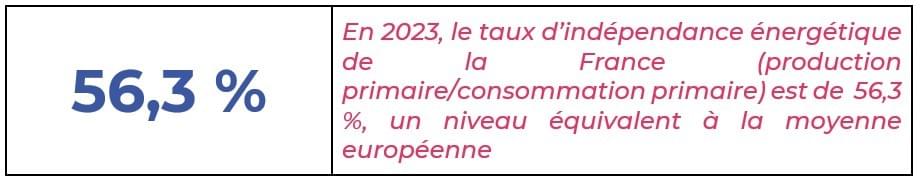
Cette transition est inatteignable sans une baisse significative de la consommation. Les objectifs définis au niveau européen sont une réduction de 30 % d’ici 2030, et de 50 % d’ici 2050. Cela implique des efforts considérables en matière d’efficacité et de sobriété.
Plusieurs obstacles se présentent : sur le plan politique, les débats au Parlement sur les différents projets de loi de programmation de l’énergie et du climat ont montré les divisions et le manque de consensus.. Andreas Rüdinger parle d’une forme d’amnésie collective sur ce que nous avons vécu en 2022. Sur le plan économique, le prix bas du gaz, facilité par le déploiement rapide d’infrastructures LNG depuis le début de la guerre en Ukraine, déséquilibre par exemple les projets de réseaux de chaleur, dont l’équation économique devient intenable sans aide publique. Politiquement, un rééquilibrage de la fiscalité entre le gaz et l’électricité – pourtant nécessaire – est délicate.
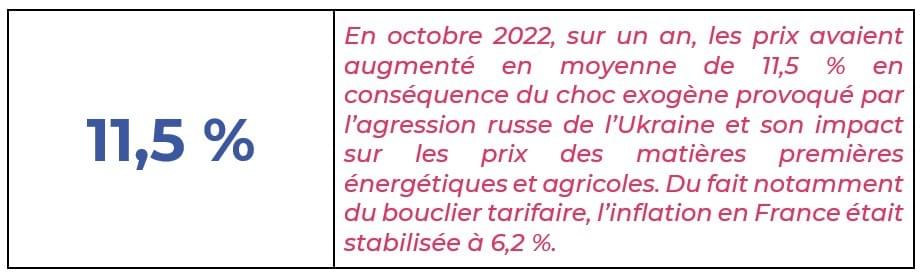
Enfin, une crise démocratique aggrave la situation. Le débat sur les Zones à faibles émissions (ZFE) illustre ce phénomène : ceux qui prennent la parole ne sont pas nécessairement ceux qui sont concernés. Cette mobilisation s’est d’ailleurs déplacée vers la PPE. La désinformation est très active, notamment sur les batteries, les pompes à chaleur ou les énergies renouvelables. Par exemple, les pompes à chaleur, sont cruciales pour sortir du gaz, mais peinent à s’imposer dans l’existant, en partie à cause de l’inertie des professionnels et des argumentaires contraires. Une campagne de communication sera lancée à l’automne pour accélérer l’adoption de cette technologie par les Français.
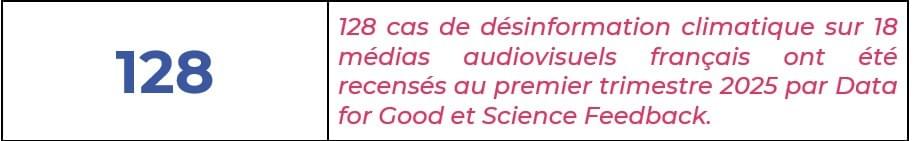
Où en est-on du point de vue de la mutation des infrastructures (réseaux, logements, mobilité, numérique) ?
Certaines innovations techniques offrent des perspectives très prometteuses. On peut citer les véhicules-to-grid, le potentiel d’effacement dans le tertiaire, ou encore les pompes à chaleur dans l’habitat collectif. Les dispositifs techniques existent, le potentiel de diffusion reste élevé.
Quel niveau d’indépendance énergétique est atteignable dans la décennie à venir ?
Les chiffres de la PPE montrent une trajectoire de réduction de la dépendance. La crise de 2022 a produit une forme de mobilisation générale, avec un fort engagement à tous les niveaux – État, entreprises, collectivités, citoyens. Il faut parvenir à maintenir ce type d’engagement dans le temps. Les arguments rationnels ne suffisent pas toujours. Prenons l’exemple de la voiture électrique : son coût complet à 10 ans est compétitif, mais cela ne suffit pas à convaincre les entreprises par exemple : l’introduction d’une nouvelle taxe en 2025 a été nécessaire pour faire décoller les ventes.
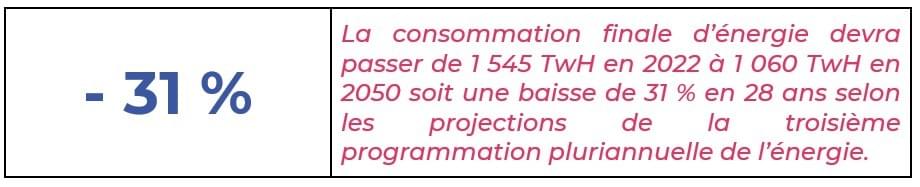
Aujourd’hui, beaucoup continuent à penser que l’État viendra toujours amortir les chocs énergétiques, ce qui limite leur implication réelle. Il y a une forme d’attentisme. Or, les finances publiques ne permettent plus d’envisager la mise en place de « boucliers tarifaires » comme il y en a eu en 2022.
En quoi la question énergétique est-elle centrale dans la logique de polycrise ?
L’énergie est à la fois cause et symptôme de la polycrise. Comme en 1974, la crise énergétique de 2022 a montré que les tensions sur l’approvisionnement peuvent générer des effets en cascade : inflation, fragilisation des États. Toute stratégie sérieuse de résilience doit traiter de front les enjeux énergétiques. La transition ne concerne pas uniquement le climat : elle engage aussi des choix industriels, sociaux, géopolitiques.
Comment jugez-vous la capacité actuelle de l’État à piloter la mutation des infrastructures ?
L’État conserve un rôle structurant sur la production et les infrastructures, mais il se heurte à un rythme d’électrification qui est insuffisant. Nous produisons plus d’électricité que nous n’en consommons, ce qui conduit à des épisodes de prix négatifs. Cela complique le développement des énergies renouvelables. Il faut donc maintenir les efforts pour encourager le véhicule électrique, les pompes à chaleur, l’électrification de l’industrie.
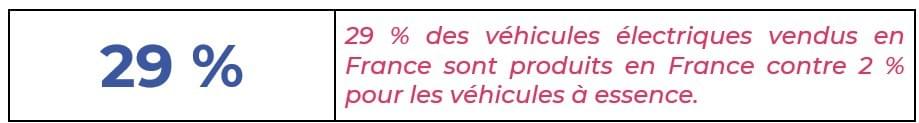
Quelles failles ou rigidités institutionnelles freinent l’exécution ?
L’une des difficultés majeures réside dans la polarisation du débat public, encore capté par le clivage nucléaire vs. renouvelables. Or, d’autres sujets essentiels comme la chaleur ou les réseaux sont laissés de côté. Les ONG, historiquement focalisées sur la sobriété ou sur des positions antinucléaires, sont aujourd’hui moins présentes sur certains sujets stratégiques. Cela crée un vide, souvent comblé par les lobbies.

Comment recomposer le débat public sur l’énergie, pour mieux répondre à la crise écologique ?
Il faudrait effectivement sortir d’une logique binaire pour remettre au cœur du débat des sujets comme la chaleur, les usages, la fiscalité ou la résilience. Le débat ne peut plus se réduire à une opposition entre nucléaire et renouvelables, car la transition impose une hybridation raisonnée.
Quels acteurs ou coalitions pourraient crédibiliser un récit d’indépendance énergétique réaliste et mobilisateur ?
Les ONG ont un rôle à jouer, à condition de sortir d’une posture défensive. Elles sont crédibles sur la sobriété, mais doivent s’impliquer davantage sur des sujets comme les réseaux de chaleur, les pompes à chaleur, ou encore les certificats d’économie d’énergie. Certaines expérimentations existent : l’État travaille davantage avec des acteurs différents comme par exemple des associations de consommateurs, Une mobilisation citoyenne peut émerger autour de ce type d’acteurs.
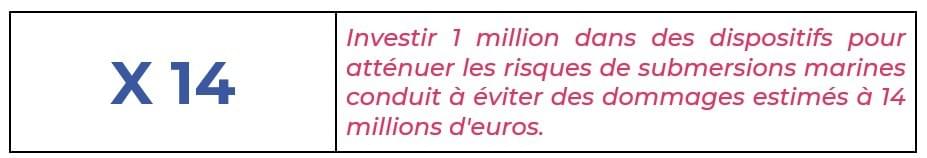
Pour accélérer la transition énergétique, centrale dans la crise écologique, quelles innovations institutionnelles sont à envisager ?
Il faut donner de la visibilité. L’adoption de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) est essentielle car elle permet d’envoyer les bons signaux aux investisseurs et de déclencher les appels d’offres, notamment dans l’éolien en mer. Il ne s’agit pas de prétendre qu’il n’y a qu’un seul chemin possible, mais de montrer que la direction est partagée.
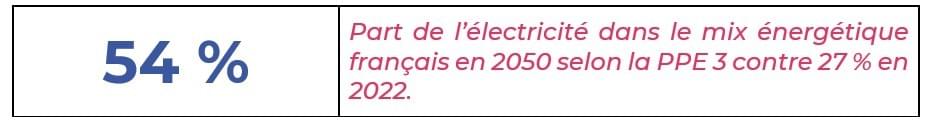
L’une des résistances, ce sont les clivages. Comment articuler récit de sobriété et récit de souveraineté alors que nous vivons une ère de vide narratif ?
Les dynamiques locales sont les plus efficaces pour sortir du débat politicien. À l’échelle d’un territoire, les solutions concrètes prennent le pas sur les postures. Il faut encourager les coalitions hybrides entre ONG, collectivités, consommateurs et État. Ces alliances sont les seules capables de faire émerger un récit crédible de transition juste, et de dépasser les lignes de fracture classiques. C’est l’objet des COP régionales.
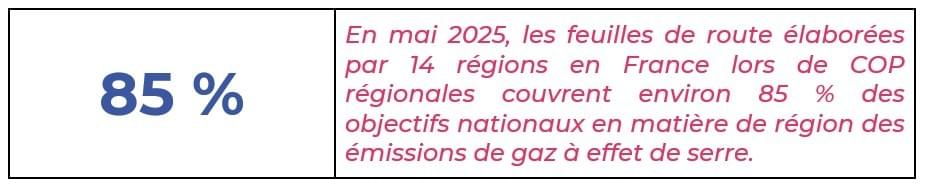
Quelle mesure structurante recommanderiez-vous pour sécuriser l’indépendance énergétique de la France tout en accélérant la transition ?
La priorité immédiate est l’adoption de la PPE. Ce document est la condition sine qua non pour enclencher les dynamiques industrielles, donner de la visibilité aux acteurs économiques et structurer les appels d’offres. Il faut mieux mobiliser les ONG sur des sujets concrets comme les pompes à chaleur, afin de contrebalancer l’influence des acteurs gaziers et de réorienter les récits vers la sobriété, l’efficacité, et la résilience.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».
