


- | Nos activités
- Polycrise
- …
- | Nos activités
- Polycrise


- | Nos activités
- Polycrise
- …
- | Nos activités
- Polycrise

Comprendre la polycrise
Comprendre la crise politique | Résumé pour les décideurs
Pour combattre la polycrise, régénérer l’éthique politique à partir de l’obligation intergénérationnelle
Depuis quelques mois, se multiplient les « premières fois », les « inédits », les moments de « rupture ». Ils installent une lassitude même au sein des observateurs les plus aguerris de la vie politique. Tous en déduisent la même chose, quelle que soit leur tendance idéologique : quelque chose — mais quoi ? — est en train de craquer. La crise politique est là, puisque nous craignons tous de perdre quelque chose, et ne savons plus exactement ce que nous avons à sauver sinon une forme de stabilité.
Cette crise touche au cœur même de ce qui fait une société politique : la capacité à formuler un horizon commun, à inscrire les générations et plus globalement la population dans sa diversité dans un récit partagé, à mobiliser la puissance collective pour affronter des défis historiques.
Ce dérèglement du politique s’entrelace avec les autres dimensions de la polycrise, les crises géopolitique, écologique et économique dont il amplifie les effets. À mesure que le débat démocratique s’enraye, les autres crises trouvent un terrain plus instable où se déployer, transformant une série de chocs sectoriels en une polycrise systémique.
L’effritement de la notion de progrès agit comme une faille structurante. Longtemps, cette croyance partagée en un avenir meilleur a servi de boussole collective, légitimant les réformes et justifiant les efforts. Elle s’est aujourd’hui brisée notamment sous le poids des mutations considérables que nous avons refusé de prendre en compte, notamment la bascule démographique qui rend caduque un système social pensé pour une société jeune. Ainsi, plus personne ne croit aux lendemains qui chantent pour lui-même ou ses enfants. La peur de la guerre, du dérèglement climatique et de la paupérisation nous obstrue la vue. Il en découle un court-termisme institutionnalisé qui se heurte aux urgences qui nous somment d’agir, alimentant un cercle vicieux entre désorientation politique et paralysie stratégique.
La fracture générationnelle est au cœur de ce désalignement. Le vieillissement démographique concentre le pouvoir électoral et budgétaire dans les enjeux du présent voire du passé. La jeunesse, qui constitue désormais une minorité politique, se voit privée de leviers réels pour faire évoluer sa propre condition.
Parallèlement, l’espace public se fragmente sous l’effet de l’économie de l’attention. Les réseaux sociaux, de plus en plus utilisés pour s’informer, enferment chacun dans des bulles émotionnelles. Ils privilégient la viralité sur la véracité, amplifient les émotions et fragmentent la parole politique. Les institutions sont piégées : lorsqu’elles s’expriment, elles suscitent la suspicion ; lorsqu’elles se taisent, elles laissent proliférer des récits concurrents. Cette désorientation informationnelle est également un vecteur d’instabilité géopolitique, exploitée par des acteurs extérieurs qui tirent parti de la fragmentation interne des sociétés.
Face à ces failles, des réflexes autoritaires réapparaissent. Le vide narratif et la peur légitiment la marginalisation des voix critiques et la stigmatisation des minorités. Cette tendance prétend restaurer l’ordre mais aggrave les fractures sociales et politiques.
Répondre à cette crise exige plus qu’une réparation institutionnelle. Il faut restaurer la capacité démocratique à ouvrir un horizon commun et renouer avec une ambition politique capable d’articuler progrès, justice et durée. Le récit linéaire du progrès doit être repensé : non plus comme une marche uniforme vers un futur meilleur, mais comme l’élaboration collective de politiques qui font sens dans un monde soumis à de multiples crises qui s’alimentent mutuellement.
Cela nécessite un espace public régulant la conflictualité sans l’étouffer en reconnaissant le désaccord comme dynamique démocratique légitime. Dans ce cadre, les corps intermédiaires et les associations doivent retrouver leur rôle structurant. De nouveaux canaux délibératifs doivent émerger. La transparence algorithmique doit advenir.
Le politique doit également se réapproprier sa capacité à articuler efficacité et justice. Les instruments démocratiques doivent redevenir transformateurs et garantir un espace d’action partagé compréhensible et ouvert. La démocratie ne se résume pas à ses formes institutionnelles, elle se fabrique « par le bas » via la délibération, la transparence des arbitrages, l’ouverture aux compétences citoyennes.
Cette refondation passe aussi par une transformation profonde des rapports entre générations. Il devient urgent de créer des mécanismes institutionnels de représentation du temps long et d’intégration des générations futures comme sujet politique. Ces dispositifs sont de véritables leviers démocratiques décisifs pour reconnecter la décision collective aux temporalités humaines et écologiques. La crise politique actuelle agit comme un révélateur des fragilités accumulées et de ses conséquences pour les autres pans de la polycrise. Elle oblige à repenser les fins du politique à l’échelle européenne. Elle peut conduire au repli et au durcissement, ou bien devenir l’occasion d’un renouvellement historique, à condition de retrouver le courage de formuler un horizon commun prenant en compte la société dans sa diversité.
Pourquoi la crise politique est-elle systémique ?
Pour comprendre le caractère systémique de la crise socio-économique et la resituer dans le cadre général de la polycrise, découvrez la synthèse réalisée par Juliette Marceaux et la Dr. Élise Rousseau pour l'Institut Open Diplomacy.
Comprendre la crise politique
Hologramme de la polycrise
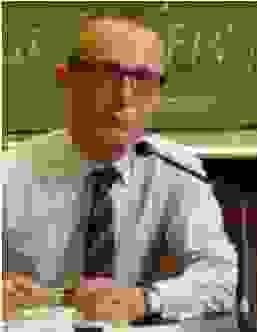
« Le progrès n’a plus le tracé d’une lignedroite : il ressemble plutôt à une cartographie mouvante »
Entretien avec Alexis CHABOT

« Face à la crise du vide narratif, nousdevons créer une nouvelle fabrique à imaginaires collectifs »
Entretien avec Emmanuel RIVIÈRE

« Nous faisons face à une crise de la projection et au vide abyssal de cette question : quel avenir pour une
génération sans promesse ? »Entretien avec Vincent COCQUEBERT

« Avant,l’avenir se pensait au travers de la jeunesse ; aujourd’hui, l’avenir est pensé
par une génération qui n’en vivra qu’une fraction »Entretien avec Maxime SBAIHI
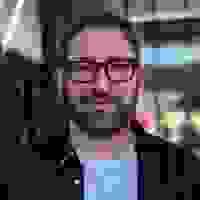
« Les plateformes numériques ne sont pas des outils neutres ; ce sont de véritables puissances qui lancent un défi à notre souveraineté politique et cognitive »
Entretien avec Thomas HUCHON
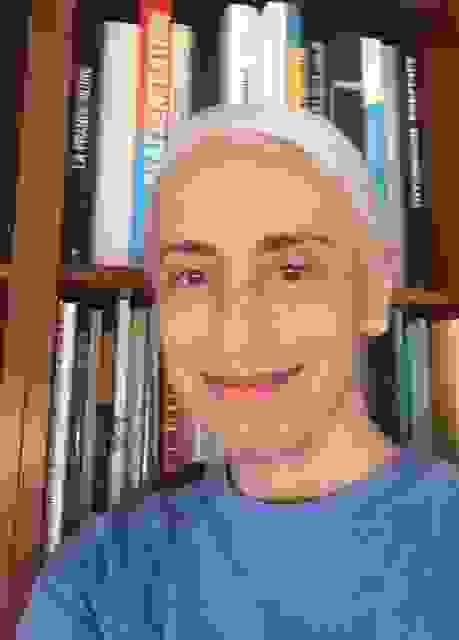
« Nos sociétés ne veulent plus assumer collectivement la responsabilité du lien intergénérationnel »
Entretien avec Caroline IBOS
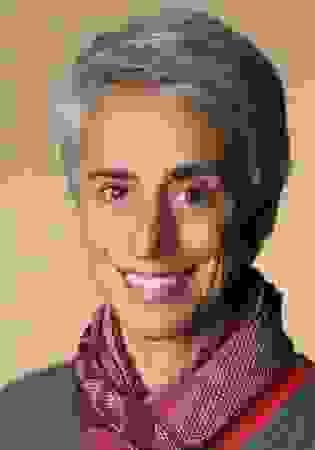
« aaaa »
Entretien avec Caroline IBOS
comprendre la polycrise
crise géopolitique | crise écologique | crise socio-économique | crise politique






