« Notre effort capacitaire doit faire l’objet d’un alignement plus rigoureux avec nos intérêts de sécurité et nos ambitions » alerte Jean-Charles LARSONNEUR
« Notre effort capacitaire doit faire l’objet d’un alignement plus rigoureux avec nos intérêts de sécurité et nos ambitions » alerte Jean-Charles LARSONNEUR
Entretien integrée à la partie « Crise géopolitique » de l'étude « Comprendre la polycrise »
À l’heure du désengagement américain, l’Europe découvre sa vulnérabilité stratégique. Jean-Charles Larsonneur, ancien député et expert des questions de défense, alerte sur le décalage croissant entre les ambitions affichées et les moyens réels. Face à la montée des tensions hybrides, à l’ascension navale de la Chine et à l’économie de guerre assumée de la Russie, l’Europe reste enlisée dans une ambiguïté tactique. Le modèle français, sans doctrine claire, cumule sous-financement chronique et dispersion capacitaire. La BITD européenne, quant à elle, ne survivra qu’à condition de commandes publiques crédibles, de coopérations ciblées et d’un financement assumé, y compris par des acteurs non étatiques. Ce sous-investissement stratégique, prolongé par l’aveuglement budgétaire, pourrait précipiter un déclassement continental. L’Europe n’échappera à la relégation qu’en alignant ses formats d’armée, ses chaînes de valeur et sa souveraineté énergétique sur une vision commune, assumée politiquement.

Quels éléments du contexte stratégique ont-ils aujourd’hui le plus fort impact sur l’enjeu de notre modèle de défense ?
Deux tendances majeures contribuent aujourd’hui à l’enjeu macroscopique de ce que doit ou peut être notre effort de défense.
● Le retrait progressif des Etats-Unis du leadership de l’OTAN, engagé dès Obama, poursuivi par Trump et le président Biden. Ce retrait est confirmé dans les faits, malgré des messages ambivalents et l’entretien de l’incertitude par Trump (cf. propos de Trump critiquant l’article 5 du Traité de Washington avant sa venue au sommet de l’OTAN, puis expliquant son importance lorsqu’il en repart).
● Le décrochage économique structurel de certains pays de l’UE et, à moyen terme, de la totalité d’entre eux face aux États-Unis et à d’autres puissances depuis les années 2000. Ceci se vérifie en termes de PIB, de capacité industrielle, d’innovation, et maintenant aussi sur le plan militaire. Ce décrochage peut également être mesuré à l’aune des conflits de longue durée avec le retour du phénomène d’attrition. En matière d’innovation, on peut observer une fuite des compétences de l’Europe vers les Etats-Unis.
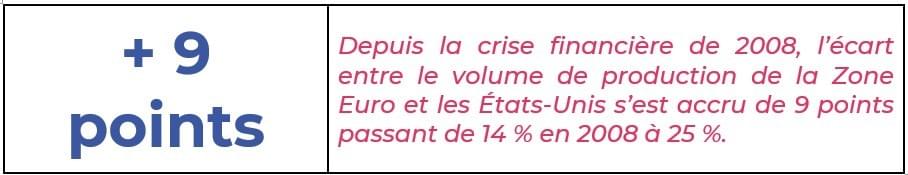
L’illusion selon laquelle la délocalisation serait indolore car l’innovation resterait européenne ne tient plus du tout, sans compter et qu’une bonne partie de la chaîne de valeur se situe hors du continent. Dans le secteur de la défense, seuls quelques segments (aéronautique, naval, spatial) résistent encore et font exception. Toutefois, nous sommes entrés dans une période où le modèle d’innovation a évolué, aujourd’hui ce sont les segments de l’innovation de la civile qui viennent alimenter les innovations militaires et non plus l’inverse, secteur de l’innovation de plus en plus exportées.
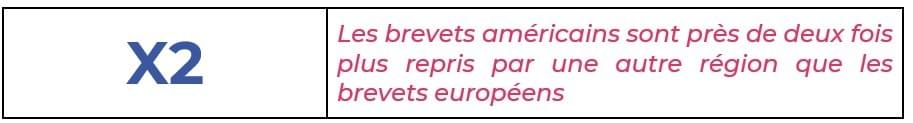
Le récent sommet de l’OTAN (Juin 2025) est-il un marqueur important en termes d’engagements capacitaires et de dynamique transatlantique ?
Oui. D’abord pour les engagements en matière de défense, mais aussi parce que les Européens n’ont finalement pas été brutalisés à La Haye, le Secrétaire général de l’OTAN s’étant « aplati » devant le président Trump, évitant ainsi le cataclysme qui avait pu être envisagé.
L’Objectif budgétaire des pays de l’OTAN pour 2030 est désormais fixé à 5 % du PIB. Au sein de ce pourcentage, il est confirmé la possibilité d’intégrer 1,5 % portant sur toute action contribuant à soutenir l’Ukraine, les investissements en matière de cyberdéfense, ainsi que, notamment, les dépenses liées à la résilience et à la sécurité nationale. L’objectif des 5 % est ainsi moins compliqué à atteindre. Quelques pays ont déjà accédé à ce niveau d’effort, comme les Pays Baltes et la Pologne. D’autres y arriveront vite comme l’Allemagne. Certains enfin, comme la Grèce ou même la France devront faire face à une situation plus compliquée.
S’agissant de la France, la Loi de Programmation Militaire est ambitieuse mais fait face à un déphasage constant entre les annonces et les crédits réellement débloqués. Les gels budgétaires, les retards de paiements conduisent à un effet de bosse dans les livraisons. On commande parfois des projets lourds (Rafale F5, avion spatial VORTEX) sans capacité de paiement fluide. L’action du Trésor public constitue un frein à ces efforts.
En Europe, la tendance des dépenses de défense est à l’augmentation (200 milliards d'euros supplémentaires) mais sans effet stratégique clair. Certains États (Espagne) plafonnent à 2 % en assumant le statu quo. On peut toutefois penser que l’identification de la Russie comme adversaire structurel par l’OTAN contribue à une clarification stratégique qui poussera les Etats vers la cible à 5 % à long terme.
Une réorganisation stratégique est en cours, qui met aussi en lumière les limites de l’Europe. Les États-Unis se retirent partiellement du théâtre européen, montrant le besoin pour les pays européens de combler ou de compenser cette situation. Les Européens affichent leur intention mais restent largement au niveau déclaratif. Les discussions dans l’OTAN sont parfois déconnectées de la réalité, car il n’y a pas de remise en cause officielle de l’article 5 alors qu’un flottement est perceptible. Les États-Unis et les pays européens dont la France sont-ils prêts à se battre en déployer des centaines de milliers d’hommes pour Tallinn ?
Bien au-delà du théâtre Euro-Atlantique, il n’est pas non plus certain que l’US Navy prenne le risque de sacrifier ses navires pour Taiwan. La marine américaine instrumentalise la menace chinoise pour justifier ses budgets, sans réelle intention d’escalade. Il est en ce moment nécessaire d’avoir une lecture régionalisée des dynamiques géopolitiques, un peu « à la Huntington ». On le voit avec les déclarations récentes de Trump sur le Groenland ou le Panama.
Donc on le voit, tout le monde s’accorde sur la nécessité d’un effort en matière de développement capacitaire, mais l’équation est d’abord politique.
En complément ou en lien avec ces observations, il faut bien avoir conscience du phénomène de maritimisation du monde. La dynamique de la Chine illustre cette tendance tandis que l’ensemble des prospectivistes américains projettent cet enjeu de puissance dans le futur.
La Chine est en effet avant tout une puissance navale en devenir. Elle adosse son ambition à des capacités de production massive, qui dépassent celles des Etats-Unis en matière d’industrie navale. Elle ambitionne également un contrôle global des détroits, de la mer de Chine jusqu’à l’Arctique et l’Europe. Cette route de l’Arctique, investie par la Russie et la Chine, devient d’ailleurs une ligne de fracture stratégique. La Chine ne vise pas la guerre, mais une maîtrise des flux maritimes et commerciaux, ce qui constitue en soi une menace indirecte pour l’Occident.
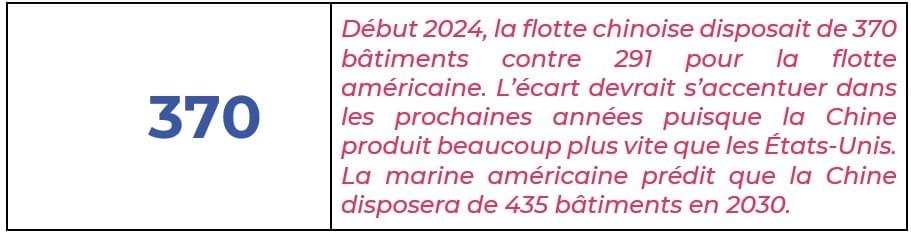
Dans ce contexte géopolitique, que peut-on attendre pour les bases industrielles technologiques de défense (BITD) française et européenne et pour notre effort de défense ?
De nombreux outils pour le développement des capacités de défense existent en Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on peut observer un renforcement de ces outils, notamment via des fonds européens, des projets coopératifs et une accélération de commandes. Toutefois, ces mécanismes européens restent « hors traité », donc à la discrétion des États sauf cas particulier de commande groupée. Ainsi, les vrais leviers en matière d’équipement relèvent de la commande publique par les États. Sans celle-ci, il n’y a pas d’effet structurant sur les BITD.
Des coopérations à l’échelle européenne et réussies existent pourtant, comme l’A400M, le Tigre, les frégates Horizon, le spatial etc., mais elles restent rares. « Quand il y a trop de crocodiles dans la marre, il y en a un qui finit par manger les autres » : trop de partenaires dans un programme tue la cohérence. Les coûts de coopération et la convergence des besoins et des qualifications constituent des obstacles qui empêchent parfois les programmes d’aller jusqu’à leur terme. A titre d’exemple, le char européen sera « allemand », car les industriels français du terrestre (JCD/ARKUS etc.) auront peu de marge de manœuvre dans cette filière qui sera dominée par leurs partenaires d’outre-Rhin. Cette problématique restera toute relative dès lors que la France gardera sa maîtrise en matière d’industrie navale et de d’aéronautique.
Même si, au plan politique, les démocraties européennes subissent des secousses, il y a une convergence d’ensemble dans la perception de la menace. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il existe une réelle volonté de construire une Europe de la défense avec une instance communautaire ayant vocation à commander des produits standardisés. Cet objectif n’est pas inscrit dans les traités européens et les états-membres n’y sont pas prêts.
In fine, même si les coopérations sont compliquées, une BITD européenne ne pourra se construire que par quelques coopérations qu’il faudra arrimer à des programmes sérieux pour leur assurer un débouché.
Mais, encore une fois, c’est bien la commande publique – et donc la question de son financement- qui est au cœur de l’équation du développement des capacités de défense. A cet égard, l’Allemagne fait de gros efforts de rattrapage, mais ses contraintes budgétaires à moyen terme posent question. S’agissant de la France, le financement d’un effort de défense crédible doit passer par une réforme structurelle de la dépense publique, puisque les pratiques actuelles ne le permettent plus. Si on est sérieux, il est indispensable de réaliser des économies quelque part pour dépenser dans la défense. Le besoin de faire des économies à travers des réformes dans les domaines de la protection sociale et des retraites doit être considéré.
Or les réformes ont toujours été compliquées en France, et ce d’autant plus depuis la crise de la COVID-19 qui a chamboulé la perception mentale des Français dans un contexte où on explique le besoin d’une réforme des retraites pour gagner 6 milliards d’euros alors que plusieurs centaines de milliards d’euros ont été dépensés durant la crise sanitaire. Quelle qu’en soit la difficulté, des réformes structurelles sont nécessaires pour que la France puisse se relever. La Vème République est à bout de souffle avec la tripartition et des gouvernements incapables de déboucher sur des budgets crédibles et sérieux.
Le financement de la BITD peut passer par des investissements via des fonds, des banques, mais le plus important reste la qualité des projets. Si un projet est bon, il trouvera des financements alors que si l’on oriente uniquement des subventions vers des start up ayant des idées - mais pas forcément les meilleures-, c’est un peu comme « arroser le désert ».
Aujourd’hui, des solutions innovantes de financement apparaissent dans ce milieu. Ainsi, des assureurs souhaitent financer directement des achats d’équipements militaires, en achetant par exemple des flottes de camions logistiques, et pourquoi pas des frégates etc. Le leasing (LOA) avec obligation d’achat à terme, soutenues par des fonds privés (assureurs, banques) est une modalité qui fait son chemin dans la réflexion stratégique. L’intérêt du LOA est de pouvoir sécuriser les industriels et l’armée en lissant les dépenses sur 10 ans, même si son inconvénient est un coût plus élevé à terme que l’achat direct. Cette formule pourrait s’imposer en raison de la contrainte budgétaire mais imposerait de garantir que l’État « passe à la caisse » sur le long terme et perde également une forme de souveraineté en n’étant plus le propriétaire de ces moyens.
Alors que sur l’exercice des LPM, la garantie d’achat ne l’est pas toujours, ce système de LOA est dynamique et positif, présente un coût moins élevé au début en offrant l’avantage d’une livraison rapide. Par contre, il impose une obligation d’achat in fine comme mentionné supra et donc un coût global plus élevé. Cette option a été écartée depuis longtemps par les armées, mais le contexte budgétaire tendu pourrait la justifier.
Quelles conséquences pour notre doctrine et notre format d’armée ?
Un format d’armée doit et devrait être la réponse à une vision géostratégique du monde. Or la France n’a pas toujours eu une idée claire en la matière. Lorsque l’on entend les positions françaises, on constate que l’on se fâche avec beaucoup d’Etats, que nous ne sommes appréciés ni d’Israël, ni des pays Arabes. Si nous voulons être un leader en Europe, il est nécessaire de réviser le format d’armée actuel. Dans un contexte où la tendance américaine est au retrait du continent, le format des armées européennes doit évoluer. Plutôt que d’envisager une armée surdimensionnée, la question en France doit porter sur la manière dont nos capacités peuvent être utilisées pour défendre le continent, en particulier à travers une posture de dissuasion tant navale que aérienne. Pour imaginer l’armée de demain, l’étape indispensable est celle de l’expression d’une vision stratégique.
Les Britanniques connaissent une situation comparable à la nôtre, avec une ambition politique et de réelles capacités dans de nombreux domaines. Ils arrivent toutefois à énoncer clairement leurs priorités. Ils mentionnent par exemple un besoin de « X » sous-marins pour assurer des missions spécifiques en Atlantique nord en ayant la capacité de réduire des dépenses ailleurs. L’armée française, dans son format actuel, présente l’aspect d’un “couteau suisse” : un peu de tout, bien formé, mais sans masse. Même si, dans le contexte géopolitique actuel, il n’est pas déraisonnable de conserver un tel modèle face à une guerre future aux caractéristiques incertaines, nous manquons d’une doctrine claire : veut-on défendre le continent ? Intervenir globalement ? C’est ce que la revue stratégique doit pouvoir préciser pour pouvoir aligner stratégie et moyens.
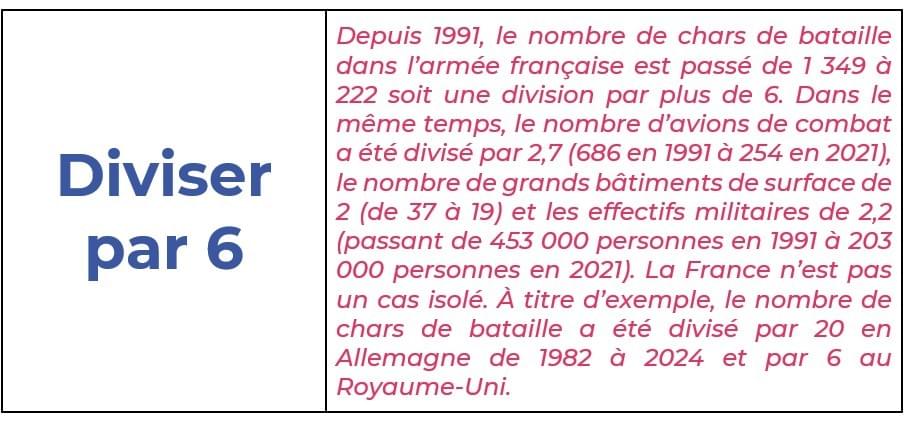
Notre effort stratégique doit passer par un réalignement de notre format d’armée sur une vision géopolitique crédible, appuyé par une révision du périmètre budgétaire et par des coopérations ciblant des programmes aboutis, tout en ne surestimant pas le rôle des institutions européennes. Les questions de souveraineté et de coordination entre les Etats doivent être articulées intelligemment dans un contexte où, s’agissant des efforts capacitaires, la priorité repose sur les commandes. Sans commandes claires et sans priorités affirmées, la BITD ne pourra pas répondre efficacement.
En lien direct avec le phénomène de polycrise, quelle pourrait être le rôle des sociétés dans ce contexte ?
Le niveau de sensibilisation des sociétés n’est pas suffisant dans un contexte qui nécessite un sursaut.
Des partis politiques, comme « Place publique », de centre gauche et pro-européen, considèrent que la défense de l’UE est une priorité, assimilant une attaque éventuelle contre Tallinn à une attaque contre Paris. Or il existe un décalage entre ce type de discours et une vision sociétale différente.
La préparation civilo-militaire doit s’accentuer, en s’inspirant de modèles comme celui de la Suède. Initialement, la Suède était un pays que l’on pourrait qualifier de « bisounours ». Or, en 10 ans, notamment grâce des organismes et des actions de sensibilisation, l’Etat a élevé le niveau de préparation de la société à la guerre, notamment à travers un concept de « défense globale » intégrée, des milices civiles et la constitution de stocks.
Cette notion de préparation des esprits est importante : les Français préféreront-ils que la Russie établisse un espace-tampon ressemblant à un nouveau pacte de Varsovie plutôt que d’aller se battre pour l’Ukraine ?
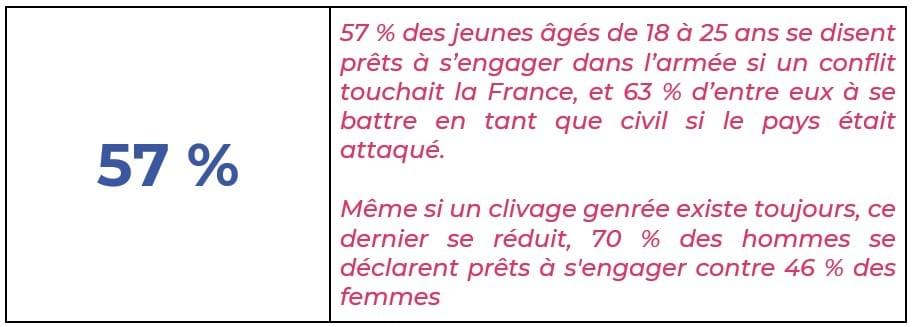
Si l’on fait un peu de prospective, quels pourraient être les scénarios possibles face à l’enjeu de la nécessité d’un effort de défense renouvelé ?
À un horizon de 5 à 10 ans, trois scénarios principaux peuvent être envisagés pour l’Europe et la France, en lien avec l’évolution de la Russie et la capacité de l’Union européenne à se structurer autour d’un effort de défense crédible.
Un premier scénario pourrait être celui d’une Russie maintenant sa trajectoire de militarisation intensive et consolidant une véritable économie de guerre. A cet égard, « l’économie de guerre » dont il est parfois question en Europe relève souvent davantage du discours incantatoire qu’elle ne correspond à une réalité. Ainsi, chez nous, même si la DGA a amélioré ses procédures administratives, même si la production s’est fluidifiée dans certains domaines, il ne s’agit en rien d’une mobilisation économique comparable à celle de la Russie.
L’économie de guerre suppose un effort de l’ordre de 20 % du PIB directement orienté vers les dépenses militaires. Historiquement, ceci renvoie au niveau d’effort que le Royaume-Uni avait mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, aujourd’hui, la Russie s’approche de ce seuil en matière de pourcentage de la dépense étatique.
Si cette dynamique se poursuit, en cohérence avec une vision géostratégique offensive (comme le montre la situation en Ukraine ou le renforcement militaire russe le long de la frontière finlandaise), elle pourrait s’accompagner d’une stratégie hybride soutenue dans les années à venir, générant par exemple davantage d’instabilité autour de la Moldavie et de la Géorgie.
Ce scénario pourrait signifier un affaissement de la capacité européenne « à suivre », du fait de difficultés économiques persistantes et dans le contexte aggravant d’un retrait ou d’une relative indifférence des États-Unis si les Européens ne prenaient pas pleinement en charge leur sécurité.
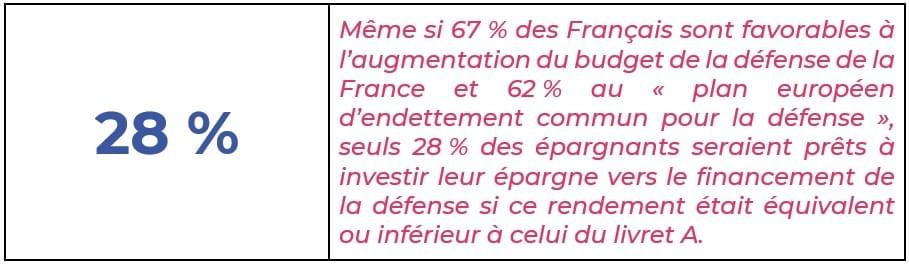
Dans un tel cas de figure, la Russie pourrait établir une sphère d’influence allant jusqu’en Europe de l’Est, avec potentiellement des régimes en Moldavie, en Roumanie, voire dans l’ancienne Allemagne de l’Est, qui entreraient sous sa tutelle politique ou stratégique.
Un deuxième scénario, de tendance inverse, reposerait sur un affaiblissement durable de l’économie russe, incapable de reconstituer ses armées ou de soutenir un effort de guerre prolongé. L’Union européenne, en parallèle, poursuivrait sa trajectoire actuelle d’un réarmement partiel, avec un certain rééquilibrage stratégique à l’Est, notamment autour d’un soutien fort et pérenne à l’Ukraine. Cela permettrait de renforcer la composante européenne de l’OTAN et de marginaliser la Russie comme puissance militaire crédible. Mais un tel scénario suppose un affaissement interne du système russe, tant sur le plan de la société que de ses structures de production, ce qui paraît peu probable à court terme. Moscou dispose en effet de ressources (énergétiques, minières, humaines) que l’Union européenne n’a pas et, surtout, la Chine n’a aucun intérêt à voir s’effondrer la Russie. Pékin ferait tout pour éviter que Moscou ne devienne un vide stratégique.
Le troisième scénario, peut-être le plus plausible, est celui d’une situation intermédiaire. Les Européens poursuivraient à peu près leur ligne actuelle, sans franchir le seuil d’une vraie économie de guerre, tandis que la Russie parviendrait à reconstituer des forces armées crédibles malgré ses difficultés. La confrontation russo-ukrainienne se transformerait en un conflit gelé, mais des menaces hybrides récurrentes se multiplieraient à l’encontre de plusieurs pays européens, avec un usage actif de la désinformation, du sabotage, et d’autres actions indirectes sur les marges orientales de notre continent. C’est donc une situation de tension latente, de confrontation stratégique non déclarée, qui s’installerait durablement. Cela correspond en partie à ce qui se dessine aujourd’hui, à en juger par les signaux captés lors du dernier sommet de l’OTAN, où l’on observe certains pays (comme la Pologne) progresser de façon significative en matière d’effort de défense, tandis que d’autres peinent à suivre. Dans ce scénario, la Russie ne se porterait pas nécessairement « bien », mais conserverait une capacité de nuisance et de pression. L’Europe, elle, glisserait lentement vers une forme de paupérisation relative vis-à-vis des autres grandes puissances.
Si l’on revient sur le terme « d’économie de guerre », pourquoi selon vous ne correspond-il pas à une réalité ? Que peut-on dire sur l’appréciation de la menace ? A quels blocages faisons-nous face ?
L’expression « économie de guerre », telle qu’elle circule dans le débat public et politique en France, relève essentiellement du slogan. Elle agit comme un artefact discursif plus que comme une orientation réelle des politiques publiques. Si l’on suit la logique du simulacre décrite par « Baudrillard », on pourrait dire que ce discours est la simulation d’un engagement stratégique : une façon de donner le change, de jouer la guerre sans y croire, d’exhiber une volonté de puissance tout en en masquant l’absence de fondement concret. Aucune élite politique française ne semble aujourd’hui se projeter véritablement dans une perspective de transition vers une économie de guerre au sens fort, c’est-à-dire une mobilisation profonde et planifiée de l’appareil productif et financier au service de l’effort militaire.
Cette absence de projection est révélatrice d’un fait massif : personne ne croit réellement qu’un conflit majeur impliquant directement la France est à l’horizon. Ce déni implicite renforce l’idée que nous ne ferons pas la guerre — ou du moins que nous ferons tout pour ne pas la faire. La déclaration d’une entrée en économie de guerre vise alors moins à préparer la guerre qu’à crédibiliser un récit de dissuasion défensive : plus nous nous montrons prêts, moins nous aurons à nous battre. Pourtant, ce discours repose sur une contradiction fondamentale : si la menace n’est pas jugée crédible, pourquoi mobiliser autant de ressources ? Et si elle l’est, pourquoi ne pas assumer une montée en puissance plus cohérente et déterminée ?
Dans le cas de la Russie, par exemple, l’idée que celle-ci représente une menace pour le territoire national français est souvent jugée absurde ou exagérée par les décideurs. Mais ceux-ci commettent une erreur d’analyse. Car si l’Europe de l’Est venait à basculer sous domination russe, les répercussions politiques, stratégiques et économiques seraient considérables pour la France. Garantir l’intégrité territoriale et politique de cette région est une condition essentielle à la stabilité démocratique de l’Europe dans son ensemble. Or, tant que l’agression ne se manifeste pas directement sur notre sol, les élites françaises refusent de penser sérieusement à cette éventualité. La projection stratégique reste ainsi limitée, voire inexistante.
Un second élément de tension réside dans la disjonction croissante entre l’appareil administratif, qui anticipe et prépare, et la sphère politique, qui refuse d’endosser la responsabilité de décisions d’engagement réels. La commande publique en matière de défense avance, les armées se modernisent, les procédures se fluidifient. Mais sur le plan politique, aucune articulation stratégique cohérente ne se dessine. Que ferait-on, concrètement, si la Russie accentuait sa pression militaire sur l’Est de l’Europe ? Existe-t-il un scénario d’intervention assumée, validé par l’exécutif ? Aujourd’hui, rien ne semble le prouver.
Nous sommes alors dans une logique de « vitrine stratégique » : un discours de façade, une vitrine militaire bien entretenue, mais sans véritable corps politique derrière. La notion même d’économie de guerre devient un outil de communication visant à produire de la dissuasion par une démonstration de capacité : plus nous semblons armés, plus nous pourrions espérer maintenir la paix. Mais ce raisonnement circulaire masque le cœur de ce dilemme déjà évoqué : si nous ne croyons pas à la guerre, pourquoi mobiliser autant de moyens ? Et si nous croyons qu’elle est possible, pourquoi ne pas aller plus loin dans sa préparation ?
Ce paradoxe résume une ligne de tension centrale dans la posture française : entre la volonté d’apparaître puissants et la peur de se projeter dans un affrontement réel, entre la croyance dans le pouvoir de la dissuasion et l’absence d’une vision stratégique claire. En définitive, le discours sur l’économie de guerre tente de conjurer l’idée même de guerre. Il ne traduit pas une anticipation du pire, mais l’espoir que son évocation suffira à l’éviter.
En quoi l’enjeu de la défense est-il constitutif du caractère systémique de la crise ?
L’enjeu de défense est en effet profondément connecté aux autres dimensions systémiques de la crise : changement climatique, crise énergétique, pression migratoire, transition démographique. Ce sont des cercles d’interactions plus que des silos isolés. Le climat modifie les ressources disponibles, déstabilise des régions entières, accentue les migrations. L’énergie détermine la capacité industrielle, les chaînes logistiques, l’autonomie stratégique. La démographie influence la capacité de projection et de renouvellement des forces, ainsi que la stabilité des régimes.
Ces crises ne se succèdent pas ; elles s’imbriquent, se renforcent mutuellement, et rendent la gestion de la sécurité plus complexe. La défense n’est donc pas un enjeu parallèle ou concurrent des autres défis contemporains : elle en est une composante transversale. Dans ce contexte, ne pas anticiper la convergence de ces dimensions revient à se préparer à subir.
On peut aussi inclure dans ce système de crises celle des démocraties européennes avec le questionnement lien armées-nations déjà évoqué.
Les effets de cette interaction systémique sont encore largement sous-estimés. Le changement climatique en est un exemple central : on anticipe encore assez mal les conséquences concrètes de celui-ci, notamment sur les ressources hydriques, la santé publique ou les flux migratoires. Les bouleversements à venir seront immenses et contribueront à appauvrir durablement certaines régions, ce qui générera des urgences sociales et politiques auxquelles nos systèmes ne sont aujourd’hui pas préparés.
Dans cette école de la pensée systémique, on assiste à une accélération des changements, mais l’Europe semble en retard. Il existe pour nous un risque réel de relégation stratégique et économique. L’image du déclassement trouve sa source dans notre mémoire historique, avec la crise de Suez en 1956 ou les désillusions de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et semble se prolonger aujourd’hui. Le décalage est profond entre la perception que nous avons de notre statut et la réalité de notre position géopolitique. Le climat, en particulier, agit comme un multiplicateur de crise : à travers la perception de ce problème, il affecte ainsi la démographie (avec une baisse inquiétante de la natalité, y compris en France, où l’on pensait disposer d’une exception démographique, actuellement à 1,7 enfants par femme au lieu des 2,1), il intensifie les tensions migratoires, et il accentue les peurs collectives que certaines forces politiques exploitent à des fins populistes.
Or, il est très difficile d’anticiper rationnellement ces évolutions tant elles sont incertaines et complexes. Les tensions autour de l’arc méditerranéen, les conflits autour des ressources énergétiques et les fragilités des États riverains sont autant de dynamiques imbriquées. Même si elles ne relèvent pas directement du changement climatique, elles y sont liées, et contribuent ensemble à bouleverser tout le jeu géopolitique.
Existe-t-il un ou plusieurs points de bascule qui pourraient faire radicalement évoluer l’enjeu de nos efforts en matière de défense ?
Le principal point de bascule réside dans la question énergétique. Si la dépendance énergétique européenne n’est pas maîtrisée, elle pourrait en effet générer des ruptures majeures, tant sur le plan militaire que politique. Actuellement, l’Union européenne n’est pas en bonne posture : en dehors de quelques ressources françaises comme le lignite, la forêt ou un peu de nucléaire, elle reste structurellement vulnérable. Les armées commencent certes à s’intéresser à de nouvelles formes de mobilité et à réfléchir à des alternatives, mais cela demeure marginal.
La bascule pourrait se produire rapidement si les flux énergétiques étaient détournés. Aujourd’hui, 80 % du pétrole du Moyen-Orient est à destination de la Chine. Le gaz, quant à lui, était historiquement très lié à la Russie. Alors que reste-t-il à l’Europe ? Une grande incertitude. Un conflit qui serait déclenché pour des raisons énergétiques n’est pas un scénario de science-fiction : dès 1986, dans « Tempête rouge », le romancier Tom Clancy imaginait une guerre causée par une pénurie pétrolière en Russie. Une démocratie ne peut prospérer que si elle est énergétiquement souveraine. La perte de contrôle sur cette ressource clé pourrait ouvrir la voie à des affrontements majeurs.
À ces questions de dépendance et d’accès aux ressources énergétiques s’ajoute l’effacement progressif de la notion classique de « front » : nous entrons dans une ère de confrontation hybride, où la guerre ne s’exprime plus seulement par les armes, mais par des atteintes profondes aux réseaux d’infrastructure, à la résilience sociale, aux systèmes de santé et d’énergie. La guerre d’Ukraine, de ce point de vue, illustre bien l’usage stratégique des frappes dans la profondeur avec les coupures d’électricité, les attaques sur les hôpitaux, et des effets systémiques lourds. Toute crise militaire peut devenir alors une crise sociale, démographique et institutionnelle.
Quels acteurs non traditionnels pourraient, selon vous, contribuer à un renouveau ou à la disparition de certains blocages autour de l’enjeu de la défense ?
Les acteurs financiers, les banques, les compagnies d’assurances, les fonds d’investissement, ont un rôle crucial à jouer, alors que leur implication est encore aujourd’hui trop partielle. Leur engagement se situe souvent sur le « haut de bilan », à travers des mécanismes de garantie ou de financement de projets, mais il manque encore un ancrage fort sur le « bas de bilan », c’est-à-dire sur la commande publique directe.
En théorie, un bon projet trouve toujours son financeur. Mais dans les faits, l’Europe perd de nombreux projets stratégiques au profit de la Chine ou des États-Unis, notamment dans les secteurs clés de l’innovation. Elle perd également beaucoup de ses talents : chercheurs, ingénieurs, cadres de haut niveau quittent le continent pour être mieux rémunérés ailleurs, parfois quatre à cinq fois plus, dans des environnements plus dynamiques.
Nous avons un problème d’allocation de l’épargne. En France, l’épargne existe, mais elle est souvent investie dans des fonds de pension américains qui, eux-mêmes, financent les industries stratégiques américaines dont les produits sont ensuite achetés par les Européens. Certains responsables politiques, comme le député Jean-Louis Thiériot, ont proposé la création de produits d’épargne fléchés vers la défense : par exemple, un fonds dédié, qui serait inspiré du Livret A et géré par la Banque publique d’investissement, mais bloqué pendant cinq ans, avec un rendement modéré. Ce type de mécanisme permettrait de canaliser une partie de l’épargne vers des projets industriels structurants pour la défense, toutefois sans garantie et avec une rentabilité incertaine.

Bercy reste malheureusement très réticent à flécher l’épargne populaire vers la défense. Pourtant, on pourrait imaginer de nouveaux produits bancaires spécialisés, à l’image de ce qui s’était fait autrefois pour les investissements ESG (Environnemental/Social/Gouvernance). Certaines banques commencent à le faire timidement. On voit aussi apparaître des projets où des acteurs privés financent des flottes de véhicules ou de navires militaires, loués ensuite aux États (LOA supra). Mais ce type de schéma ne pourra pas se généraliser facilement : cela pose d’importants problèmes de souveraineté tandis que d’autres questions pratiques se posent : si une « flotte privée » était attaquée, qui en serait responsable ? Qui la défendrait ? L’État peut-il externaliser une partie de ses moyens de souveraineté ? In fine, quid de la notion de souveraineté ?
Selon vous, quelles orientations politiques et institutionnelles sont souhaitables ou même nécessaires aux plans européen ou national pour affronter ces défis ?
Si l’on se plaçait dans la position d’un ministre de la Défense ou d’un Président de la République, le premier impératif stratégique serait d’imposer la réalisation de revues stratégiques approfondies, assorties de vrais choix. Ces choix devraient être clairs, hiérarchisés, assumés politiquement. Il s’agirait de sortir de l’ambiguïté « tactique » dans laquelle nous évoluons trop souvent, et de redonner un sens « stratégique » à l’effort de défense.
Il faut commencer par affirmer que la survie du modèle démocratique et social européen dépend d’un certain équilibre de paix et de prospérité sur le continent.
Or, cette paix ne peut être durable sans cohésion entre les nations européennes. Dès lors, que voulons-nous précisément ? Sans doute éviter que la Russie s'établisse une sphère d’influence répliquant ce que fut celle du pacte de Varsovie ; sans doute prévenir tout risque d’agression directe ou indirecte contre nos partenaires de l’Est. Il s’agit à la fois de dissuader l’attaque territoriale et de protéger nos voies d’approvisionnement, notamment énergétiques. Cela implique que le format de nos armées soit conçu en fonction de cet objectif, avec des forces structurées pour la dissuasion conventionnelle, la défense collective, et la sécurisation stratégique de notre hinterland énergétique.
Pour y parvenir, il faut renforcer le pilier européen au sein de l’OTAN, clarifier le partage de tâches capacitaires entre pays alliés, et repenser les modalités de la commande publique en matière de capacités de défense. Ce travail doit se faire en considérant chaque spécificité nationale. Par exemple, la Pologne, en raison de sa proximité physique avec la Russie, a vocation à investir massivement dans les chars, la défense antiaérienne et les stocks logistiques. La France, pour sa part, dispose d’un avantage comparatif en matière navale, pour les frappes dans la profondeur, dans les opérations spéciales et les capacités aériennes avancées. Elle pourrait aussi développer une spécialisation terrestre d’appui, en soutien aux forces polonaises et baltes. Mais tout cela doit être articulé dans une logique de coordination interétatique, à l’échelle du continent.
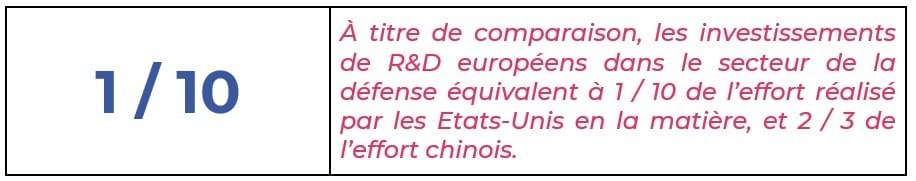
La question est donc bien celle du lien entre les moyens engagés et les intérêts nationaux, replacés dans le cadre d’une défense collective européenne.
Or l’Union européenne n’est pas aujourd’hui le bon cadre opérationnel, car trop administrative et trop lente, mais elle peut jouer un rôle croissant en facilitant les convergences et les financements. Cela ne fonctionnera que si les États décident de se structurer eux-mêmes, dans un cadre flexible mais concerté. La complémentarité avec les États-Unis sera ici déterminante, à condition que ceux-ci ne cherchent pas à imposer unilatéralement leur logique industrielle ou stratégique, et à contrarier les efforts des Européens qui cherchent à s’organiser. Il n’est pas nécessaire que tous les États-membres soient impliqués dans une telle dynamique : une coordination à 12 ou 14 pays suffirait pour bâtir une base robuste.
On observe déjà des mouvements de ce type, notamment chez les pays nordiques, qui réactivent des formes de coopération de défense très poussées. Ils s’organisent pour mettre en place des capacités communes de planification, de commandement, d’administration, mais aussi pour articuler leurs commandes d’équipements dans une logique de complémentarité. La France devrait s’inscrire dans cette dynamique. Une fois les fondamentaux posés, si la commande publique devient lisible, crédible et orientée vers des objectifs réalistes, la BITD suivra. Un tel mouvement supposerait toutefois de lourds renoncements pour d’autres politiques publiques, et d’accepter de porter effectivement l’effort de défense à 3,5 % du PIB.
Il faut donc dépenser plus, mais surtout dépenser mieux, dans le cadre d’objectifs géostratégiques limités mais clairement définis. Or, aujourd’hui, les autorités politiques peinent à formuler ces objectifs. On ne dit pas, par exemple, ce que l’on ferait si une crise surgissait en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Ce flou est contre-productif. Il faudrait affirmer que, quoi qu’il arrive, nous conserverons une capacité de protection du continent, et que nous structurons nos forces pour servir cet objectif. Une telle cohérence nous donnerait une chance, même relative, de retrouver un rôle de leadership en Europe sur les questions de défense. Car aujourd’hui, lorsqu’on échange avec les Polonais ou les Baltes, ceux-ci doutent de notre engagement.
Le nord et l’est du continent, l’Atlantique nord, la protection des routes navales, voilà des zones et des fonctions où les briques capacitaires françaises peuvent s’avérer déterminantes. Mais cela ne sera possible que si la France affirme clairement ce qu’elle veut : garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques, défendre la démocratie européenne, et se penser comme une puissance européenne solidaire, non comme une puissance isolée ou surplombante.
Car il faut aussi reconnaître que la France n’a pas, seule, les moyens de penser au-delà de cette échelle. Le paramètre clé est aujourd’hui le positionnement des États-Unis, qui peuvent évoluer fortement selon leurs dynamiques internes. La Russie, elle, reste plus constante, plus prévisible dans sa logique de puissance. C’est à cette dernière « stabilité », inquiétante, que nous devons opposer une vision crédible, construite, et collective.

L’Institut Open Diplomacy, fondé en 2010 par Thomas Friang, est un think tank reconnu pour ses travaux d’intérêt général. En 2025, face à l’accumulation de crises géopolitiques, écologiques, économiques et politiques qui s’aggravent mutuellement, il s’est donné pour mission de « comprendre et combattre la polycrise ».
Pour mener à bien cette mission, l’Institut a constitué un groupe de prospective. Les 10 co-auteurs du rapport ont engagé la réflexion en consultant plus de 30 experts de haut niveau afin d’analyser ces quatre grandes systémiques et leurs rétroactions, pour comprendre la bascule historique qu’opère la polycrise.
Cette étude, intégralement accessible via ces pages, est présentée au Sénat le 31 octobre 2025. Elle marque ainsi le 15e anniversaire de l’Institut Open Diplomacy et pose les bases du prochain sommet du Y7. Organisé sous présidence française du G7, il aura pour thème « combattre la polycrise ».
